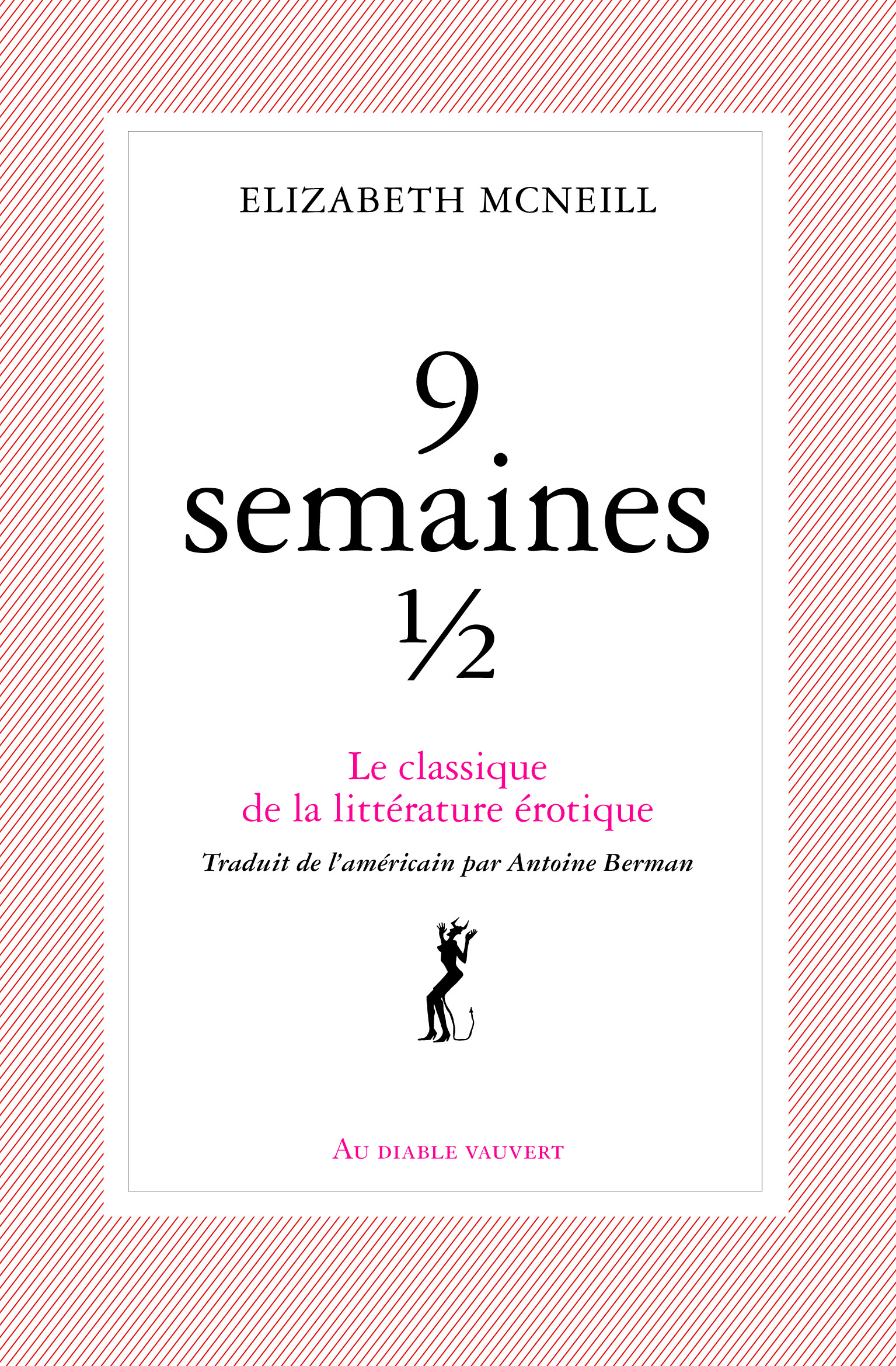MUSTAPHA SAHA








Cosmogonie picturale d’Ilham Laraki Omari
Par Mustapha Saha
Février 2019. Art Capital dans l’imposante enceinte du Grand Palais à Paris. L’œuvre atypique, inclassable, d’Ilham Laraki Omari, dans le Salon du dessin et de la peinture à l’eau, intrigue les visiteurs, interpelle les amateurs, interloque les commentateurs. Le titre annonce l’énigme. « Les Sept temps » sont des paliers initiatiques. Le sept, nombre sacré par excellence, ne désigne-t-il pas la totalité en mouvement, l’unité des contraires, le cycle accompli, l’achèvement du monde, l’accomplissement des âges, le passage du connu à l’inconnu, la renaissance à l’indicible ? Chaque chose essentielle possède six côtés et une ipséité, sa caractéristique propre. Les six prédispositions de l’intelligence, équivalentes aux couleurs de l’arc-en-ciel, se complètent par la connaissance suprasensible(ghiaba) dont les nuances se synthétisent dans la blancheur. Le message renvoie, de toute évidence, aux sept étapes de la voie mystique, « Les Sept vallées », décrites par Farid Eddine Attar dans « Le Langage des oiseaux » : « La première est la recherche (talab) / La deuxième est l’amour (ichq) / La troisième est la connaissance (ma’rifat) / La quatrième est l’autonomie (istignâ) / La cinquième est l’unité (tawhîd) / La sixième est l’émerveillement (hayrat) / La septième est le dénuement (faqr) ».
La technique mixte, qui consume et dissout les couleurs dans la bichromie du noir et du blanc, code d’emblée la grammaire plastique. Les spirales, les volutes, les vortex, les hélices, esquisses d’aiguilles de pendules, les engrenages, les sillages, traces luminescentes sur surface iridescente, sont autant d’indices du parcours mystique. L’incandescence se devine sous membrane obscure. Jeu de pistes du visible et de l’invisible. Tours et détours cinétiques. Se restitue, dans l’épure, l’empreinte extatique. Se côtoient des suites sibyllines, ajustées en lignes calligraphiques. Le regard insistant s’embarque dans des oscillations hypnotiques. Frémissements de vagues. Quand l’imprévisible prend forme mathématique, la raison voltige et divague. Le mystère ontologique s’entrevoit, dans la juxtaposition désordonnée des nombres et des signes. L’être intérieur se découvre dépositaire de l’humanité entière, de ses finitudes et de ses infinitudes, de ses matérialités et de ses sacralités. Le divin se cache, selon la tradition prophétique, derrière soixante-dix mille voiles. Le soufisme indique la trajectoire. L’âme (nafs), dans sa progression spirituelle, passe d’état en état (hâl), franchit l’une après l’autre les stations(maqâm) pour approcher la félicité. L’existence entraperçoit les passages vers la plénitude, s’aimante d’énergétique quiétude, vacille entre incertitude et béatitude. Première prouesse. Le temps se transfigure en image, se dessine en creux, s’éloigne et se dissimule au fur et à mesure qu’il se simule, s’aiguillonne et se stimule dans sa fuite vers l’insaisissable. L’artiste le pressent et l’exprime dans sa réceptivité sensitive. Le dialogue avec l’ineffable bascule immanquablement dans le vertige. L’œuvre substantiellement statique donne l’impression d’une étourdissante dynamique. Se visualise une étrange locomotive sur rails cosmiques.
L’œuvre éveille des souvenances lyriques. Des livres lus et relus, patiemment déchiffrés dans leurs philosophies allégoriques, s’ouvrent et se referment dans la tête. « Le Pavillon des Sept Princesses » de Nezami s’invite dans les réminiscences. Pérégrination physique et métaphysique d’un prince, nommé Bahram, en quête de rédemption. Sept récits narrés par ses sept épouses, logées sous des coupoles astrales aux couleurs de leurs signes stellaires. Rituel de réparation d’un monarque revenu de ses victoires terrestres, tourmenté par ses sanglantes conquêtes, qui se laisse guider sur la voie de la sagesse. Bahram passe successivement ses nuits avec l’indienne Fourak sous coupole noire comme Saturne, la byzantine Homay sous coupole jaune or comme le soleil, l’ouzbèque Pari sous coupole verte comme la lune, la slave Nasrine-nouche sous coupole rouge comme Mars, la maghrébine Azaryoune sous coupole turquoise comme Mercure, la chinoise Yaghmâ-nâz sous coupole grise comme Jupiter, la persane Dorosti sous coupole blanche comme Vénus. Bahram tire les leçons des contes rapportés par ses princesses, châtie son vizir tyrannique et disparaît dans les ténèbres d’une mystérieuse grotte. Comment ne pas s’émerveiller, au-delà de l’enseignement anagogique, devant cet essai de diversalisme et d’interculturalité avant la lettre ?
La libération de la femme dans les sociétés obscurantistes, stérilisées par les fanatismes, fossilisées par plusieurs siècles d’ignorantisme, indissociable de l’émancipation de l’artiste des entraves morales, passe fertilement par l’immanence soufiste, la démystification des falsifications théologiques, le dépassement des dualités séparatives. Le machisme préfabrique l’inégalité des sexes, façonne, dans une dialectique du maître et de l’esclave, une altérité féminine factice, renvoyée à l’animalité de la femelle. La phallocratie s’impose socialement par la négation de la moitié de l’humanité. La différenciation entre hommes et femmes n’est pas biologique, mais culturelle. L’emblématique sentence de Simone de Beauvoir (Le Deuxième sexe) « On ne naît pas femme, on le devient » rejoint l’authentique conception soufie, hors pervertissements idéologiques. Les hagiographies débordent de saintes femmes soufies au deuxième et troisième de l’Hégire avant qu’elles se raréfient dans les siècles suivants. Dans l’islam des lumières, les femmes occupent d’éminentes places de guides spirituels. Rabia al Adawiya de Bassorah tient des séminaires dans sa modeste demeure, suivis par les hommes de savoir et de pouvoir. L’un des plus grands philosophes mystiques, Mouhyiddine Ibn Arabi, surnommé « le plus grand maître » (Cheikh al-Akbar) et « Le fils de Platon » (Ibn Aflatoun), est le disciple préféré d’une savante sévillane, Fatima bint ibn Mouthanna. Ce qui explique qu’Ibn Arabi considère la féminité comme le véhicule parfait de la contemplation spirituelle. Dans son livre « L’Interprète des désirs », Ibn Arabi décrit le divin féminin dans de nombreuses paraboles. L’amour divin et l’amour profane se confondent dans la figure d’une persane, prénommée Nizhâm (harmonie), qui personnifie, par sa pureté et sa beauté, la sagesse divine régissant l’univers.
Le contraste absolu du noir et du blanc reflète l’acte même de création artistique entre interrogations stressantes et trouvailles saisissantes. Le noir est une couleur ambivalente, légère comme l’atmosphère sidérale, torpide comme l’opacité minérale. La phosphorescence noire annonce, dans le soufisme, le stade suprême de l’éblouissement, l’abstraction de soi, la fusion dans le tout. La réverbération blanche répercute la lumière intérieure. Se décèlent dans le tableau d’Ilham Laraki Omari des formes volantes. S’évoque la fable soufie des oiseaux blancs et des oiseaux noirs. Les humains sont des murailles dressées les unes face aux autres, des remparts percés de nids d’oiseaux blancs, qui sèment les bonnes pensées et les bonnes paroles, et de nids d’oiseaux noirs qui répandent les mauvaises pensées et les mauvaises paroles. S’imaginent deux personnages. Le premier se persuade que le second lui veut du mal. Il lui envoie son oiseau noir chargé des pires intentions. Quand l’ennemi supposé est dépourvu de toute hostilité, l’oiseau émissaire cherche en vain un nid noir vacant dans son mur et revient comme un boomerang. Le suspicieux malfaisant finit par être empoisonné par son propre venin. Si le récepteur est lui-même animé de préméditations malsaines, les nids noirs se libèrent de chaque côté pour accueillir l’entreprise de destruction mutuelle. Leurs missions délétères accomplies, les oiseaux noirs retournent à leurs nids d’origine pour achever l’anéantissement de leurs commanditaires. Le même processus s’effectue, avec des effets inverses, quand les oiseaux blancs sont lâchés. Les oiseaux blancs, combien même ne sont-ils pas reçus, réintègrent notre être avec leur énergie bénéfique. Nous sommes responsables et comptables de nos bénédictions et de nos malédictions.
La physiologie soufie se fonde souvent sur le septénaire. Achraf Jahangir Semnani recense sept enveloppes subtiles qui correspondent chacune à la typification d’un prophète dans le microcosme humain. Adam est représenté en noir mat, Noé en bleu, Abraham en rouge, Moïse en blanc, David en jaune, Jésus en noir lumineux, Mohammed en vert. Chaque être est la somme de tous les prophètes, la combinaison de toutes les couleurs, la concentration des nobles valeurs. Se profile le concept platonicien d’anamnèse. Chaque humain est la mémoire de toutes les mémoires, dépositaire de tous les savoirs anciens, qu’il retrouve par enchantement, à son propre étonnement, dans les idées lumineuses qui traversent son esprit. L’art, la poésie révèlent des connaissances enfouis dans l’inconscient collectif depuis la nuit des temps. La mémoire(mnémosyne) n’est-elle pas la mère des neuf muses qui président aux beaux-arts. La pensée est incapable de remonter à la source qui la fait connaissante, et pour représenter le surgissement de son savoir étrange, elle recourt aux images, aux métaphores, aux paraboles, aux transferts analogiques, aux figures iconiques. La pensée mobilise ses médiations fantasmagoriques. Elle transpose ce qui la dépasse dans les légendes et les récits mythologiques. Demeure dans l’élan mystique, la remembrance séculaire, la révélation oraculaire, la fulguration véhiculaire. Dans Phèdre, Socrate nous apprend que les âmes étaient jadis dotées d’ailes, qui leur permettaient de voler jusqu’aux limites du cosmos, parmi les étoiles fixes, de passer la tête à travers l’ultime barrière et de contempler les vérités éternelles.
L’art s’insinue dans l’inexplicable par la brèche entrouverte de la relativité. Pour Albert Einstein, l’espace et le temps ne sont pas absolus. Ils sont totalement liés dans la quatrième dimension. Ils sont déformables. La gravité n’est qu’une propriété géométrique. Le temps ne se meut pas à la même vitesse sur la terre et dans le ciel. Cette même relativité a permis l’invention de la télévision. Dans l’écran à tube cathodique, les images sont suscitées par le flux d’électrons percutant une plaque électroluminescente. La lumière est déclenchée par chaque stimulation. Les particules élémentaires, porteuses d’une charge électrique négative, accélérés à grande vitesse, déviées par des bobines génératrices d’un champ magnétique, ciblent et combinent des points précis pour reproduire des images intelligibles.
L’art taquine l’ultime frontière, prospecte l’insondable, au-delà des supercordes modulatoires, des membranes vibratives, des réceptivités pulsatives. Les quarks et les électrons se manifestent par leurs lueurs. Les motifs se contractent, creusent leur profondeur dans l’impénétrable nébulosité. L’imaginaire reconstitue, à sa guise, l’indécelable. Se convoque à l’esprit le mythe grec des trois Hespérides, nymphes du couchant, filles d’Atlas, pétrifié en montagnes marocaines. Nyx, la nuit, est l’une de leurs mères présumées. Leur résidence est un jardin fabuleux, un verger miraculeux, dans la vallée de Loukkos près de Larache. Les Hespérides, gardiennes du pommier aux fruits d’or, confié à leur garde par la déesse Héra, s’y alimentent subrepticement, comme l’artiste puise l’inspiration dans sa musette magique sans savoir son secret. Le mystère de la couleur unique de l’or, que la mythologie chinoise identifie à la sueur du soleil, s’éclaire aussi par la relativité. L’atome d’or, lourd et massif, comporte un noyau de soixante-dix-neuf protons et de soixante-dix-neuf électrons tournant sur plusieurs orbites, comme les planètes autour d’une étoile. Les électrons à proximité du centre apparaissent plus proches les uns des autres à cause de la contraction des longueurs, qui influence leur absorption et leur réflexion des ondes. Les atomes d’or reflètent ainsi la brillance entre le jaune et le rouge, et déclinent leur extraordinaire scintillance au lieu de s’engouffrer dans l’ultraviolet et le spectre non-visible de la lumière.
L’écriture picturale d’Ilham Laraki Omari s’inscrit instinctivement dans le langage quantique, qui rejoint l’inspiration prophétique. La quête spirituelle assimile les découvertes scientifiques. Le temps, qui détermine le déroulement des événements selon un ordre chronologique, se fige dans son passé, se volatilise dans son présent, s’augure dans son futur, n’est qu’une intuition humaine, sans fondement physique. L’écoulement linéaire d’une origine indéfinissable vers un devenir indéterminable n’existe que dans notre perception. L’horloge maîtresse de l’univers d’Isaac Newton n’est qu’une projection cognitive. L’espace-temps est finalement une infinité d’informations fragmentaires dont découle, entre autres, les courbures explicatives de la gravité (Mark Van Raamsdonk). La véritable équation cosmique, la « théorie du tout », échappe à toute mesure dimensionnelle. L’univers est une éternelle immuabilité.
Mustapha Saha
Sociologue, poète, artiste peintre

DJEMILA
Par Elisabeth Bouillot et Mustapha Saha
Départ de la Tour 106 des Minguettes, qui s’écroule, emportant avec elle l’urbaine sérialité des grands ensembles. Entre des parents incompréhensifs et une fratrie divisée, la petite fille regarde le ciel, plane entre être et néant. Elle écoute en boucle Barry white, Marvin Gaye, Donna Summer. La destinée s’augure musicale. Réminiscences sensitives à vie. Lycée en pointillés. Fugues par intermittences. Explorations du monde de la nuit. Danseuse sexy. Un frère la mouche au père autoritaire. Brutalités répétitives. Fuite sans retour. A quinze ans.
Paris, bien sûr. Djemila Khelfa débarque à l’improviste chez une grande sœur généreuse, amie de célébrités artistiques et littéraires. Michel Foucault entre autres. Adolescente des stratosphères, propulsée dans les hautes sphères. Jean-Luc Hennig, agrégé de grammaire, journaliste à Libération, rédacteur en chef du mythique Rolling Stone France, animateur sur Fréquence Gaie, auteur prolixe de livres sur la nuit, le sexe, la mort. Et toute sa bande, intempestive, provocatrice, fascinante. On les appelle « Les homos de Libé ». Des artistes et des intellectuels, argentins, brésiliens, latino-américains, s’agglomèrent dans les boîtes sulfureuses. Marcia Baila des Rita Mitsouko casse les codes de la variété. Catherine Ringer et Fred Chichin mettent le feu aux planches. Cœur brûlant du Paris transgressif. Triangle magique de l’art volcanique avec New York et Berlin. Panam conquise en toute liberté. Sans domicile fixe. Logée chez Guy Hocqueghem, écrivain, romancier, journaliste, pamphlétaire redoutable, figure de proue de la cause homosexuelle, mort dans la force de l’âge, à quarante-deux ans, fauché comme tant d’autres par le virus maudit du sida. Et son compagnon Copi, argentin flamboyant, dramaturge, écrivain, dessinateur consacré, acteur délirant, porte-voix emblématique du mouvement gay, également foudroyé par le sida à quarante-huit ans. Une force de frappe artistique incroyable. Avec la transsexuelle Marie France. Hélène Hazera, journaliste, actrice, réalisatrice, productrice, passionnée de musique arabo-andalouse, qui signe ses articles dans Libé uniquement de ses initiales HH.
Les survivants créent Act Up dans les années quatre-vingt-dix pour panser les plaies des années terribles. Djemila témoigne : « J’apprends, dans ce milieu iconoclaste, à me défaire des idées reçues, des jugements préconçus, des préjugés inculqués des éducations vermoulues. J’ai conscience de ma chance. J’évolue dans une avant-garde qui brûle de mille feux pour ouvrir de nouveaux horizons ». Serge Kruger est l’indéfectible ami de toujours, le frère, le père, le complice des quatre cents coups. Il a la classe du blouson noir attardé et l’excentricité de l’artiste moutardé. Mon baptême musical s’initie dans sa maison de la rue « Aux Ours », baignée de vapeurs artificielles. La fête permanente. Les joins partagés comme des calumets de la paix. Les virées nocturnes. Les léthargies diurnes. Et la musique avant tout. La musique possession. La musique qui entre, par chaque pore dans le corps. La musique qui électrise les fibres inaccessibles. La transe. L’hystérie libératrice. Le chant. A se déchirer les cordes vocales. Le cri primal. Le corps s’électrise. Le corps s’explose dans les impasses désertes, les caves obscures, les cambuses attractives. La société, tout autour, se technocratise, se robotise, se déshumanise.
Les Halles en pleine métamorphose, quartier général du groupe de loulous-artistes en rupture de ban. Destruction des fabuleux pavillons Baltard. Immeubles historiques engloutis par les bulldozers. Crime patrimonial à grande échelle. Eviction pompidolienne des classes populaires. Trous géants, trous béants, cratères d’enfer, immortalisés par Marco Ferreri dans son western loufoque « Touche pas à la femme blanche ». Parodie de la bataille de Little Bighorn et de l’ethnocide des amérindiens. Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni sublimes dans la dérision. La bande de Serge Kruger, baptisée Les Freaks, taille sa mythologie dans la défluviation créative. On se réunit dans la brasserie Le Royal Mondétour, tenue par un auvergnat comme il se doit. L’on se retrouve aussi à vingt dans le Paris Halles. Repas à cinq francs. Qui dit mieux ?
« Les Rolling Stones de « Little Queenie », Hamilton Bohannon, batteur de Jimi Hendrix, père du dico-funk, tournent sans arrêt dans le Juxe Box. Les albums « Aladin Sane » de David Bowie, « Berlin » de Lou Reed, « Raw Power » des Stoogs, « Too Much Too Soon » de New York Dolls, précèdent la déferlante punk. De nouvelles tendances, de nouvelles modes, intempestives, ravageuses. Bientôt débarquent d’outre-Atlantique et d’outre-Manche Patti Smith, Elodie Lauten, les Ramones, les Sex Pistols, les Stinky Toys. Et la musique tribale d’Eddie Harris, du jazz fauve et farouche, des lancinations rythmiques entrecoupées d’accélérations vertigineuses. Danses saccadées jusqu’à perdre conscience. Scansions africaines et marocaines. Saltos dans l’inconnu. Basculement dans l’infini.
Djemila devient la première femme Disc Jockey. Elle endiable les platines à la Main Bleue, immense caveau enterré dans la banlieue rouge de Montreuil, au milieu des friches industrielles. Le Sex Machine de James Brown résonne à plein tube. Les sapeurs noirs se moussent et s’émoussent de la fine crème blanche, évadée des beaux quartiers. Une autre aventure se présente avec le magazine Façade. Djemila en devient copropriétaire, s’investit dans toutes les rubriques, dans tous les registres, la rédaction, l’iconographie, pose dans des photographies mythiques, mi-ange mi-démon, avec Mike Jagger, Bryan Ferry, Sophia Loren, Jack Nicholson. Andy Warhol trouve « Djemila parfaitement graphique, le prototype de la femme de l’an 2000 ».
Les portes du cinéma s’entrouvrent et se referment aussitôt. Deux rôles sur mesure passent sous le nez de Djemila. Elle est pressentie pour jouer dans « 37°2 le matin » de Jean-Jacques Beineix et « Sans toit ni loi » d’Agnès Varda, deux personnages faits pour elle, qu’elle a peut-être inspiré. Béatrice Dalle et Sandrine Bonnaire la coiffent sur le poteau. L’interminable série des occasions manquées commence.
Djemila se façonne une manière d’être, suggestive et fracassante, une silhouette fuselée, une attitude batailleuse et séduisante. Pantalons moulants, jupes coulantes, collants serrés et porte-jarretelles, chinés dans Les sex-shops. Des tenues extrêmes. Tantôt femme fatale, tantôt garçon manqué. Une relation esthétique avec elle-même et le monde. Icône, Muse, Sirène au Palace et aux Bains Douches. Thierry Mugler s’en contagionne. La haute couture la sollicite. Elle parade à contre-courant, mains sur les hanches. Pudeur lascive et décontraction subversive. Elle reste, les années passants, sur la même ligne artistique, inlassablement bercée par les sonorités musicales de Kraftwerk et la littérature de la Beat Generation. Combinaisons Survival, logos psychédéliques, élégance sauvage. Après un défilé underground, l’écrivain journaliste, Alain Pacadis, dandy gauchiste, disparu dans des circonstances troubles à trente-sept ans, surnomme le personnage public sans concessions « Djemila sans accent », symbole précurseur de l’interculturalité transversale et novatrice.
Elisabeth Bouillot et Mustapha Saha

MICHEL DE MONTAIGNE,
ARTISAN DE LA LAÏCITE DIVERSITAIRE
PAR MUSTAPHA SAHA
Michel de Montaigne travaille dans sa bibliothèque, nichée dans une tour de son château, où les œuvres d’Aristote, d’Avicennes (Ibn Sina), d’Averroès (Ibn Rochd) occupent une place centrale.« Je passe dans ma bibliothèque et la plupart des jours de ma vie et la plupart des heures du jour ». « Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessein, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j’enregistre et dicte, en me promenant, mes songes que voici ». Montaigne installe sa librairie, microcosme circulaire où la liberté se goûte dans la solitude, comme un poste stratégique, où il se protège des tumultes extérieurs et veille en même temps sur ses affaires. « Je m’égare, mais plutôt par licence que par mégarde ». « J’aime l’allure poétique, à sauts et à gambades ». L’esprit réfractaire retrouve toute sa créativité dans le vagabondage. Le tempérament rebelle s’abandonne à l’inspiration du moment. Les livres, miroirs du monde et de soi-même, sont des compagnons fidèles et secourables. Le vécu se contextualise sans fioritures. Le lecteur s’invite dans le laboratoire d’idées. Les poutres et les solives sont gravées de citations emblématiques. « Il n’est rien de certain que l’incertitude »(Pline). Les apophtegmes s’incrustent dans l’architecture. La pensée montaignienne évolue dans la synergie des contradictions, du doute méthodique, de la vigilance relativiste, de la sagesse stoïcienne, de l’attente tactique. Notre être, dans ses intrications profondes, n’est-il pas un mélange des mélanges ? Lucrèce, qui considère, comme son inspirateur Epicure, les sens comme uniques sources de connaissance, se sollicite comme référence. Les sens fournissent les clefs d’interprétation du réel, dessinent les cadres d’intelligibilité du factuel, guident l’agir contextuel. Montaigne s’installe dans l’hédonisme ascétique, carpe diem d’Horace en guise de lanterne, « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ».
L’art de vivre montaignien relie continuellement la médiation philosophante à la pratique quotidienne. Les consolations épicuriennes exorcisent les angoisses existentielles, les folies événementielles, les peurs convictionnelles. Le quadruple remède s’applique dans les actes ordinaires. Montaigne ne craint ni les dieux, ni les souffrances, ni l’inéluctable camarde. La première vocation du philosophe n’est-elle pas de guérir les humains des maux qui les accablent ? « Le plus effrayant des maux, la mort ne nous est rien : quand nous sommes, la mort n’est pas là, et quand la mort est là, c’est nous qui ne sommes pas » (Epicure, lettre à Ménécée). De la même manière, il faut se moquer du destin, qui n’est point le maître absolu des choses. Au-delà des prédispositions ataviques, la volonté particulière pilote la destinée singulière. L’existence autogérée est un projet continu. L’humanité fabrique elle-même ses malheurs parce qu’elle ne se contente pas de ses désirs naturels et nécessaires, largement suffisants pour satisfaire son bien-être physique et psychique, parce que la cupidité et la vénalité la poussent toujours plus loin dans la recherche des désirs non naturels et non nécessaires, ces maladies de l’âme instillées par l’égoïsme, ces propensions pathologiques à posséder et à dominer sans fin et sans besoin. Les discours politiques et les spéculations philosophiques, détachés des réalités mouvantes, ne sont que des rhétoriques stériles et des mystifications morales. Etrange résonance avec l’ère de l’insignifiance actuelle. « C’est une chose bien singulière que les choses en soient arrivées à ce point, dans notre siècle, que la philosophie, ce soit, jusque chez les gens de grande intelligence, un vain mot, chimérique, qui se trouve n’être d’aucune utilité ni d’aucune valeur et dans l’opinion commune et en fait ». Les modélisations abstraites excluent les subjectivités dynamisantes, imposent comme normes collectives des encadrements bureaucratiques, des conventions oppressives, des institutions répressives. La raison uniformisatrice, pouvant tenir deux positions contraires sans que l’une ou l’autre soit fausse ou vraie, est renvoyée à son objectivisme équivoque. Démystification prémonitoire du pouvoir technocratique. Pour Montaigne, la complexité de la vie, à l’instar des combinaisons infinies de la nature, se reconnaît dans ses manifestations protéiformes et sans cesse renouvelées. Se démasque l’illusion unitariste des doctrines instituées en systèmes immuables. L’idéalisme, comme le rationalisme, n’accouche, dans ses applications arbitraires, que du dogmatisme.
La méthodologie montaignienne est fondamentalement laïque, profondément ancrée dans la corrélativité naturelle et la relativité culturelle. La laïcité, du grec laikos, peuple, et du latin laicus, peuple des croyants par opposition au clergé, est définie comme opinion plurielle de la multitude, traversée de perplexités et d’indécisions. Montaigne préconise une laïcité déliée de toutes les parties, régulée par l’impartialité arbitrale, s’inscrivant en droite ligne dans la séparation de la politique et de la religion, conçue par Averroès (Ibn Rochd). Les choses du ciel appartiennent au ciel, les choses de la terre appartiennent à la terre. La transcendance s’évite. L’immanence s’invite sans billet retour. La laïcité n’est pas une opinion, mais une protection des convictions personnelles, une garantie de l’égalité différentielle et des libertés individuelles. Depuis l’avènement du monothéisme, les lois civiles se sont faites, à son image, monolithiques, rigoristes, inflexibles. La parole révélée ne souffre aucune antithèse. Depuis la conversion de l’empereur Constantin au christianisme, en ce quatrième siècle où la pensée canonique étrangle les philosophies anciennes, le verbe évangélique commande la loi séculière, les sentences bibliques téléguident les préoccupations journalières. Le totalitarisme étatique se légitime par l’irréfutabilité théologique. Ce n’est qu’après la révolution française, proclamant la souveraineté du peuple fondée sur la volonté générale des citoyens, que la politique se désacralise, que la foi s’individualise. L’approche de Montaigne se distingue des formalisations législatives de la liberté de conscience par son souci d’associer indissociablement la diversité et la laïcité, de poser la réciprocité comme preuve d’équivalence et l’expérience de l’altérité comme épreuve de reconnaissance. Transition décisive d’une culture exclusive à une culture cumulative, d’une perception verticaliste du monde, justificatrice des strates discriminatoires, à une immersion transversale et communicationnelle dans les complexités vivantes. Nulle conviction ne peut se prévaloir d’une quelconque prédominance historique ou philosophique. Seule prime l’éthique proclamée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».
Les écrits de Montaigne, malgré leur apparente hétérogénéité, présentent une cohérence d’ensemble malicieusement enchevêtrée de thèses antithétiques. Le dogme chrétien se ménage pour contourner la censure. Le bûcher s’évite au prix de loquacités préventives. Certes, les interrogations métaphysiques comblent les vides de la conscience face aux angoisses ontologiques, mais les considérations spirituelles ne sauraient se confondre avec les questions sociales, qui exigent des évaluations différentielles, des solutions concrètes et variétaires. Il n’est que des vérités circonstancielles, situationnelles. Nous ne connaissons Dieu que par les noms que nous lui attribuons, et ces noms lui sont extérieurs. Dieu est la complétude et la perfection, il n’a point besoin de nos prières pour être. « Puisque l’homme désirait tant s’égaler à Dieu, il eut mieux fait dit Cicéron, de ramener à lui les qualités divines et de les attirer ici-bas que d’envoyer là-haut sa corruption et sa misère ». Nous prenons les mots pour les choses et les choses pour les mots. « Nous sommes creux et vides. Ce n’est pas de vent et de mots que nous devons nous remplir. Nous avons besoin, pour nous réparer, d’une substance plus solide. C’est de beauté, de santé, de sagesse, de vertu et de qualités essentielles que nous manquons. Et les ornements externes devront être recherchés plus tard, quand nous aurons pourvu aux choses nécessaires ». L’iconoclaste essayiste se détache de toutes les croyances, doctrines closes maintenues par les crédulités superstitieuses. « Il est vraisemblable que le principal crédit des miracles, des visions, des enchantements et de tels effets extraordinaires, vienne de la puissance de l’imagination agissant principalement contre les âmes du vulgaire, plus molles. On leur a si fort saisi la créance qu’ils pensent voir ce qu’ils ne voient pas ». Les démonstrations montaigniennes s’abreuvent aux réfutations sarcastiques de Lucien de Samosate. Si tout ce qui existe est écrit d’avance, à quoi servent les louanges et les sacrifices ? Comment croire à la providence dans un monde régi par l’iniquité et l’injustice ? Ne trouve grâce que le principe averroïste de la double vérité. Une même assertion peut être vraie du point de vue philosophique et fausse du point de vue théologique, et inversement. Une manière de signifier que les sentences religieuses ne sont vraies que pour ceux qui y croient. La célébration de la nature comme critère de validation est un retour au chamanisme, une revanche de l’immanence palpable sur la transcendance ineffable. « Nous avons abandonné la nature et lui voulons apprendre sa leçon, elle qui nous menait si heureusement et si sûrement ». Montaigne défend les sorcières de sa région, héritières des traditions druidiques. Les énergies cosmiques et telluriques nous instruisent. Chaque fois que les dérives civilisationnelles débouchent sur des horizons apocalyptiques, l’écologie redevient l’ultime recours, l’éternel retour, mais dès que la politique s’en empare, les principes de leurs vertus naturelles se déparent.
Toutes les expressions de la vie, humaines, animales, végétales, sont mues par les mêmes énergies minérales, les mêmes pulsations sidérales, les mêmes fluidités conglomérales. « Il y a un certain respect, qui nous attache, et un général devoir d’humanité, non aux bêtes seulement, qui ont vie et sentiment, mais aux arbres mêmes et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes, et la grâce et la bénignité aux autres créatures, qui en peuvent être capables. Il y a quelque commerce entre elles et nous, et quelque obligation mutuelle ». L’ethnocentrisme occidental, s’octroyant le monopole d’une science inégalable et d’une civilisation indépassable, est battu en brèche comme l’anthropocentrisme, faisant du genre humain l’unique espèce prédestinée à dominer les autres formes d’existence parce qu’elle s’autoproclame détentrice d’un esprit en connexion avec la volonté divine. Et pourtant, les humains et les animaux ne fonctionnent-ils pas avec les mêmes mécanismes organiques, les mêmes programmations génétiques, les mêmes transmissions génétiques ? N’ont-ils pas les mêmes manières de se mouvoir, de se nourrir, de se grouper, de vivre et de mourir ? Les animaux n’ont-ils pas une connaissance instinctive des secrets de la médecine, contrairement aux humains qui se laissent berner par le charlatanisme ? La théorie des correspondances va jusqu’à décrire la pratique religieuse des éléphants, qui font des ablutions, dressent leur trompe en guise d’imploration, fixent profondément le soleil levant, s’absorbent longuement en contemplation méditative.
Montaigne ne cesse de plaider pour un droit des animaux, qui les préserve des exterminations. Les animaux sont autant que les humains dotés d’intelligence, de roublardise et d’espièglerie. Le mulet de Thalès, trébuchant par inadvertance dans un gué et s’apercevant que l’eau dissout la charge de sel qui l’écrase, recherche, dès lors, le secours des ruisseaux pour s’alléger, jusqu’au jour où son stratagème est découvert et qu’il est lesté de sacs de laine. Contrairement aux humains qui transforment leurs vices en mode de vie, les autres vivants n’usent de la ruse que pour échapper aux brimades. L’instinct de survie des animaux leur permet de puiser leurs remèdes dans la nature, et d’en déjouer les pièges. Ne connaissent-ils pas les mouvements des astres pour se guider et les vertus des plantes pour se guérir ? Dire des animaux, pour les déprécier, qu’ils ne tirent leur science instinctive que de la nature, c’est leur reconnaître un titre dont les humains sont, en grande partie, dépourvus. L’humanité n’est-elle pas, a contrario, la seule espèce vivante à inventer la guerre pour s’entretuer, se ruiner, s’autodétruire. Les animaux nous apportent, quand nous nous donnons la peine de les découvrir, tels qu’ils sont et non tels que nous les fantasmons, autant de richesses intellectuelles et spirituelles que les cultures lointaines. Leur diversité nous éclaire sur notre propre passé et notre propre futur. A condition que nous nous affranchissions de nos préjugés sur tout ce qui nous semble étrange. « Il n’y a d’autre bête au monde à craindre pour l’homme que l’homme ».
Montaigne se veut un interprète de la réalité et non un proférateur de vérité. L’humain n’est pas un concept fini et défini une fois pour toutes, mais une réalité vivante en perpétuelle transformation. L’humain n’est ni une identité magnétique, ni une unité statistique, ni une quiddité stable, ni une marchandise rentable. Chaque être est un monde en soi. Chaque être reflète son environnement de manière incomparable. L’humanité entière est une somme de singularités irréductibles les unes aux autres. Et en même temps, « qui se connaît, connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition ». Les variations discursives de Montaigne épousent les fluctuations observatives. Ce relativisme prospecteur des possibles puise ses illustrations dans le scepticisme antique, dans les savantes extrapolations du socratisme, de l’épicurisme, du pyrrhonisme, du stoïcisme sans jamais verser dans le nihilisme. Les certitudes, toujours menacées par des certitudes antagonistes, ne sont-elles pas les ferments de tous les conflits ? Les guerres intestines déroulent leurs purifications sanguinaires, leurs monstrueuses exterminations, leurs abjectes justifications. Les tyrannies ne creusent-elles pas leur lit dans le fanatisme ? L’intransigeance religieuse, dès qu’elle se constitue en faction armée, perd sa foi et sa loi, bascule dans l’inclairvoyance passionnelle et l’hystérie collective. La promesse du paradis se réalise sur terre en apocalypse.
En ce siècle terrible des guerres de religion, l’idée de la laïcité se profile comme alternative à la terreur inquisitrice, une laïcité fondée sur la conscience individuelle et collective de la diversité, au-delà de la philosophie de la tolérance qui n’est, en dernier ressort, qu’une attitude résignative. La société civile se constitue de ses multiples composantes, qui s’enrichissent mutuellement de leurs différences. « Cela ne m’effraie pas du tout de voir de la discordance entre mes jugements et ceux d’autrui, et je ne me coupe pas pour autant de la société des hommes qui ont un autre point de vue et sont d’un autre parti que le mien. Au contraire, comme la diversité est la méthode la plus générale que la Nature ait suivie, et surtout en ce qui concerne les esprits, plus que pour les corps, car les esprits sont faits d’une substance plus souple et plus susceptible d’avoir des formes variées, je trouve qu’il est bien plus rare de voir s’accorder des caractères et des desseins. Et il n’y eut jamais au monde deux opinions semblables, pas plus que deux cheveux, ou deux grains. Leur façon d’être la plus générale, c’est la diversité ». Toutes les confessions se valent et s’équivalent. « Tout cela, c’est un signe très évident que nous ne recevons notre religion qu’à notre façon et par nos mains, et non autrement que comme les autres religions se reçoivent. Nous nous sommes rencontrés au pays, où elle était en usage, où nous regardons son ancienneté, ou l’autorité des hommes qui l’ont maintenue, ou craignons les menaces qu’elle attache aux mécréants, ou suivons ses promesses. Ces considérations-là doivent être employées à notre créance, mais comme subsidiaires : ce sont liaisons humaines. Une autre région, d’autres témoins, pareilles promesses et menaces, nous pourraient imprimer par même voie une créance contraire ».
Montaigne s’attaque frontalement à certains vices, considérés comme signes d’omnipotence quand ils s’exercent au profit de l’ordre établi, l’orgueil, la vanité, l’outrecuidance, l’ambition, la condescendance, qui caractérisent l’esprit malin. L’honnête homme se reconnaît à son altérité. Il se mêle aux autres peuples et prend autant plaisir à la découverte de leur culture qu’à la connaissance de la sienne. Le voyage ouvre les chemins de l’épanouissement. La volupté du mouvement, la délectation de l’errance, l’exploration des différences fécondent une éthique, une poétique et une esthétique de fraternité solidaire et d’interactivité stimulante. « Nous prenons en garde les opinions et le savoir d’autrui et puis c’est tout. Il faut les faire nôtres. Nous ressemblons à celui qui, ayant besoin de feu, en irait quérir chez son voisin et, y en ayant trouvé un beau et grand, s’arrêterait là à se chauffer, sans plus se souvenir d’en rapporter chez soi ».
La démarche montaignienne se symbolise par la balance gravée de la question pyrrhonienne « Que sais-je ? ». Tout se pèse et s’évalue. A commencer par les vérités toujours oscillantes, vacillantes, multiformes. La raison humaine est une équerre de sourcier. Elle flotte. Elle grelotte. Elle tremblote avant de repérer le point focal, qui s’avère un bon repérage ou un pur mirage. Les plaisants chercheurs des causes, obsédés par les retombées potentielles, spéculent sur des nébuleuses virtuelles et oublient les matérialités nourricières. La foi sans conscience se saborde dans son expérience. Les humains, à force de prendre leurs comédies pour sérieuses occupations, deviennent les pantins de leurs propres farces. Les masques et les apparences se substituent à la vie. La peau ne se distingue plus de la chemise. A force de s’enfariner le visage, on s’enfarine le cœur. Les gens se confondent avec les fourberies de leurs fonctions sociales et finissent par n’être que des déloyautés ambulantes.
Le motif de la vanité tisse et retisse les fils rouges desdépravations sociales, des corruptibilités pathogènes, des dérives psychogènes. L’époque de Montaigne s’illustre par les vanités en peinture, des œuvres iconiques sur la précarité de la condition humaine. Ici-bas, tout est éphémère, tout s’achève en chimère. La vie n’est-elle qu’une transition matérielle, inconsciente de sa propre essence ? A quoi sert au mortel son identification divine ? L’approche transversale, plurale, diversitaire, s’oppose à la logique pyramidale, exclusive, dissociative, meurtrière. Montaigne traque, dans ses derniers retranchements, la vanité rationnelle, qui prétend fournir des solutions imparables, et qui n’ajoute, en théorie, que des contradictions aux contradictions, et, en pratique, des impasses aux impasses. Demeure une évidence, toute existence est mutante. Tout état est fugace. Tout être est périssable. Comment la raison peut-elle avoir prise sur des choses sans cesse changeantes ? Le langage qui nomme est lui-même continuellement renommé. Il n’y a ni concepts infrangibles, ni définitions intangibles. Les discours, pour éviter les assurances illusoires et les serments décisoires, doivent plier leur lexique aux transmutations sémantiques. Les cohérences philosophiques se tissent dans les mosaïques paradoxales. La coexistence de toutes les opinions n’est possible que dans un cadre profane, qui les admet toutes et n’en distingue aucune.
Montaigne initie la critique radicale de l’européocentrisme, qui se donne comme excellence et précellence. Or, le monde n’est ni statique, ni monolithique. Le concept de diversité est formulé dans toute sa portée philosophique et pratique. L’humanité ne se développe et ne se perpétue que par ses métissages. Une philosophie de la conscience, hérétique, autonome, indépendante, active, animée de volonté constructive et d’audace inventive. Une préscience de l’autogestion. Non point une morale, imposée par des impérativités sociales, mais une éthique détachée de toute contrainte, cultivée dans ce jardin secret que nous sommes seuls à connaître. « Nous devons nous bâtir un modèle intérieur qui soit la pierre de touche de nos actes, et en fonction de lui, tantôt nous féliciter, tantôt nous réprimander. J’ai mes propres lois et mon tribunal pour juger de moi, et je m’y réfère plus qu’à d’autres ». Il n’est d’authentique citoyenneté que la citoyenneté du monde. « Il se tire une merveilleuse clarté pour le jugement humain de la fréquentation du monde. Nous sommes tous contraints et amoncelés en nous, et avons la vue raccourcie à la longueur de notre nez. Quand on demandait à Socrate d’où il était, il ne répondit pas d’Athènes, mais du monde ».
La conquête du nouveau monde par le catholicisme génocidaire, l’évangélisation ethnocidaire, démontre, en arrière-fond, de quelles machinations politiques la religion est capable pour étendre sa puissance. « Tant de villes rasées, tant de peuples exterminés, passés au fil de l’épée, et la plus riche et la plus belle partie du monde bouleversée dans l’intérêt du négoce des perles et du poivre… Beau résultat ! Jamais l’ambition, jamais les inimitiés ouvertes n’ont poussé les hommes les uns contre les autres à de si horribles hostilités et à des désastres aussi affreux ». « Peu importent leurs noms, car ils n’existent plus ; la désolation due à cette conquête, d’un genre extraordinaire et inouï, s’est étendue jusqu’à l’abolition complète des noms et de l’ancienne topographie des lieux ».« Notre monde vient d’en découvrir un autre. Et qui peut nous garantir que c’est le dernier de ses frères, puisque les Démons, les Sybilles et nous-mêmes avons ignoré celui-là jusqu’à maintenant ? ». Montaigne donne, en exemple, le sort terrible réservé au roi du Pérou par les conquérants espagnols, qui, non contents de récupérer, en rançons et butins, l’essentiel de ses richesses, le dépouillèrent jusqu’à l’os. « Il leur prit cependant l’envie de voir, au prix de quelque trahison que ce fût, ce que pouvait contenir encore le reste des trésors de ce roi, et de profiter pleinement de ce qu’il avait conservé. On l’accusa donc avec de fausses preuves, de vouloir soulever ses provinces pour recouvrer sa liberté ; et par un beau jugement, rendu par ceux-là mêmes qui étaient les auteurs de cette machination, on le condamna à être pendu et étranglé publiquement, non sans lui avoir évité d’être brûlé vif en lui administrant le baptême pour se racheter lors de son supplice : traitement horrible et inouï, qu’il supporta cependant sans s’effondrer, avec une contenance et des paroles d’une tournure et d’une gravité vraiment royales. Et pour endormir les peuples stupéfaits et abasourdis par un traitement aussi exceptionnel, on simula un grand deuil, et on ordonna que lui soient faites de somptueuses funérailles ».
Le pouvoir religieux exécute ses homicides en chaîne dans l’impunité totale. Le pacifisme métaphysique s’accomplit dans l’anéantissement physique. La surenchère tortionnaire se termine dans la jouissance sadique. Comment ne pas penser aux atrocités des dernières guerres coloniales ? « A peine me pouvais-je persuader, avant que je l’eusse vu, qu’il se fût trouvé des âmes si monstrueuses qui, pour le seul plaisir du meurtre, le voulussent commettre : hacher et détrancher les membres d’autrui ; aiguiser leur esprit à inventer des tourments inusités et des morts nouvelles, sans inimitié, sans profit, pour cette seule fin de jouir du plaisant spectacle des gestes et mouvements pitoyables, des gémissements et voix lamentables d’un homme mourant en angoisse ». « Pour tuer et manifester en même temps leur colère, les tyrans ont employé toute leur habileté à trouver le moyen de faire durer la mort. Ils veulent que leurs ennemis s’en aillent, mais pas trop vite, pour avoir le temps de savourer leur vengeance. Et là, ils sont bien en peine : car si les tourments sont violents, ils sont courts ; et s’ils sont longs, ils ne sont pas assez douloureux à leur gré. Les voilà donc à utiliser leurs instruments de torture ».L’inquisition ouvertement se dénonce. Tout pouvoir politique est corrupteur, générateur de cynisme et de sadisme. Entre absolutismes en lutte, féodalisme, catholicisme et monarchisme, conservatisme, fanatisme et modernisme, nulle espérance ne se dépiste. Montaigne brouille sciemment les pistes pour libérer sa réflexion des entraves institutionnelles. Son capharnaüm philosophique est l’expression même de la diversité et de la laïcité. Se magnifient les mystères divins quand ils s’harmonisent avec la télesthésie chamanique. Se valorisent les préceptes religieux quand ils prodiguent des principes éthiques. S’anoblissent les conduites quand elles puisent leur exemplarité dans les vérités mythologiques. Une pensée sensualiste, dynamique, en interrogation permanente sur son efficience dans la pratique. S’explorent les odeurs, les saveurs, les couleurs, les mystères des ombres et des lumières, des clairs et des obscurs, des pleins et des vides, toutes les subtiles différences entre choses semblables. L’atomisme lucrécien se décline en phénoménologie de la perception. S’ouvrent dès lors les possibilités infinies de sensibilités connectives, de réceptivités constructives, d’affinités créatives.

Commémoration du centenaire de l’armistice du 11 Novembre 1918.
Russes et marocains au secours des français.
Par Mustapha Saha
A l’occasion de la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 Novembre 1918 à Paris, Vladimir Poutine, en escapade de la messe officielle, a déposé une gerbe, sous pluie battante, sur le monument en hommage au corps expéditionnaire russe de quarante mille hommes, engagés aux côtés des français pendant la Première Guerre mondiale. Noires limousines et rouges églantines sur statue de bronze. Contrairement à la grande kermesse de l’Arc de Triomphe, la cérémonie sur berges de Seine se déroule dans une étonnante intimité. Le secteur est largement isolé et sécurisé. Ne se profilent sous les arbres qu’uniformes sombres et gendarmes en surnombre. La discrétion des autorités françaises n’est pas anodine. Cette histoire singulière concerne des soldats inclassables, irrécupérables, qui se distinguent autant par leur bravoure sur les champs de bataille que par leur refus des horreurs de la mitraille. (Eric Deroo, Gérard Gorokhoff : Héros et mutins, les soldats russes sur le front français 1916 – 1918, éditions Gallimard, 2010). (Rémi Adam : La Révolte des soldats russes en France, éditions Les Bons caractères, 2007). La Révolution de 1917 provoque une mutinerie de neuf mille soldats russes, qui proclament une république soviétique dans leur camp de La Courtine dans la Creuse. Des tracts révèlent que ces soldats ont été échangés, comme des marchandises, contre d’importantes livraisons d’armes et de munitions au tsar Nicolas II. La colère gronde plus fort que les canons. Au-delà des musiques et des danses traditionnelles, de l’ours Michka promu mascotte et porte-bonheur, les idées révolutionnaires trouvent leur bon terreau dans le bourbier militaire. Il suffit de lire Le journal de Stéphane Ivanovitch Gavrilrenko, un soldat russe en France 1916 – 1917, éditions Privat, 2014, qui décrit les tranchées de l’enfer dans un style ironique et mélancolique. Après la guerre, Il n’est que l’ours Michka qui prolonge tranquillement son existence au Jardin d’Acclimatation de Paris avec la bienveillance de sa marraine, l’actrice et chanteuse Mistinguette.
Léon Trotski relate cette révolte : « Pendant ce temps, bien loin au-delà des frontières du pays, sur le territoire français, l’on procéda, à l’échelle d’un laboratoire, à une tentative de résurrection des troupes russes, en dehors de la portée des bolcheviks ». « Les soldats ne se trompaient pas. A l’égard des patrons alliés, ils ne nourrissaient pas la moindre sympathie, et à l’égard de leurs officiers, pas la moindre confiance ». « La première brigade était sortie de la subordination. Elle ne voulait combattre ni pour l’Alsace ni pour la Lorraine. Elle ne voulait pas mourir pour la belle France. Elle voulait essayer de vivre dans la Russie neuve. ». « Au milieu de bourgades bourgeoises, dans un immense camp, commencèrent à vivre en des conditions tout à fait particulières, insolites, environ dix mille soldats russes mutinés et armés, n’ayant pas auprès d’eux d’officiers et n’acceptant pas, résolument, de se soumettre à quiconque ». La deuxième brigade russe est engagée contre la première. Une canonnade méthodique est ouverte jusqu’à reddition totale. « C’est ainsi que les autorités militaires de la France mettaient en scène sur leur territoire une guerre civile entre Russes, après l’avoir précautionneusement entourée d’une barrière de baïonnettes. C’était une répétition générale. Par la suite, la France gouvernante organisa la guerre civile sur le territoire de la Russie elle-même en l’encerclant avec les fils barbelés du blocus ». « A la fin des fins, les mutins furent écrasés. Le nombre des victimes est resté inconnu. L’ordre, en tout cas, fut rétabli. Mais quelques semaines après, déjà, la deuxième brigade, qui avait tiré sur la première, se trouva prise de la même maladie… Les soldats russes avaient apporté une terrible contagion à travers les mers, dans leurs musettes de toile, dans les plis de leurs capotes et dans le secret de leurs âmes. Par-là est remarquable ce dramatique épisode de La Courtine, qui représente en quelque sorte une expérience idéale, consciemment réalisée, presque sous la cloche d’une machine pneumatique, pour l’étude des processus intérieurs préparés dans l’armée russe par tout le passé du pays » (Léon Trostski : Histoire de la révolution russe, éditions du Seuil, 1967).
Les leaders de la subversion sont emprisonnés à l’île d’Aix. Dix mille russes sont déportés en Algérie, dispersés entre mer et désert, reconvertis en travailleurs forés au service des colons. Ces soldats démobilisés, venus d’un pays communiste non reconnu, n’ont aucun statut légal. Ils sont soupçonnés d’être des révolutionnaires professionnels, missionnés pour inoculer le virus de l’agitation aux populations algériennes. L’autorité militaire les contrôle et décide de leur sort à sa guise. La censure frappe leur correspondance. Qu’ils travaillent dans les fermes, dans les mines de plomb de Chebet-Kohol ou sur les chantiers de chemin de fer, ils disposent formellement de contrats de trois mois reconductibles pour un franc de salaire. Ils remplacent avantageusement les indigènes morts à la guerre. En 1920, un accord secret entre français et soviétiques permet aux russes, qui le désirent, de regagner leur terre natale. Personne ne sait ce que sont devenus leurs compatriotes fondus dans la nature. Demeure l’étrangeté de certains noms à consonnance slave en terre maghrébine.
Bientôt, l’ancienne flotte impériale et d’autres bateaux de réfugiés, en provenance de Constantinople, débarquent une véritable diaspora russe, désormais apatride, à Bizerte et sur les côtes maghrébines. Des aristocrates, des écrivains, des artistes, des ingénieurs s’installent dans les prairies marocaines. Le fils de Léon Tolstoï s’établit à Rabat. D’autres immigrés, humiliés dans la capitale parisienne, retrouvent leur utilité sociale et leur considération morale de l’autre côté de la Méditerranée. Leur appartenance européenne leur assure les privilèges coloniaux. Dans les environs de Kenitra, de Rabat, de Marrakech, ils fondent des villages de style russe, des plantations d’olives et d’orangers. Leur expertise et leur gestion sont particulièrement recherchés dans le secteur agricole. Les techniciens russes investissent fructueusement leurs compétences dans les grands travaux publics. La cathédrale Notre Dame de l’Assomption de Casablanca et l’église orthodoxe de la Résurrection du christ de Rabat appartiennent au patrimoine architectural. Leur littérature, leur théâtre, leur musique rayonnent au-delà du cercle communautaire. Les bals russes, organisés dans les jardins du palais royal de Rabat, connaissent une grande vogue. Pendant la lutte pour l’indépendance, la propagande française pousse les occidentaux vers de nouveaux exils, en Europe et aux Amériques. Les russes quittent, dans le même mouvement, leur patrie d’adoption, laissant derrière eux leurs legs culturels et perpétuant dans le monde leur héritage marocain.
Pendant le Première Guerre mondiale, deux ans à peine après le protectorat, quelques centaines de militaires russes sont intégrés dans la division marocaine, qui comprend pêle-mêle une moitié d’européens, des légionnaires, des marsouins, des zouaves, et une moitié de tirailleurs marocains, algériens, tunisiens, sénégalais, malgaches. Le résident général Hubert Lyautey se retrouve devant un dilemme, fournir des troupes à la métropole et garder une armée coloniale pour soumettre, pacifier dans le langage du colonisateur, les régions rebelles. Il envoie cinquante mille hommes au front et garde trente-cinq mille hommes qu(il met en scène dans une stratégie baptisée coquille d’œuf, une opération spectaculaire d’intoxication où la soldatesque se montre avec ostentation dans les zones sensibles, les défilés et les revues militaires. Guerre psychologique pour impressionner les marocains et décourager leurs velléités de résistance. Les français s’accrochent aux villes conquises, romancent leurs victoires et minimisent leurs défaites. Les soulèvements tribaux leur infligent malgré tout de grands revers. En novembre 2014, ils tombent à El Herri dans le piège de Moha Ou Hamou, chef de la tribu Zayane, et perdent en une seule journée 623 militaires.
Un premier contingent de 4 500 combattants marocains est engagé dans les opérations dès Août 1914. Un millier de spahis sont également présents en France avant de rejoindre, en 1917, l’armée d’Orient, et de se battre dans les rudes montagnes de la Grèce du Nord. Le Maroc entre officiellement en guerre aux côtés de la France en Janvier 1915 avec au total 40 000 soldats. La condescendance coloniale se souligne dans l’intitulé du détachement : « régiment de marche de chasseurs indigènes à pied », qui devient par la suite « régiment de marche de tirailleurs marocains ». Les marocains rechignent à voler au secours d’un pays qui les écrase et foule aux pieds leur dignité. Le recrutement autoritaire est de rigueur faute de volontaires, par l’intermédiaire du Maghzen, des caïds et des chefs de tribus ralliés aux français. Les jeunes réfractaires se réfugient dans les montagnes inaccessibles et les régions insoumises.
Les fantassins marocains démontrent leur courage et leur habilité manœuvrière dès la bataille de la Marne, participent, en première ligne, aux grandes offensives de l’Artois, de la Somme et de Verdun. Ils constituent les troupes de choc dans les attaques-surprises. Ils se faufilent en silence jusqu’au cœur des dispositifs adverses, neutralisent sans coup férir guetteurs et sentinelles, rapportent de leurs expéditions nocturnes des armes et des informations précieuses. Leur perspicacité, leur endurance, leur adaptation à tous les terrains les désignent pour accomplir les audacieux coups de main. Sur Le Chemin des Dames, ils percent les lignes allemandes avant de recevoir l’ordre de se replier parce que trop avancés. Les sacrifices sont lourds. Onze mille hommes, un quart de l’effectif, sont tués, blessés ou portés disparus. L’argile champenoise couve à jamais leur mémoire anonyme et nommée. Le journal Le Miroir du 20 Septembre 1914 titre en première page : « Nos braves tirailleurs marocains, dont les charges à la baïonnette sèment la panique chez l’ennemi, combattent en héros dignes de l’antiquité ». Renvoi insidieux à l’époque multiséculaire où le Maghreb était partiellement une colonie romaine. La domination occidentale depuis la Renaissance se légitime toujours par sa double filiation gréco-romaine et judéo-chrétienne en occultant la part civilisationnelle des autres cultures. Les faits d’armes des combattants marocains, ne sont aujourd’hui, de la même manière, évoquée dans nul article, dans nul discours. (Jean-Pierre Riera, Christophe Tournon, Ana ! Frères d’armes marocains dans les deux guerres mondiales, éditions Senso Unico, 2014).

L’énigme du temps dans l’œuvre
d’Ilham Laraki Omari
Par Mustapha Saha + photos



Au Salon d’Automne 2O18 de Paris, la toile d’Ilham Laraki Omari aimante les regards comme une interpellation métaphysique. Le titre du tableau, « Les Temps », évoque au pluriel les dimensions infinies de cette bande passante de l’éternité. L’œuvre se décline en trois plans décalés, incrustés de symboles insolites, emboîtement des quintessences active et passive, motrices des dynamiques vitales. Une aiguille sur cadran tourne à rebours. La circularité visuelle ouvre des interstices dans ses profondeurs. Le temps insère sa limpidité dans la double attraction cosmique et tellurique. L’artiste passe de l’autre côté du miroir pour intercepter les réverbérations chromatiques. La pensée du temps chamboule le temps de la pensée. Le temps n’est-il pas la vie dans son immuable continuité et sa diversité sans cesse renouvelée. Le temps se piste dans son arantelle connective.
L’œuvre exposée s’invite dans la conversation comme thématique sibylline. L’artiste n’est qu’un relais médiumnique, un messager de l’indicible. Des inspirations lointaines, indécryptables, le traversent, guident son œil, sa main, son corps et son âme dans leurs vibrations profondes, dans leurs pulsations fécondes. La méditation procure la réflexion philosophique consubstantielle à la transe artistique. Le temps de la création, quand la disponibilité s’y prête, se déploie dans son champ magnétique, sans bornes chronométriques. La vision comme un mirage se précise, et aussitôt se volatilise. Les images vagabondes se dissolvent dans leurs nuées génératives. Quand l’effervescence onirique, l’exaltation poétique, l’incandescence fantasmagorique enflamment les fibres sensibles, l’artiste se claquemure dans son refuge intime. Le corps à corps avec l’œuvre en gestation commence. L’émotion esthétique germine dans la frénésie créative. L’artiste se dérobe. L’œuvre d’indices s’enrobe. Ilham nous montre sur son portable un croquis pris sur le vif, avant qu’illumination ne se dissipe. L’encre, le fusain, la mine de plomb conjuguent leurs filigranes alchimiques. Une locomotive du temps traçant sa voie dans l’infinité sidérale. L’artiste capte des luminosités imperceptibles, des translucidités indiscernables, des limpidités indétectables que palette transmute en allégories transmissibles. Le langage pictural se divinise quand il transcode métaphoriquement l’intemporalité divine. La matière se spiritualise. La sacralité se sensualise.
S’évoque le concept de durée chez Henri Bergson, l’expérience vécue du temps hors programmation restrictive, l’intemporelle ondulation fluidique, l’imprévisible irruption créative. Les données immédiates de la conscience échappent aux prédéterminations cognitives. L’intuition s’embranche au temps de l’intérieur, coule dans ses modulations porteuses. La fausse dissociation du corps et de l’esprit, du matériel et de l’immatériel, s’estompe. L’invisible se sémantise dans la démultiplication de ses possibles. L’artiste, aventurier de l’irraisonnable, se jette dans le vertige de l’insaisissable. La complexité mouvante du temps, mystérieuse, mystique, dépasse ses fragmentations répétitives, ses quantifications limitatives, ses modélisations falsificatrices. L’œuvre d’Ilham exprime le temps organique dans ses manifestations fluctuantes et ses métamorphoses évolutives. La mémoire du futur, perçue dans sa plénitude subjective, fusionne le passé, le présent et l’avenir, une durée irréductible à « la mesure du mouvement, selon l’avant et l’après » (Aristote).
Ilham nous gratifie d’anecdotes savoureuses dans sa quête de montres tournant à l’envers. Les horlogers consultés, convaincus de l’impossibilité technique d’inverser les mécanismes, la prennent pour une sorcière. L’art a des motivations que le bon sens de l’artisan ignore. L’encastrement des plans signifie en l’occurrence la transition continuelle, la transformation perpétuelle, l’errance dans les tortilles sensorielles. Le tourbillon de convergence absorbe les permanences et les émergences. La sublimation plastique signalise les passages. L’interférence des causes et des effets anime la boucle rétroactive. Le temps, à l’instar de la boule de neige qui cristallise de nouvelles particules au fur et à mesure qu’elle dévale la pente, est une mémoire anamnésique. Toutes les pensées, toutes les actions s’y imbriquent et s’y impliquent pour ouvrir des perspectives inédites. Les interrogations initiales se creusent et s’approfondissent. Des antinomies s’accordent. Des paradoxalités s’assemblent. Des taches se transfigurent en motifs involontaires. Se profilent parfois d’étranges bestiaires, des paysages extraordinaires, des créatures surgis d’indéfinissables imaginaires. La muse parsème la peinture d’imprévisibilités déroutantes.
L’art, depuis ses origines, interroge le temps. « Trois mille six cents fois par heure, la seconde chuchote : souviens-toi »(Charles Baudelaire). Les sculptures et les peintures d’Ilham traquent le temps dans ses intermédiations machiniques et ses pigmentations iconiques. Les titres sont suffisamment éloquents. Le Sablier, La Roue, Le Chapelet, L’Engrenage, L’Empreinte du Temps, Le Tissage du Temps se posent comme jointures entre totalité métaphysique et relativité physique, cadence existentielle et polyrythmie spirituelle. L’artiste accède à l’essence du réel par la singularité de ses modèles. « C’est la vie intérieure des choses que l’artiste voit transparaître à travers leurs formes et leurs couleurs » (Henri Bergson, Le Rire). L’art, énergisé par les ondes intuitives, déborde l’intelligence utilitaire, transperce les limites de la connaissance, ouvre les chemins de l’absolu. La réalité se réalise au cœur du sensible, dans l’interaction de la perception, de l’expression et de la création. L’art nous plonge dans la sensation instantanée, contrairement au langage qui nous distancie. Ilham fait le même constat : « Le temps, je ne peux l’exprimer que dans mes œuvres. Dès que je le formule en mots, il s’évapore ».L’art, en connexion avec le temps dans son action créative, est un acte thaumaturgique de création. A chaque œuvre nouvelle adhèrent des sentiments nouveaux générés par l’œuvre elle-même. L’acte temporel s’y manifeste comme une création en rupture avec les fausses généralités de notre vie contingente. L’intensité émotionnelle suscitée par l’œuvre particulière, qui lui reste à jamais liée, nous révèle que nos sentiments relèvent d’une histoire ouverte. L’emprise affective de l’art alimente et conforte notre relation mystique à la vie.
© Mustapha Saha
| Garanti sans virus. www.avast.com |
4 pièces jointes
Nostalgie coloniale et diversité culturelle dans la mode parisienne
Par Mustapha Saha
Trois cents rues et bâtiments publics parisiens portent encore des noms célébrant la légende coloniale (Didier Epsztajn : Guide du Paris colonial et des banlieues Editions Syllepse, Paris 2018). La toponymie s’accroche à la postérité comme une mémoire honteuse, mais toujours présente. Les dénominations exotiques rappellent subliminalement les possessions françaises, les conquêtes épiques des territoires barbares, les glorieuses expéditions civilisatrices. « Le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. On fait allusion aux mouvements de reptation du Jaune, aux émanations de la ville indigène, aux hordes, à la puanteur, aux pullulements, aux grouillements, aux gesticulations. Le colon, quand il veut bien décrire et trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. » (Frantz Fanon : Les Damnés de la Terre, éditions François Maspero, 1961). Et pourtant, cette même histoire grouille de résistances, de révoltes, de luttes de libération. Quelques figures emblématiques sont, tardivement, immortalisées sur les plaques bleues, l’abolitionniste modéré Victor Schœlcher, le colonel Louis Delgrès, commandant de Basse-Terre, déserteur de l’armée pour combattre les troupes bonapartistes voulant rétablir l’esclavage, l’Emir Abd El Kader, Toussaint Louverture. « Peuple français, tu as tout vu / Oui, tout vu de tes propres yeux / Et maintenant vas-tu parler ? / Et maintenant vas-tu te taire ? » (Kateb Yassin : La Gueule du loup, 17 Octobre 1961).
La nostalgie est un retour sur la douleur, une tentative désespérée de revivre, dans la sublimation mémorielle, les temps bénis où le colon, du fait même qu’il était colon, indépendamment de sa position sociale, était le maître absolu, où l’autochtone, du fait même qu’il était autochtone, était l’indigène infériorisé, déshumanisé, animalisé (Albert Memmi : Portrait du Colonisé, précédé du Portrait du colonisateur, préface de Jean-Paul Sartre, éditions Gallimard, 1957). Cette nostalgie coloniale s’inscrit comme légitimation historique dans les luttes politiques actuelles avec la remontée idéologique du fascisme, la banalisation du racisme, les offensives électorales des populismes. Les nouvelles guerres orchestrées par l’occident livrent leurs réfugiés comme victimes expiatoires. Le regret du paradis perdu se perpétue comme un vestige générationnel, hanté par des fantômes prompts à réinvestir les temps présents. Le revanchard mélancolique se perçoit comme un héros romantique « contraint de commettre le mal par nostalgie d’un bien impossible (Albert Camus : L’Homme révolté, éditions Gallimard, 1951). La nostalgie politique, la manie commémorative, l’obsession sécuritaire remplissent le vide utopique, la vacance cognitive, l’insignifiance philosophique. Les ruines se valorisent, non point comme savoirs archéologiques, mais comme attractions touristiques, distractions pittoresques, décors ubuesques d’expéditions sans risques. Au XVIème siècle, Michel de Montaigne, penseur de la laïcité diversitaire, critiquait déjà la vanité des mauvais voyageurs, enfermés dans leur égotisme, indifférents aux découvertes enrichissantes. Le syndrome de fatuité et le complexe de supériorité s’entretiennent toujours comme catalyseurs de la xénophobie dévastatrice.
La mercatique festive vend aujourd’hui les soirées safaris clefs en mains, avec leurs costumes exotiques, leur savane fictive, leurs panthères factices, avec le même message d’encanaillement sauvage que les revues cabarétiques des années folles. Nouvelles technologies obligent, lions, tigres, hippopotames, girafes, éléphants, zèbres, crocodiles, indigènes armés de lances préhistoriques et grands sorciers vaudous se projettent grandeur nature sur les murs. Les marabouts et les fakirs en invités vedettes se sollicitent. Des ambiances bestiales se suggèrent sous kugurumi de tigre ou de léopard. Femmes des cavernes sous perruque afro, serre-têtes en os et boucles d’oreilles en crocs, dans sa tenue zouloue en raphia naturel, rallument les désirs oubliés.
La collection 2019 de Léonard s’estampille d’images coloniales.La désuétude allège les temps regrettables de leurs empreintes insoutenables. Le sortilège juxtapose et superpose fantasmagories asiatiques et sorcelleries africaines. Le pantalon rococo taquine la jupe polynésienne. Les teintures ancestrales puisent leur rouge profond dans les terres lointaines. Les stylistiques Masaï, leurs ostentations cérémoniales et leurs parures nuptiales, leurs magnificences vestimentaires et leurs pictogrammes ornementaires, transmettent subrepticement, au-delà de leur récupération luxueuse, leurs codes magiques. Les chevelures se tressent. Les codes se transgressent. Les corps se décontractent dans les tenues oniriques. Ainsi en est-il des emprunts dans la haute couture, l’altérité se sublime ou se folklorise et s’élime. La saharienne est entrée dans la mode par effraction, réhabilitée, purifiée de ses immaculations sanguines, par Yves Saint Laurent en 1968. La gabardine de coton, consacrée par des reportages dithyrambiques, conquiert les silhouettes féminines, devient, par un extraordinaire retournement sémiotique, synonyme de liberté et de séduction.
Pour Manish Arora, la mode est une fête planétaire, pétillante de bonne humeur, croustillante d’imprévisibilités malicieuses, foisonnante de symboliques africaines, indiennes, égyptiennes, gitanes, nippones, saisies dans leurs synergies vivifiantes. Une douce folie psychédélique, intemporelle, où les traditions ludiques épousent les utopies nordiques. L’imagination pétulante explose en couleurs et en formes extravagantes. Les ceintures et les écharpes emmitouflent la taille et le cou dans des martingales serpentines. Les arabesques, les chamarrures, les fioritures déclinent leur sémantique diablotine. Les cœurs s’étincellent dans les étoiles. Baskets sur semelles compensées, socquettes aux géométries contrastées, sacs à main incrustés d’yeux projecteurs de rayons laser, textures phosphorescentes, breloques et fanfreluches fluorescentes, la féérie carnavalesque fait irruption sur les podiums. La diversité culturelle irradie l’atmosphère de son mystère alchimique.
Mustapha Saha.
Sociologue, poète, artiste peintre.






*



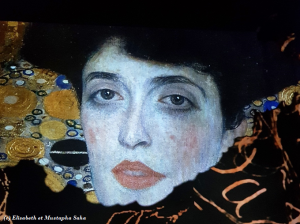

LA FEERIE KLIMT A L’EPREUVE DU NUMERIQUE
PAR MUSTAPHA SAHA
Dans le premier Centre d’Art Numérique de Paris dénommé Atelier des Lumières, la visite dite immersive dans les œuvres de Gustav Klimt, d’Egon Schiele, de Friedensreich Hundertwasser, projections multidimensionnelles mues par les musiques de Frédéric Chopin, de Gustav Mahler, de Richard Strauss, peine à se transmuter en voyage onirique. Des surfaces gigantesques sont balayées, en flux continu, par des couleurs hallucinantes. L’ancienne fonderie Plichon, conservée dans ses structures métalliques, ne réussit pas à se transformer en vaisseau cosmique. Le sol, foisonnant d’innombrables fleurs colorées, ne se métamorphose pas en jardin édénique. Les corps emportés dans une spirale infernale, submergés de sensations volatiles, se laissent noyer dans les fontaines chromatiques. Une formidable opération de marketing culturel qui draine, en quelques mois, des centaines de milliers de spectateurs. Inutile d’espérer en sortir, qu’on soit néophyte ou connaisseur, imprégné de la véritable féérie Klimt.
L’art de Gustav Klimt, convulsé par des fondus enchaînés, des travelling circulaires, des fondus enchaînés, des zooms déchaînés, garde jalousement ses chiffres illisibles et ses paraboles invisibles. Les motifs décoratifs auréolent l’enceinte de coupoles factices. Les muses, Adèle Bloch-Bauer, Fritza Riedler, femmes fatales parées de bijoux somptueux, se réincarnent en poupées cybernétiques. Cent quarante vidéoprojecteurs ajustent leurs trois mille clichés numérisés à chaque pan de béton, parterre et plafond compris. Les images défilent en mitraille. Les visiteurs assis par terre, regards hypnotisés par le feu d’artifice, semblent tétanisés par les vagues lumineuses. Un détail minuscule sur une robe dans le tableau L’Espoir, triangle sans intérêt quelconque, agrandi démesurément, se vante comme un voilier imperceptible. La supercherie intellectuelle justifie comme elle peut son insignifiance. Le patchwork numérique déstructure les constructions initiales, décompose et recompose les éléments infimes, rentabilise l’effet spectaculaire. Nul besoin d’experts pour décrypter l’éphémère. Chacun se forge son interprétation personnelle. Dans la salle des miroirs, le vieux bassin reflète le tourbillon hologrammique. On se prend à rêver de nénuphars impressionnistes s’illuminant comme étoiles, de tournesols vangoghiens explosant comme soleils. On voudrait sauter comme Mary Poppins à pieds joints dans les tableaux. Nulle interactivité ne permet l’initiative. Les dés sont pipés dans le montage. On se promène dans un espace clos, minutieusement balisé. Demeure la décontraction récréative. Aucune alarme ne sonne quand des enfants courent derrière les formes fuyantes, jouent avec les apparitions – disparitions des figures, quand des couples entament un mouvement de valse. Certains chuchotent, d’autres conversent bruyamment, personne ne s’en offusque. Au bout du parcours, le sensationnel tarit l’émotionnel. L’esprit critique décroche dans ce drôle de navire. L’œil s’émerveille et chavire. La débauche psychédélique ne laisse qu’un agréable sentiment d’une escapade ludique.
A la fin du dix-neuvième siècle, Gustav Klimt acquiert sa renommée en achevant, au pied levé, les fresques historiques du Kunsthistorisches Museum après la disparition de Hans Makart. La Sécession viennoise, à l’instar de l’Art Nouveau, n’a-t-elle brisé les barrières entre Beaux-arts et Arts décoratifs, et proclamé l’art total comme libération esthétique ? Gustav Klimt, exalté par l’Hymne à la joie orchestré par Richard Wagner, crée la Brise Beethoven, dans une plastique symphonique de trente-quatre mètres sur deux. Luxuriance ornementale, profusion florale, figures sacrales. Les ondulations aurifères, les oscillations vibratoires, les miroitements des éclats de verre, accentuent la translucidité fascinatoire. Les paysages propices à la contemplation, loin de l’agitation sociale, dispersent leurs couleurs primaires en petites touches comme frémissantes étincelles. Egon Schiele, le disciple, se démarque très vite du père spirituel, décline, a contrario, ses autoportraits, taraudés par une angoisse insurmontable, ses personnages faméliques, ses arbres mélancoliques, dans la sobriété des lignes et la brutalité des signes.
L’art vidéo se manifeste comme détournement des techniques télévisuelles dès les années soixante. L’artiste sud-coréen Nam June Paik (1932 – 2006), membre du groupe Flexus, inspiré par les compositions sur bruits naturels de John Cage, expose treize téléviseurs munis d’aimants pour distordre les images. Il s’agit, en perturbant la relation addictive du spectateur au petit écran, de provoquer un électrochoc psychologique, une prise de conscience de l’aliénation audiovisuelle. Le père fondateur l’art vidéo le définit comme un art de l’espace et du temps absolus, exigeant une grammaire exigeant une grammaire exclusive et une grille de lecture incisive. L’art vidéo bascule dans la déconstruction kaléidoscopique et la mobilité rhizomique. Son fondateur le définit comme un art de l’espace et du temps absolus, avec une grammaire exclusive et une grille de lecture incisive. Nam June Paik invente, par la suite, avec l’ingénieur japonais Shuya Abe un synthétiseur éditant simultanément sept vidéos différentes où les couleurs sont perpétuellement mixées et modifiées. L’écran devient une toile mouvante pour une nouvelle génération d’artistes électroniques. Le concepteur déclare : « Cette technique nous permet de façonner l’écran aussi librement que Pablo Picasso et aussi précisément que Léonard de Vinci. »
La télévision, objet culte de la société de consommation, outil imparable de manipulation médiatique, est sabordé de l’intérieur par l’extension de ses potentialités artistiques. En 1967, Nam June Paik et la violoncelliste Charlotte Moorman sont arrêtés par la police pendant la représentation de l’opéra Sextronic où la musicienne fait courir son archet le dos nu de son alter ego. Autant de signaux, avec la spontanéité dramaturgique du Living Theatre et la littérature de la Beat Generation, annonciateurs de la révoltion planétaire de 1968. Les deux acolytes produisent, en cette même année, TV Bra où Moorman porte deux écrans miniatures en guise de soutien-gorge. Electronic Superhighway présente, plus tard, un assemblage de trois cents téléviseurs dans des néons traçant la carte des Etats-Unis. Les images filent à toute vitesse. Se suggère une perte de mémoire de la superpuissance américaine, qui n’a pour ultime recours que la fuite en avant. Paik associe à la fin du siècle l’audiovisuelle à la robotique, sachant pertinemment que la fée électronique peut se révéler la pire mégère. Pointent à l’horizon les spectres destructeurs et les présages émancipateurs. N’est-ce pas par l’art, cet avatar de la vie, insaisissable, ironique, ouvert sur l’imprévisible, que l’humaine humanité soumet les technologies au lieu d’y être soumise ? L’intelligence artificielle a beau concurrencer le génie humain sur le terrain de la création, les algorithmes ne produisent que des œuvres machniniques.
La technologie multimédia du mapping vidéo, ou fresque lumineuse, redonne aux architectures sacrées leur divine splendeur. La peau virtuelle épouse en parfaite syntonie le relief naturel. Les merveilles antiques, égyptiennes, grecques, byzantines, n’étaient-elles pas lustrées de belles couleurs ? Des logiciels spécifiques reproduisent en grande dimension sur façades de cathédrales des volutes captivantes, des figurations envoûtantes, des arabesques ensorcelantes. Chartres en Lumières se donne en exemple emblématique Les parcs d’attraction font grand usage de cette technique attractive. Des campagnes publicitaires abusent de l’impressionnante visibilité pour inonder les villes dans leurs messages insipides. Au-delà des exploitations mercantiles, les projections mapping sont devenus des médiums artistiques à part entière. Des scientifiques ont conçu sur ce principe un espace de travail ubiquitaire reliant, en temps réel, des bureaux situés aux quatre coins de la planète. Des artistes ingérables, des activistes indésirables, des saltimbanques irrécupérables, utilisent l’art technologique public comme arme de guérilla culturelle. Le nouveau monde en germination fleurit d’expressions inédites.
Mustapha Saha.
Sociologue, poète, artiste peintre.
Les dernières photos de Rachid Taha merci Mustapha



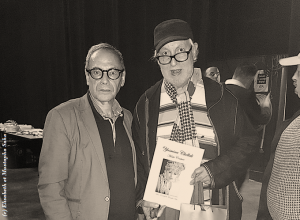

NASS EL GHIWANE
MERVEILLEUX COLPORTEURS DES POETIQUES POPULAIRES
PAR MUSTAPHA SAHA
Concert de Nass El Ghiwane à Epinay-sur-seine dans la région parisienne. Je retrouve Omar Sayed avec sa canne d’inépuisable pèlerin, sa gestuelle chaleureuse, sa parole savoureuse, sa pudeur valeureuse. La mémoire partagée se promène dans le backstage comme une ombre. S’interpellent en quelques mots les décennies claires et sombres. Se rappellent le terrain Hofra (le trou), sa fameuse équipe de football et son école franco-musulmane, Derb Moulay Cherif et son cinéma niché dans une misérable bâtisse, les baraques du marché ravagés par des incendies récurrents, les vendeurs à la sauvette pourchassés comme indésirables concurrents. Se convoque le souvenir des fertilisantes pépinières, Dar Chabab (La Maison des Jeunes), ses ateliers de création artistique, et la troupe de théâtre pionnière, Hilal Dahabi (La Lune dorée), les spectacles éphémères dans les terrains vagues, les folles illuminées échappées de la mer, les poètes vagabonds prophétisant les lendemains amers. Des vocations exceptionnelles germinent, en ces lendemains de l’indépendance, dans le terreau des souffrances. Dans ce quartier sans pareil, la générosité puise ses ressources dans la misère. Une vie sociale fourmillante de mille activités insolites, des écoles et des mosquées dans des baraquements de fortune, des bazars spécialisés dans les commerces ordinaires et extraordinaires, des officines de voyantes et de cartomanciennes, Une économie de récupération qui recycle sans cesse le jetable et redistribue le périssable. L’imposant cinéma Saâda déroule en continu des peplums italiens, des mélodrames égyptiens, des guimauves indiennes dans une salle enfumée, secouée de cris, de rires, de disputes, de bagarres. Les familles honorables se clouent contre les murs sous gros bras du père. Se ravive comme une incurable blessure la sinistre geôle des tortures.
Les maisons démolies se reconstruisent autrement.
Les champs brûlés refleurissent plaisamment.
Mais les enfants morts de faim douloureusement.
Mais les esprits libres suppliciés cruellement…
Qui ressuscitera les disparus définitivement ? *
A peine un an après sa création, le groupe est interrompu en pleine concert par la police, embarqué manu militari pour s’expliquer sur leurs chansons allusives. L’énigmatique disparition de Boujemaa en pleine jeunesse ouvre une série noire de malédictions que son alter-ego Omar surmonte de tranquille manière. Les musiciens meurent ou cèdent. Les générations se succèdent. Le cri vibratoire demeure, brave depuis des décennies le destin vexatoire. Sisyphe régénère sans cesse son nerf lexical pour lancer l’alerte au sommet du Toubkal.
Où m’emmènes-tu mon frère, où m’emmènes-tu ?
Les faucons dans leur tour sont toujours orgueilleux.
Les serpents dans leur tanière toujours sourcilleux.
Les loups dans leur guérite toujours pointilleux.
Les coqs dans leur cage toujours sommeilleux.
Les gueux dans leur masure toujours pouilleux.
Les astres dans la voûte atlasienne toujours merveilleux…
Où m’emmènes-tu, mon frère, où m’emmènes-tu dans cet exil périlleux ? *
La lucidité pessimiste se constelle de fenêtres d’espérances.S’annoncent longtemps avant les printemps arabes, leurs automnes de crabes, leurs hivers en pénitence, leurs étés en latence. Le devenir se façonne dans les ateliers d’art. Pour apprendre à vivre, il n’est jamais trop tard. Al Alyam Tounadi (Les Jours nous interpellent) résonne en concordance avec le fameux slogan soixante-huitard : cours camarade, le vieux monde est derrière toi.
S’illumine montagne d’un nouveau solstice.
Tant de sacrifices pour une paix factice.
Dans les ténèbres que vaut l’armistice.
Glisse tes ailes naissantes dans l’interstice.
Laisse dans leur obscurantisme les temps d’injustice. *
La rencontre avec le dramaturge Tayeb Saddiki, magistral rallumeur de la flamme mejdoubienne, détecteur incomparable des prometteuses lueurs, ensoleilleur d’inextinguibles bonheurs, est décisive. Le monstre sacré galvanise et protège les secoueurs des consciences endormies. S’enrichit le répertoire de précieuses qassidas mystiques. La rhétorique incisive démasque le visible. La poétique décisive taquine l’invisible. Nass El Ghiwane s’assimilent dès lors, dans l’imaginaire collectif, aux derviches soufis, porteurs d’histoires légendaires, sentinelles d’énigmatiques lampadaires, transmetteurs d’arcanes solidaires. La censure et la persécution les conforte dans leur rôle messianique.
Omar s’installe lentement sur une chaise comme un chef de village. Son allure irradie la sagesse tribale. Le phénix se sanctifie dans sa stature patriarcale. Ses compagnons synchronisent les derniers réglages. L’atmosphère s’électrise avant décollage. Des spectatrices quittent leur siège par dizaines, se bousculent, se piétinent devant la scène, se déhanchent, se dandinent dans une fièvre incontrôlable. Les percussions décrochent les corps de leur attitude raisonnable. S’embouteillent au-dessus des têtes les téléphones portables. Chacune veut rentrer avec son butin d’images pour sa vitrine facebookienne. S’écroule protocole. S’éboule rempart. Se dissout message dans l’hystérisation banale. S’agitent banderoles nationales. La diaspora s’accroche à ses racines comme elle peut. Elle n’a par expérience qu’une certitude, son errance ne mène sa descendance nulle part. S’achève le récital. Une chanson se réclame avec insistance, Mahmouma (Tourments).
Que de tourments, mon frère, que de tourments.
Ce monde n’est qu’un manège de tourments.
Les âmes se débattent dans leurs rabaissements.
Le mauvais sort guette à chaque moment.
Les pauvres s’épuisent dans l’accablement.
Les prisons s’emplissent de garnements.
Les officines distillent leurs empoisonnements.
Le pouvoir prospère dans l’ensanglantement.
Les riches s’innocentent de leurs égarements.
Que de tourments, mon frère, que de tourments.
Console-toi, mon frère, de tes gémissements. *
Aux commencements, trois garçons pauvres, Omar Sayed, Larbi Batma et Boujemaa Hagour, portés par la richesse incommensurable de leurs rêveries musicales, dans la commune périphérique de Hay Mohammadi, anciennes Carrières Centrales, de Casablanca, gouffre aspirateur de l’exode rural, urbanité grouillante de bidonvilles, réserve de bras corvéables dans l’immense zone industrielle, foyer de résistance contre le colonialisme. Le groupe se baptise Nass El Ghiwane, belle correspondance avec troubadours. L’inspiration s’immerge dans la culture populaire, les complaintes protestataires contre les oppressions quotidiennes, les mélopées contestataires contre les tyrannies makhzénniennes. Les membres du groupe sont en même-temps écrivains, poètes, dramaturges, acteurs, musiciens, chanteurs, chroniqueurs saisissant sur le vif les éclats sublimes des existences ordinaires, les saillies éblouissantes des passants débonnaires, les imprévisibilités étourdissantes des destinées stationnaires. Larbi Batma, muni, en toute circonstance, de son carnet de notes, invite chez lui les mendiants versificateurs, recueille leurs vers blasphémateurs, féconde ses compositions de leurs délires novateurs. Le trimardeur Ba Salem lui souffle la thématique d’Essiniya (Le Plateau de thé).
Où sont passés mes proches bienveillants ?
Où sont passés mes amis émerveillants ?
Où sont passés les plateaux de thé pétillant ?
Que sont devenus mes gîtes accueillants ?
Que suis-je devenu sur mon chemin déraillant ?
J’ai suivi les beaux mirages vacillants.
Les mauvais augures les présages oscillants.
Les fous désirs les plaisirs souillants.
Me voilà triste galvaudeux rimaillant.
Ne me reste qu’aigre brûlure de thé bouillant. *
Le bendir, le hajhouj et la snitra fusionnent avec le banjo, tressant des passerelles secrètes avec le folksong américain. Esclaves de tous les pays, chantez ensemble, arrachez votre délivrance. Le regard se porte au grand large. Martin Luther King assassiné s’affiche sur les plages. Le morceau Ya Sah se retrouve dans le film La Tentation du Christ de Martin Scorsese.
Quartier navire en perpétuel tangage. L’esprit rebelle se transmet dans la posture et le langage. Les réussites dérivent au premier appel des sirènes. Des femmes voilées et non voilées, hystérisées sous banderole, se piétinent et se déhanchent sans contrôle. Les voix se développent, se syncopent en cascades incantatoires. La prosodie jazalienne clame et déclame la misère morale des damnés de l’indépendance jusqu’à se fondre dans la rythmique gnaoua et la transe libératoire. Retentit pendant les années de plomb, comme un tonnerre, dans la chansonnette plébiscitaire et l’allégeance résignataire, la rhapsodie de la colère. Des chants mythiques repris en chœur, à peine entamées, par le public en communion conjuratoire.
© Mustapha Saha
Sociologue, poète, artiste peintre
*Adaptations allégoriques en français des chants ghiwaniens par Mustapha Saha



JEAN-PAUL GAULTIER ET L’ETERNEL RETOUR A L’ANDROGYNE
PAR MUSTAPHA SAHA
Tout l’art de Jean-Paul Gaultier se transcende dans ses audaces transgressives. Sa collection automne-hiver 2018 – 2019 resublime la cigarette dans ses volutes jouissives, ses vapeurs envoûtantes, ses spirales fuyantes. La cigarette nargue en beauté la damnation sanitaire et se métamorphose en joailleries merveilleuses. Les mannequins, pipes et fume-cigarettes glissés dans les doigts, jaillissent d’un écran translucide, traversé de nuées interdites. Des sillons fantomatiques prennent l’allure d’hologrammes oniriques. Se profilent dans les dominantes noires et blanches, des silhouettes androgynes, alternances d’ombres et de lumières, d’opacités brillantes et de transparences scintillantes. Le yin et le yang s’emboîtent dans la complétude. Les poitrines se dévoilent sous membranes cristallines. Les têtes s’enferment, comble d’autodérision, dans des fumoirs personnels intégrés. Le slogan « tétons libres » s’imprime sur plastique pellucide porté à même la peau. « Free the nipple » pour tous ! La liberté balaie sans coup férir les fausses pudeurs. La morale, sous ses masques étouffants et ses pull-overs bouffants, ravale ses raideurs. Jacques Esterel s’évoque en subtile gratitude. Les smokings déstructurés, tantôt robes asymétriques, tantôt toges romaines, tantôt shorts anachroniques, déploient sans complexes leurs ailes archangéliques. Vestes croisées et collants classiques se conjuguent aux tarbouches revisités. Les codes vestimentaires, les références culturelles, les repères symboliques s’amalgament, se métissent, s’hybrident. Les extravagances baroques et les excentricités révolutionnaires butinent leur miel tous azimuts, dans les passés glorieux et les devenirs mystérieux. S’immiscent des sarouals perlés de poussière diamantine. Des calligraphies serpentines s’incrustent dans sombres opalescences. Jacques Higelin chante en fond sonore : « Je suis amoureux d’une cigarette / Je l’aime bien épaisse / Roulée comme une papesse / Dans son fourreau zigzag à bord gommé ». Le mot « cigarette » ne provient-il pas étymologiquement de l’espagnol « cigarar », rouler en forme de papillote (Littré). Et voilà la cigarette qui papillote des paupières et scintille comme une paillette. La robe de mariée, en organza vert d’eau, flottante et séraphique, est un nuage de tabac en sinueuse évanescence. Jean-Paul Gaultier déroule, mine de rien, la philosophie platonicienne de l’unité de l’être dans sa plénitude et sa circularité. Les costumes sont taillés sans distinction de sexe. « L’homme est une femme comme les autres ». L’élégance n’a pas de genre. Recherche esthétique de l’indivisible état d’origine. Le rouge et le noir signent le libertarisme salutaire.
Mustapha Saha
Sociologue, poète, artiste peintre

DU GOLEM DE PRAGUE AU CYBERNANTHROPE
PAR MUSTAPHA SAHA
Le Golem de Prague ou l’ancêtre du robot
Prague en hiver exhale des clartés brumeuses de pratiques occultes, des musiques ensorceleuses d’étranges cultes, des traînées luminescentes d’invisibles catapultes. Des silhouettes fantomatiques s’engouffrent dans des trappes. Les pierres se subliment et se sanctifient, s’illuminent et se codifient, s’incarnent et se personnifient. Les œuvres de dissolution, de purification, de transmutation s’accomplissent dans l’obscurité des temples secrets. Dans le dédale des ruelles phosphorées par les clochetons de la Tyn, les lueurs dansantes et les aspioles pensantes, s’évaporent les contours de l’espace et du temps, se promènent, dès la tombée de la nuit, les fantômes suprasensibles du passé et les esprits invisibles du présent, se libère l’imaginaire des entraves de la raison, s’incarnent des êtres surgis du néant dont le golem devient la figure emblématique. Franz Kafka confesse : « Une fois de plus, j’en suis certain, je peux entendre le doux battement des tambours sous la terre, et je ne suis toujours pas en mesure de trouver une explication à cet étrange phénomène ».
La voie royale, ponctuée d’architectures et de sculptures ésotériques, s’ouvre aux pérégrinations mystiques. La Ruelle d’Or est ainsi nommée parce s’y regroupaient de nombreux laboratoires d’alchimistes. L’ancienne cité médiévale, en perpétuelle reconstruction, juxtapose, conjugue, fusionne les époques et les langages dans son enchanteresse débauche baroque. Les rénovations et les restaurations jouent des jointures et des emboîtures, des aboutages et des sertissages, des judicieuses articulations et des malicieuses synchronisations. Palimpseste urbanistique où les novations se nichent dans les transmissions et les successions minérales. La façade rose du centre commercial du palladium, avec ses fenêtres en trompe l’œil, théâtralise la raison commerçante, l’humanise de beauté au-delà des manipulations publicitaires. Ici, les prouesses techniques ne se justifient que par leur apport artistique. La « maison qui danse » de Franck Gehry incruste féériquement son déconstructivisme dans les vieilles façades. Les peintures et dorures Art nouveau de la Maison municipale, abritant l’opéra et la séculaire Tour poudrière, illustre la merveilleuse fusion des styles et l’irrésistible magnétisme des transfigurations patrimoniales. Dans cette mosaïque d’écritures paradoxales, les géométries élémentaires du cubisme elles-mêmes se matérialisent et s’infiltrent dans les sibyllines structures. L’église rococo de Trojice (1713) est ainsi reliée au palais cubiste Diamant (1912) des architectes Matej Blecha et Emil Kralicek. Dans la capitale de la Bohême tout se réorganise, tout se syntonise, tout se divinise.
Ici, l’art, sous toutes ses formes, illustre dans chaque recoin les mythologies urbaines et les légendes lointaines. Les jardins et les bâtiments offrent au regard médusé leurs fresques satinées, leurs moulures raffinées, leurs bronzes patinés. Les stations de métro, richement décorés, sont autant de spectacles oniriques. Prague, née d’une glaise culturelle miraculeuse, s’énergise, se féconde et se fertilise dans la culture. Ses concepteurs, ses créateurs, ses penseurs se célèbrent et s’immortalisent sur les places publiques. Leurs bustes et leurs statues irradient leur inextinguible flamme poétique. Dans cette urbanité labyrinthique, les configurations duelles se transforment à chaque carrefour en sensualités visuelles. Le monument dédié par le sculpteur Stanislav Sucharda à l’historien František Palacký (1798 – 1876) le représente en sage vénérable, dépositaire de la mémoire de la ville. L’« Histoire du peuple chèque en Bohême et en Moravie », référence incontournable, explique comment cette culture bohémienne s’est édifiée sur terre tchèque dans une lutte incessante entre imprégnation slave et influence germanique. Aspirations à la liberté et légitimation des autorités, dynamique des créations et pesanteur des traditions, conquêtes du rationalisme et contre-attaques du conservatisme, cadencent les avancées et les régressions. La villa de Stanislav Sucharda, construite à l’aube du vingtième siècle par l’architecte Jan Kotěra, devenue un musée, dévorée par les lianes arbustives et les chimères végétative, ressemble aux maisons hantées des sagas romantiques. Un certain mois de mai 1902, Auguste Rodin se retrouve invité en grande pompe à Prague avec une exposition rétrospective dans un pavillon spécialement conçu pour l’événement. Pendant ce voyage homérique, Auguste Rodin, accompagné de ses amis artistes Alphonse Mucha, Rudolph Vacha et Joseph Maratka, est porté en triomphe par la foule comme un dieu vivant. Le nom du sculpteur français est, depuis lors, inscrit en lettres d’or dans la mémoire locale.
Sur le chemin du quartier juif Josefoy, un restaurant exhibe l’enseigne évocatrice « U’ Gòlema » (Le Golem). Au XVIe siècle, durant la « guerre des trente ans » sous Rodolphe II, Prague vit sa période magique et légendaire malgré les pogroms périodiques. C’est ainsi que le Rabbin Loew crée le Golem pour protéger le ghetto des persécutions. Le rabbin se double d’un mage. A l’instar de la déesse Aphrodite insufflant la vie dans la sculpture Galatée de Pygmalion, le Ba’al Shem (patron du nom), anime sa statue de terre en prononçant l’un des noms secrets de Dieu. Un être surnaturel, doué d’une force surhumaine. Le Golem s’autonomise au point de se rebeller contre son Maître qui finit par le détruire.
Le rabbi Juda Loew ben Bazalel, dit le Marahal (abréviation deMorenou HaRav Loew : notre Maître Loew), descend d’une famille andalouse expulsée de la péninsule ibérique. Mystique, philosophe, talmudiste, il s’intéresse autant à l’exégèse religieuse qu’aux sciences profanes et produit, tout au long de sa vie, une œuvre abondante, des commentaires savants de la Torah, des traités d’éthique. Il entreprend de restaurer les valeurs essentielles du Talmud et de la Gémara, notamment dans Beer Hagola (Le Puits de l’exil) et dans Nétivot Olam (Les Sentiers des temps antiques) (André Néher : Le Puits de l’Exil, la théologie dialectique du Marahal de Prague, éditions Albin Michel, 1962). Il révolutionne les méthodes pédagogiques des instituts talmudiques (Yeshevot) en instituant l’apprentissage de la Torah, de la Mishna et de la Gémara dans un ordre de compréhension et d’explicitation accessible aux clercs et aux néophytes, en rendant aux traditions leurs mérites dans la perpétuation orale de la Torah et en se donnant comme imperturbable ligne de conduite la clarté et l’authenticité. Auteur de la fameuse formule laïque « En aucun cas la Torah et la science ne peuvent entrer en conflit puisque leur domaine n’est pas le même », le Rabbin Juda Loew entretient des liens d’amitié avec d’éminents savants, notamment l’astronome Tycho Brahe, et s’assure la collaboration du mathématicien David Gans. Ces deux scientifiques sont en même temps astronomes et astrologues, scrupuleux laboureurs des champs physiques et fiévreux explorateurs des incommensurabilités métaphysiques. Le Golem surgit comme une réponse fantastique à une crise intellectuelle annoncée. La lumière ésotérique révèle de ses feux ténus l’âge sombre. La révolution cartésienne a instauré séculairement la prédominance de l’analyse désintégrative sur la synthèse connective, de la fragmentation matérielle sur la globalisation spirituelle, de la fermeture opérative sur l’ouverture contemplative. Avant la modélisation de l’universalisme occidental comme unique référence et unique paradigme, le moyen-âge européen, rejeté d’un bloc dans les poubelles de l’histoire, regorgeait de mille héritages initiatiques définitivement perdus.
En 1584, le Marahal encore simple directeur de la Klaus (synagogue-école), n’est pas élu au poste de grand rabbin de Prague parce qu’il fait juste avant son sermon de shabbat du repentir sur la médisance, ce venin de la parole qui pervertit le don le plus précieux du ciel, le verbe, et dépossède la victime de sa réalité humaine. L’assistance préfère un guide des consciences plus indulgent pour leurs âmes enclines, par jouissive méchanceté, à dénigrer le prochain. Le Rabbi Loew est reçu au château Nuremberg, par l’Empereur Rodolph II. L’entretien demeure sous le sceau du secret, mais le projet d’expulsion des juifs est annulé. Cinq ans après cette rencontre décisive, qui évite à cette communauté un nouvel exil, le Marahal est élu Grand Rabbin de Prague pour un long mandat jusqu’à sa mort en 1609 à presque cent ans.
En araméen, le vocable Golem signifie matière inerte. Le Talmud le cite dans la narration biblique de la Création. Selon cette tradition, le Golem est un embryon humain au stade primordial, tiré de la boue avant le souffle vital. “Douze-heures eut le jour, durant la première la terre fut accumulée, durant la deuxième, il devint Golem…, durant la quatrième l’âme entra en lui…” (Talmud Babylonien). Dans le Triangle de la Magie (Prague, Milan, Londres), alchimistes, rabbins et kabbalistes se sont évertués à transmuter le plomb en or et les entités imperceptibles en corps palpables. Aux commencements l’alphabet. L’empreinte sacrée se manifeste par le verbe. Sur le front du Golem s’incrustent en lettres de feu les signes kabbalistiques Aleph, Mem et Thau du premier homme, Adam. Ces signes psalmodiés se transforment en Emet, vérité. Dans tous les cas, dès qu’on efface la lettre Aleph, le Golem se désintègre comme un robot désactivé. La combinaison des lettres Mem et Thau donnent Met, la mort. Le Golem relève, de ce fait, de la terrible magie noire qu’Eliphas Levi nomme Goetia.
Trois siècles plus tard, paraissent à Piotrkrow Les Actions merveilleuses du Marahal avec le Golem (Nifla’ot Maharal im ha-golem), qui se présente comme une copie d’un manuscrit retrouvé de Rabbi Isaac Cohen, gendre de Rabbi Lowe. Le récit révèle comment une anse argileuse de la Vltata se transfigura en forme humaine, douée de vie par la force de la méditation et de la prière. Le mot hébreu Golem n’apparaît qu’une seule fois dans une version de la Bible : « Je n’étais qu’un germe (golmi) informe, et tes yeux me voyaient ». Le Talmud de Babylone évoque un rabbi qui créa un homme. Cette légende est vivace au Moyen-Âge. Dans le livre, il reçoit un nom, Yossele. C’est un demeuré qui n’obéit qu’à son créateur. Mais il protège la nuit le ghetto d’intrusions malveillantes et permet à tous de dormir tranquilles. Depuis que le Maharal a mis fin à la vie de sa créature. Le Golem gît dans le grenier de la synagogue vieille-nouvelle dont l’accès est aujourd’hui condamné. Beaucoup de lecteurs se laissèrent prendre à l’agréable supercherie et crurent à l’authenticité du manuscrit. En vérité, le véritable auteur du livre est Yehuda Yudl Rosenberg (1859 – 1935), rabbin de Varsovie, qui, sachant le peu de crédit que ses contemporains accordent à la fiction, préfère déguiser en documents ses œuvres imaginaires. En 1919, Chajim Bloch traduit son livre en allemand, l’adapte en feuilleton puis en livre sous sa propre signature. La version anglaise de cette adaptation sort en 1925 et devient aussitôt un best-seller. Chajim Bloch accable le golem d’un caractère monstrueux et inquiétant pour justifier sa désactivation par son créateur. Un vendredi soir, le Maharal aurait oublié de le paralyser et le Golem aurait alors commencé à détruire le ghetto. Il aurait pu détruire la création tout entière si Rabbi Loew n’avait réussi à l’arrêter. L’imperfection est le propre de l’humain qui bascule, sans cesse, d’ange à démon. Isaïe : « Si vous étiez dépourvus de fautes, et si de vos pêchés vous étiez éloignés, rien ne vous différencierait de votre Dieu. ». Ainsi, l’histoire du Golem, magnifiée par le talent de Chajim Bloch, continue de courir (Chajim Bloch : Le Golem. Légendes du ghetto de Prague (1928), Est Editeur, 2017). Gustav Meyrink en tira à son tour un récit envoûtant, évoquant la vie foisonnante et sordide du ghetto de Prague au début du vingtième siècle. Dans les rues sombres, des entités fantastiques, guettent comme des revenants les passants, des couples candides dansent dans des estaminets sordides, la folie suinte dans les vieilles pierres, encrasse nostalgies et souvenirs, parsème la chaussée de signes amphigouriques (Gustave Meyrink, Le Golem (1915), éditions Garnier-Flammarion, 2003).
Ce n’est pourtant pas en concevant un homoncule que Rabbi Loew protège sa communauté, mais par sa force de conviction face un empereur tourmenté. Dans un texte, il commente le verset 26 du chapitre 1 de la Genèse où Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image ». « À qui, s’interroge-t-il, ces mots sont-ils adressés ? Le Saint-béni-soit-Il se parle-t-il, au moment de se livrer au travail qui couronnera son œuvre, comme le font souvent les artisans ? Ou est-ce à l’intention des anges que la phrase est dirigée ? C’est à l’homme, pourtant non encore créé, qu’il parle déjà, affirme Rabbi Loew, à l’homme appelé déjà à devenir un partenaire et un interlocuteur de son créateur ». Le Maharal approchait les cent ans et ses jours semblaient ne pas devoir finir. Les anges, dit-on, s’en inquiétèrent. Sa petite fille préférée, Eva, la fille d’Isaac Cohen, lui offrit une rose. En contemplant le cœur de la fleur et en respirant son parfum, il revit sa jeunesse et sa vie, et mourut de cette douceur. Dans les fissures de sa pierre tombale qu’orne le lion de Juda, il est de tradition de glisser un petit papier plié, un ex-voto renfermant le souhait le plus secret. (Rosenberg Yudl (2008) The Golem and the Wondrous Deeds of the Maharal of Prague, New Haven, Yale University Press). (Gross Benjamin : Le messianisme juif dans la pensée du Maharal de Prague, Paris, Albin Michel, 1994). (Neher André : Faust et le Maharal de Prague. Le mythe et le réel, Paris, Presses Universitaires de France, 1987).
Le Golem trouve son prédécesseur dans la créature Homunculus de Paracelse. L’illustre philosophe et médecin suisse Philippus Theophratus Aureolus Bombastus von Hohenheim (1493 – 1541), alias Paracelse, surnommé le divin, se distingue par ses trouvailles alchimiques et magiques, et son caractère infréquentable. Son pseudonyme Parcelse ne signiie-t-il pas « plus grand que Celse », la plus importante autorité médicale d’Ephèse au IIème siècle. Le dit Homunculus est une reproduction de la vie en éprouvette : “Si la semence humaine, enfermée dans une ampoule de verre scellée hermétiquement, est enterrée pendant quarante jours dans du fumier de cheval et magnétisée de la bonne façon, elle commence à bouger et à prendre vie. Après un temps donné, cette semence prend la forme d’un être humain, mais sera transparente et sans corps physique. Nourrie artificiellement avec de l’arcanum sanguinis hominis pendant quarante semaines et maintenue à température constante, elle prendra l’aspect d’un enfant né d’une femme, mais beaucoup plus petit. Nous appelons un tel être, apte à recevoir éducation et sagesse, homunculus ».Selon la tradition antique, l’Homunculus peut être également produit par la racine de mandragore qui, sortie de terre, prend forme d’un petit homme. Un autre type d’homunculus aurait été obtenu par David Christianus à partir d’un œuf pendu par une poule noire. Dans tous les cas, l’homunculus est un serviteur, doué d’une intelligence surhumaine, est un serviteur des alchimistes et magiciens. L’Homunculus, comme le Golem, dérive sans doute du mythe de Prométhée et du sumérien Enlil qui créèrent l’être humain à partir de l’argile. Vulcain fabrique les premiers robots, sept servantes mécaniques en or et des cerbères d’argent pour garder son palais d’Alcinoos. Au XIIIème siècle, Albertus Magnus se servait déjà d’un homme mécanique de laiton. S’anticipent ainsi, plusieurs millénaires en amont, les créatures technologiques, imaginées pour la première fois en littératures par Karel Capel dans la dramaturgie satirique Rossum’s Universal Robots (R.U.R.). Le substantif « robota » signifie en tchèque travail, besogne, corvée, avec une connotation de servage, voire d’esclavage. Il s’agit bien de travailleurs d’exceptionnelle efficacité parce que dépourvus de toute personnalité.
Des prémisses de l’intelligence artificielle
Norbert Wiener (1894 – 1964) place son invention de la cybernétique sous le signe du Golem. La subversion du réel par l’artifice technologique déboulonne les traditionnelles fixations physiques et métaphysiques. Le précurseur de la révolution numérique définit la cybernétique comme la science des systèmes autorégulés applicable aux machines et au monde vivant. La maîtrise de toutes choses passe désormais par la maîtrise de l’information dans une interdisciplinarité dynamique. Cette science, qui ne se réduit pas au seul calcul, relève totalement de la communication. L’après-guerre, hallucinée par la bombe atomique, étend sur la planète des ténèbres entropiques. Le chaos menace de toutes parts. Le moindre incident diplomatique prend des allures explosives. Les prophètes de l’apocalypse guettent dans chaque péripétie politique la catastrophe définitive. Norbert Wiener prospecte à contre-courant des antidotes à l’incertitude, mère des angoisses insurmontables. L’échange continuel d’informations se conçoit en l’occurrence comme une perpétuelle adaptation collective aux contingences ambiantielles. La transversalité connective se propose comme alternative face aux tyrannies idéologiques et aux verticalités terrorisantes. La politique a beau multiplier ses interférences parasitaires, privée du monopole de l’information, elle ne peut plus créer l’événement. Dans cette vision fonctionnaliste, pacificatrice des relations humaines, la forme corrélative des messages prime sur leur substance particularisante. La communication, codifiée dans une langue abréviative, finit par relever de la théorie mathématique du signal où le son signifiant peut s’amalgamer au bruit négligeable. Quand le téléphone portable était à ses débuts hors prix, les jeunes italiens désargentés inventèrent un langage, nommé squillo ou grillo, uniquement basé sur des alternances de sonneries sans décrochage, ce qui le permettait de communiquer à distance sans débourser un centime. Ne demeure que l’émotion réactive. L’être lui-même, vidé de sa conscience critique, n’est en fin de processus qu’un réceptacle d’énergies stabilisantes ou déboussolantes.
L’école californienne de Palo Alto, conduite entre autres par l’ethnologue Margareth Mead, multiplie les applications de la méthode cybernétique dans les sciences sociales, historiques, psychiatriques. Le Mental Research Institute élabore des thérapies brèves évaluées selon leur efficacité pratique. L’anthropologue Grégory Bateson entreprend des recherches tous azimuts dans les domaines de la communication, des stratégies de changement, des médications mentales. Sa théorie sur les troubles durables engendrés par le double bind ou double contrainte, met en évidence l’impact des exigences contradictoires et des injonctions paradoxales, les incidences décisives du contexte et du métacontexte, et renouvelle la compréhension de la schizophrénie.
La découverte de la structure en double hélice de l’ADN par la biologie enrichit la cybernétique du concept d’auto-organisation. La théorie du chaos et les mathématiques de la complexité issus des découvertes d’Henri Poincarré s’enrichissent de recherches nouvelles. Edgar Morin reprend et développe le concept de « pensée complexe » élaboré par Henri Laborit (Edgar Morin : Science avec conscience, éditions du Seuil, 1982). Les sciences, dans leurs spécialisations pointues, n’ayant pas conscience de leur fonction sociétale et des principes occultes présidant à leur élucidation, il s’agit de prendre conscience de la complexité de la réalité et de la réalité de la complexité, sources d’indéterminismes et d’imprévisibilités. La transdisciplinarité implique un retissage des multiples composants pour reconstituer l’ensemble atomisé, pour retrouver la boucle auto-productive, génératrice des éléments multiformes qui caractérisent dans son intrication synergique le vivant. L’information est organisatrice, dans cette approche, de la machine cybernétique, porteuse de nouveauté et d’inattendu. La rétroaction (feed-back) est un mécanisme amplificateur. Dans la récursivité, les produits et les effets sont en même temps producteurs et causateurs, ainsi en est-il de la reproduction biologique. Dans les systèmes dynamiques, le tout recèle des qualités émergentes, qui rétroagissent sur les parties et en font plus que la somme de ces parties. Le tout est par lui-même une unité composée d’une infinité d’unités dissemblables, d’où la dialectique de l’unité dans la diversité et de la diversité dans l’unité. « L’auto-éco-organisation » est la capacité d’un système d’être autonome et d’interagir avec son environnement, de garder une liberté décisionnelle tout en puissant son énergie, son information, son organisation dans son biotope. Le principe dialogique réunit deux notions oppositionnelles et indissociables à l’instar de la dualité onde-corpuscule. Les antagonismes sont, de ce fait, des moteurs de la complexité. Le principe hologrammatique explique que la partie soit dans le tout et le tout dans chaque partie comme le patrimoine génétique, qui se retrouve dans chaque cellule.
L’ingénieur et psychiatre William Ross Ashby façonne le concept d’homéostasie, équilibre des fonctions vitales de la vie, et l’homéostat, un appareil rééquilibrant un organisme soumis à des dérèglements externes. La Loi de la variabilité requise est une version cybernétique de la dialectique du maître et de l’esclave. Pour qu’un système puisse contrôler un autre, il suffit que la variété de ses constituants soit égale ou supérieur à son concurrent. Quand la variété du système commandé augmente et dépasse celle du commandeur, une inversion de contrôle intervient. Les bases de la cybernétique et de la téléologie sont jetées dès 1943 dans l’article Behavior, Purpose and Teleology, signé par Norbert Wiener, Arturo Rosenblueth et Julian Bigelow, qui expose la possibilité d’interaction de la biologie, de la mécanique et de l’électronique. Traumatisé par l’implication de scientifiques dans la conception d’armes de destruction massive et dans des expériences génocidaires, Wiener prône l’utopie de la communication comme planche de salut (Norbert Wiener : La cybernétique : Information et régulation dans le vivant et la machine, éditions du Seuil, 2014).
La réalité-fiction dévore l’espace et le temps au point que le cybernanthrope, conditionné par la signalétique, la vidéo-surveillance, la robotique, les écrans publics et domestiques, béquillé d’ordinateurs et de téléphones portables, se dissout dans sa représentation golémique. La théorie du hasard et de la nécessité fournit une explication aux chances de survie, de développement et de reproduction, quand les réponses comportementales sont appropriées aux contraintes environnementales. Le concept de cybernétique, créé au milieu du dix-neuvième siècle à partir du grec Kubernêtikê, ne signifie-t-il pas étymologiquement art de gouverner avant de désigner un organisme électronique humanoïde. Selon ses premiers penseurs, la cybernétique se donne comme objectif l’investigation de l’esprit pour définir et mesurer l’intelligence, l’explicitation du fonctionnement du cerveau, la construction de machines à penser, la régulation des activité humaines. S’ouvre ainsi la porte à l’intelligence artificielle, qui se donne comme ambition la perfection mimétique, quantitative et qualitative, pour suppléer, en toute circonstance, aux insuffisances des êtres vivants. Le Prix Nobel d’économie Herbert Alexander Simon se démarque cependant de cette rationalité substantive, considérée par le néo-classicisme comme une faculté naturelle conduisant au meilleur des mondes possibles, et se concentre sur la rationalité procédurale. La raison se détermine dès lors par les différentes décisions qui commandent ses applications, les décisions objectives qui optimisent les fonctionnalités préexistantes, les décisions subjectives qui maximalisent les chances d’arriver à un résultat, les décisions conscientes adaptatives des moyens aux fins, les décisions organisationnelles et les décisions personnelles visant l’accomplissement d’un dessein individuel. Comme chaque organisme humain ne peut percevoir et recevoir qu’une infime quantité d’informations produites par son milieu, il existe toujours un grand écart entre son action et la réalisation de ses buts. L’individu est donc sommé pour s’en sortir d’intégrer une organisation collective, qui utilise des procédures routinières pour contrer l’incertitude, qui divise le processus décisionnel entre plusieurs acteurs pour limiter les risques, qui corrige les erreurs, qui impose une autorité coercitive et qui exige une loyauté sans faille à l’entreprise. D’après cette logique disciplinariste, l’ordinateur, qui radiographie et reproduit fidèlement la pensée humaine en la systématisant, devient un aent central dans l’exploitation efficiente des ressources et l’obtention des performances. S’oublie, dans l’infernale compétitivité, l’humain et sa destinée.
La systémique prétend réduire la complexité du vivant à la rigidité de ses règles. Le biologiste Ludwig von Bertalanffy, dans sa Théorie générale des systèmes (éditions Dunod, 1973), entend « dégager des principes explicatifs de l’univers considéré comme un système grâce auquel on pourrait modéliser la réalité ». Les organismes vivants, les objets inanimés, les groupes sociaux, les processus mentaux appartiennent, en conséquence, à une conception unitariste du monde, un phénix artificiel où les technologies, au nom du principe d’émergence, participent de l’organisation générale. L’isomorphisme des concepts, des modèles, des lois permet, selon cette théorie, de les transférer d’un domaine à un autre. La bionique développe des systèmes mécaniques susceptibles d’assurer les mêmes fonctions que les systèmes biologiques. Le physiologiste Warren McCulloch, introduit, de son côté, le caractère du Tout ou Rien dans l’activation neuronale et ouvre la voie aux automates autorégulés. Les fonctions de l’esprit sont traitées dans ce schéma comme des fonctions mathématiques transformant les entrées en sortie et les stimulations en réponses. Cette vision fonctionnaliste aboutit en définitive à l’idée des neurones arbitraires.
Marvin Minsky, partant de l’incapacité des réseaux de neurones perceptifs de résoudre les problèmes non linéaires, dirige la recherche vers l’intelligence artificielle symbolique, dotée d’approches multiples, notamment la représentation des connaissances. Dans La Société de l’Esprit (Inter-Editions, 1997), l’esprit est présenté comme une architecture d’agents élémentaires, indépendants et hiérarchisés. Les lignes (K-lines) sont des agents de mémoire à court terme favorisant des combinaisons efficaces. Les agents de base sont les Nèmes (agents des connaissances), les Nomes (agents de traitement des connaissances), les Polynèmes (aspects différents d’un même objet), Les Paranomes manipulent simultanément plusieurs modes de représentation des connaissances. Tous ces agents se combinent pour former des configurations de grande taille capables d’opérations complexes (Frames, Frames-Arrays, Transframes). Le Cerveau B contrôle en permanence le Cerveau A, corrige les erreurs, arrête les activités mentales improductives (boucles, redondances…). La frontière s’abolit entre le robot et le cybernanthrope greffé de puces électronique, censé fonctionner avec les mêmes bases de connaissances, les mêmes machines à calculer, les mêmes probabilités conditionnelles, les mêmes systèmes d’aide à la décision.
La création est toujours une opération à tiroirs, une manifestation dans de nombreux miroirs. « Quel dieu derrière Dieu commence cette trame ⁄ de poussière et de temps, de songe et d’agonie » (Jorge Luis Borges : L’Auteur, éditions Gallimard, 1965). Frankenstein ou le Prométhée moderne de Marie Shelley raconte la création par un jeune savant suisse, le docteur Victor Frankenstein, d’un hybride vivant, doué d’intelligence, par l’assemblage de chairs mortes. Le monstre finit par se venger d’avoir été abandonné par son créateur. Ce récit précurseur de la science-fiction est tout entier construit en abyme. L’existant ne se reconnaît comme étant qu’en recevant en retour son image extérieure. La technique épistolaire facilite l’enchâssement de plusieurs vies et de plusieurs points de vue émanant des interlocuteurs en correspondance. Mary Shelley s’est, selon toute vraisemblance, inspiré d’une nouvelle de François-Félix Nogaret publiée en 179O aux lendemains de la Révolution française, une fable scientifique où un inventeur nommé Frankésteïn crée un homme artificiel (François-Félix Nogaret, Le Miroir des événements actuels ou la Belle au plus offrant, reproduction de l’édition originale, éditions Hachette Livre BNF, 2017). L’invention technique comme la création artistique ne sont-elles pas, avant tout, des actes d’exorcisme, des désenvoûtements d’incubes rieurs, des extirpations de démons intérieurs.
L’humain, taraudé par l’angoisse de sa finitude, a toujours développé ses sciences pour apaiser sa conscience et s’immortaliser dans un hypothétique double impérissable. L’émergence de l’intelligence artificielle le menace, s’il n’y prend garde, de déroute irrémédiable. En 2016, l’illustrateur Lorenzo Ceccotti publie sous le tire de Golem une bande dessinée fleuve, parabole politique d’une Italie futuriste, prospère et pacifique où la dictature armée d’antennes électroniques contrôle les pensées les plus intimes, où les désirs sont assouvis avant d’être exprimés, où le rêve est tari dans la satisfaction de tous les besoins et de tous les caprices. Une société où l’existence cotonneuse se love avec contentement dans le frivole et le factice. Les sujets téléguidés par des oreillettes évoluent comme des automates dans un monde aseptique, gangréné dans tous ses atomes par les nanotechnologies. Les attitudes sont standardisées, mécanisées, robotisées, canalisées par les trois fonctions récepteur (capteur), translateur (processeur), impulseur (actionneur). Dans ce système où la réification transforme toutes choses, y compris les sentiments, en marchandises, les états émotionnels eux-mêmes ne sont que simulations. Un groupe de jeunes utopistes, hippies survoltés du troisième millénaire, tente de secouer les bienheureux chloroformisés d’opulence et de bien-être. La sédition brouillonne de cette jeunesse insoumise ne rencontre que turpide indifférence. Dans cette société où la pensée est prohibée pour inutilité matérielle et l’imaginaire interdit pour hérésie sensorielle, le rêve, le rêve de liberté et la liberté du rêve sont incorruptiblement révolutionnaires. Le personnage principal, Steno, naît dépositaire du rêve comme une fenêtre ouverte sur la création et une porte d’accès aux mystères divins. Il porte son rêve dans la tête et le corps comme unique attache à la vie. Il ne sait pas qu’il est venu sur terre comme un messie salutaire. Il ne sait pas que dans les ténèbres illuminées de néons publicitaires, ses paupières closes irradient la lumière (Lorenzo Ceccotti alias LRNZ : Golem, éditions Glenat Comics, 2016).
La parabole de l’apprenti sorcier
La parabole de l’apprenti sorcier de Johan Wolfgang von Goethe résume les risques de débordement des initiations sans garde-fous. La présomption thaumaturgique de l’humain est sans limites. Son désir de miracles compense son insatisfaction permanente. Fleuve en crue déclenche détresse. Source tarie n’entraîne que sécheresse. Gare au mimétisme ! L’impudence débouche sur le déluge. Les esprits invoqués n’obtempèrent qu’aux paroles magiques, n’obéissent qu’aux codes programmatiques. A vouloir jouer au maître, l’apprenti sorcier se néantise. Le poème de Goethe s’inspire directement d’une œuvre du deuxième siècle du syrien Julien de Samosate,Philopseudès (pseudo-philosophe), l’amateur du mensonge ou l’incrédule, qui narre l’histoire d’un balai métamorphosé en porteur d’eau et prophétise l’androïde domestique : quand nous étions dans une hôtellerie, il ôtait la barre de la porte, s’emparait soit d’un balai, soit d’un pilon, et l’habillait de quelques guenilles. Puis, il lui jetait un sort en prononçant une formule incantatoire. L’objet se mettait à marcher avec une telle aisance qu’on aurait dit un humain. Cet esclave, d’un genre particulier, puisait l’eau, préparait les repas, faisait le ménage et nous servait avec un soin extrême. Et lorsque Pancrate n’avait plus besoin de ses services, il lui rendait son état originel de balai ou de piton ». Les anciens connaissent trop bien les menaces casuelles des créatures artificielles pour oublier de les désactiver quand elles ne sont plus utiles.
Quand Méphaïtos fabrique, pour faciliter la vie des dieux, des automatoï capables de se déplacer de leur propre mouvement, il veille à leur parfaite exécution des tâches assignées. Dans cette période idyllique dénommée « Le temps du Chronos », préservée des malheurs et des douleurs, où la production des ressources et des richesses est entièrement automatisée les androïdes d’Héphaïtos, se perçoivent dans l’Olympe comme des serviteurs méthodiques, sans embarras matériels et sans complications psychologiques. « Si chaque instrument était capable, sur simple injonction, d’accomplir son travail, comme on le raconte des statues de Dédale et des trépieds d’Héphaïtos, si les navettes tissaient d’elles-mêmes, si les plectres pinçaient tout seuls la cithare, alors les maîtres artisans n’auraient plus besoin d’ouvriers ni d’esclaves ». (Aristote, Politique). En se déchargeant sur la machine de sa force de travail, l’humain se dépouille imperceptiblement de sa capacité d’action sur le réel et de sa réflexion sur le surréel. La machine, monstre virtuel révèle toujours des potentialités ignorées par son propre concepteur, suscite l’angoisse de son inventeur et l’effroi de son utilisateur. Toute technique recèle sa part indéchiffrable, son repli défavorable, son piège déplorable. Toute technique, fusse-t-elle proclamée pacifique, répand un sentiment sourd de terreur. L’angoisse de l’ingénieur symptomatise la quête problématique de l’inaccessible, la tentation frénétique de l’impossible, l’expectance inavouable d’un échec irrémissible. La technique est le pays des dangers où l’aventurier-chercheur cesse d’être un inventeur pour devenir apprenti sorcier (Ernest Bloch, L’Angoisse de l’ingénieur, éditions Allia, 2015). La mécanique, dans son opacité métallique, désintègre les vagues vibratiles et les nuées subtiles où nichent et prospèrent les entités mythiques et les génies bénéfiques.
Ne demeure qu’une société hygiénique de surveillance et de contrôle. Ces avatars extraordinaires sont des cerbères intraitables. Nul intrus n’échappe à la vigilance du chien d’or, gardien du palais D’Alkinoos. Nul immigré, nul réfugié, nul indésirable, ne peut tromper l’attention du géant Talos faisant le tour de la Crète trois fois par jour. La convergence actuelle des sciences cognitives, des biotechnologies, des nanotechnologies et des ingénieries informatiques ne se donne-t-elle pas le même idéal, une existence sans efforts et sans contraintes ? La société mythologique n’est-elle pas que le miroir anticipateur de la société technologique ? Talos est aujourd’hui un monde de Star Trek, un alien de l’Univers Marvel, une station spatiale du jeu vidéo Prey. Les satellites de reconnaissance, collecteurs de renseignements, filment partout avec une précision millimétrique. Les drones espions de toutes les formes et de toutes les dimensions se répandent partout comme sauterelles mécaniques. Des espions insectes robotiques, équipés de caméras et de micros miniatures, peuvent s’introduire dans les intimités les mieux protégées ou survoler comme des libellules des manifestations publiques, s’accrocher subrepticement à un vêtement, prélever des échantillons d’ADN, injecter un poison mortel. La scrutation systématique, sous prétexte sécuritaire, des moindres faits et gestes sur toute la surface de la planète impacte une insidieuse anesthésie cognitive, paralyse la pensée collective, ostracise les consciences rétives.
Reste la superstition, dans son sens étymologique d’invocation aveugle d’une protection supérieure. Dans Alexandre ou le faux prophète de Lucien de Samosate, deux arrivistes entreprennent de fonder un sanctuaire et un oracle pour profiter de la crédibilité des fidèles : « Ces deux parfaits fripons avaient compris que la vie des hommes est soumise est soumise à deux grands tyrans, l’espérance et la peur, et qu’un homme capable de les exploiter peut s’enrichir rapidement, car celui qui espère et celui qui craint éprouvent un désir absolu de connaître l’avenir ». Ces mêmes fétichistes s’émoustillent d’histoires de miracles. Les prodiges de la cybernétique, comme les sept merveilles de l’antiquité, ne sont-ils pas les plus fabuleux des miracles ? Des crédulités hallucinées se voient des cyborgs immortels, des mutants immunisés pour l’éternité contre les flétrissures du temps. Le transhumanisme, héritier lointain du positivisme d’Auguste Comte, est désormais une nouvelle religion préparant l’avènement du post-humain (Miguel Benasayag : Cerveau augmenté, homme diminué, éditions La Découverte, 2016). Ces futurologues entendent mobiliser les technologies d’amélioration de la vie pour éliminer le vieillissement et accroître exponentiellement les capacités physiques, psychiques, intellectuelles. Un homme-dieu démultiplié en autant d’êtres humains sur terre. Une humanité de milliards de dieux omniscients et omnipotents. Un enfer d’omnipuissance. Les banques de données pharamineuses, perpétuellement alimentés par les réseaux sociaux, des opérateurs internétiques, se concentrent sur le développement de l’intelligence artificielle, qui modélise d’ores et déjà l’humain comme un être préhistorique. « Les gens implantés, hybrides, domineront le monde. Les autres, qui décideront de rester humains, seront une sous-espèce, des chimpanzés du futur ” (Kevin Warwick, cybernéticien). Les transhumanistes se légitiment malgré tout d’un souci d’éthique. Un éthique robotique relève de l’absurde. Le scientisme des siècles révolus prétendait déjà neutraliser les retombées néfastes de la technique et n’en garder que les effets bénéfiques avant que les guerres mondiales ne lui infligent le plus sanguinaire des démentis. N’est-ce pas au nom de sa supériorité technologique que l’occident s’est arrogé le droit de coloniser la planète entière et de la soumettre à son modèle unique ? Les robots travaillant hors consciences, quelles que soient leurs prouesses dans la simulation des émotions, leurs dérives éventuelles échappent à tout prédictionnisme. En cas d’accident robotique, il n’est ni erreur récupérable, ni préjudice réparable, ni faute expiable. L’impondérable n’a-t-il pas évoqué dans les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima ? Les technologies de pointe peuvent être actionnées à tout moment par la main du diable. Certains savants, obnubilés par l’aboutissement de leur entreprise, ne contractent-ils le syndrome de Faust ? L’éthique étant la compréhension profonde et réelle, intuitive et rationnelle, de l’essence et de la quintessence du mal et du bien, hors morale spirituelle et sociale, il n’est d’éthique qu’humaine. La morale machinique, algorithmique, dichotomique, sœur jumelle du capitalisme, sans d’autre critère que l’efficience technique, existe déjà depuis la révolution industrielle. Les projets de téléchargement de personnalités sur des substrats non biologiques retombe dans le vieux monisme et l’idéalisme fusionniste du corps et de l’esprit.
La science-fiction, quand elle est soutenue d’une pensée philosophique, est une soupape de sécurité contre les projections délirantes des transhumanistes. La littérature, transfiguratrice des faussetés imaginaires, n’est pas dupe des pseudo-certitudes scientifiques. La science est tyrannique quand elle impose ses diktats à la conscience sceptique. Il y longtemps, très longtemps, dans « La Traversée ou le tyran »de Lucien de Samosate, l’invincibilité du robot cause sa perte. Car, il ne suffit pas d’inventer le génie insurpassable, encore faut-il pouvoir le remettre dans sa boîte, contrôler le processus magico-technique qui le propulse, sinon les eaux détournées pour nettoyer les écuries d’Augias finissent par être fatales. L’intelligence artificielle, comme le jeu de l’apprenti sorcier, narguent insolemment la raison régulatrice. Du moindre artefact peut surgir l’étincelle létale. L’androïde autonome ne peut-il pas chevaucher les crocodiles et naviguer dans le Nil au milieu des bêtes féroces ? L’humanoïde n’est-il pas semblable à l’Hydre de l’Herne, qui se régénère doublement quand ses têtes sont trachées ? Les manipulations génétiques ne génèrent-elles pas des phénomènes plus terrifiants que les monstres antiques. Les organismes modifiés, soumis à la transgenèse et à la sélection artificielle, se métamorphosent au gré du transfert des gênes. Le génome des êtres vivants peut être transformé à l’infini grâce à la technique Crisper-Cas 9. Le monstre des monstres vers lequel se dirige la biotechnologie, n’est-ce pas l’être humain génétiquement parfait, résistant à toutes les maladies ? Les apprentis sorciers des laboratoires sont les premiers à savoir qu’ils provoquent des mutations génomiques indétectables par les logarithmes chasseurs des effets hors-cibles. Les spectres et les simulacres guettent désormais au détour de chaque découverte…
© Mustapha Saha.
Sociologue, poète, artiste peintre.





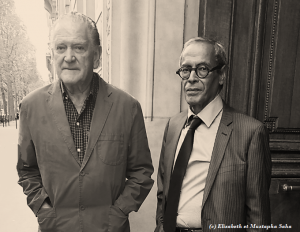
JEAN-JACQUES LEBEL. DE LA TRANSGRESSION DE L’ART A L’ART DE LA SUBVERSION.
PAR MUSTAPHA SAHA
A quatre-vingt-deux ans, œil bleu nimbé de la malice d’éternel potache, le dernier surréaliste demeure un agitateur culturel sans pareil, présent sur tous les fronts artistiques, infatigable porte-drapeau de la Beat Generation, mouvement littéraire assoiffé de libertés dans une Amérique imbue de ses victoires, fière de ses déboires, toujours discriminatoire et puritaine. Dans cette société de surabondance matérielle, dévorée par la cupidité et la stupidité de l’avoir, où l’être n’existe que par son paraître, la Beat Generation replace le vivant au centre de l’univers, prêche le pacifisme en plein militarisme, prône le mépris des besoins superficiels, proclame la libération des désirs essentiels, prêche le chamanisme régénérateur, le bouddhisme purificateur, la créativité permanente, le salut par l’art et la littérature.
Nostalgie 68
En Mai 68, Jean-Jacques Lebel et moi-même, avec une poignée d’artistes et d’étudiants, prenons d’assaut le théâtre de l’Odéon, forteresse inexpugnable du règne culturel d’André Malraux, dirigée de main de fer par le non moins sentencieux Jean-Louis Barrault. L’autorité tutélaire des pères se liquide à coups de slogans ravageurs. La parole se libère du mandarinat castrateur. Nous revoici, un demi-siècle plus tard, aussi complices qu’hier, liés par les mêmes utopies anticipatrices, cultivant l’impossible dans notre imaginaire, courant jambes au cou vers les horizons entrouverts, le même vieux monde à nos trousses. Je nous revois à New York, une année plus tard, plongeant dans les bars underground, les bas-fonds artistiques d’East Village, les fabriques d’icônes détraquées, explorant les laboratoires charivariques, désintégrateurs de l’ordre établi, observant, dans la cour de l’Université Colombia, la vente à la criée de billets pour le festival de Woodstock, un festival qui rassemble quelques jours plus tard, en rase campagne, un million de jeunes en rupture de société marchande, pendant que la même Amérique, embourbée dans la guerre du Vietnam, confrontée à la révolte des noirs, à la lucidité précoce de ses propres enfants piqués par une mouche révolutionnaire, fête sur écran géant, à Central Parc, l’arrivée sur la lune de ses astronautes scaphandrés et s’obstine aveuglément dans son exhibitionnisme impérial. Aujourd’hui, les clochards célestes poursuivent leur route loin des fracas planétaires. Je pense secrètement que Jean-Jacques Lebel reste le seul sur terre à garder le contact. Son frère d’adoption, l’artiste postmoderniste Erró, portant ses quatre-vingt-six printemps comme une peinture additive, approche sa discrète silhouette méditative. Nous rediscutons du monde à la dérive, des gouvernances rébarbatives, des espérances germinantes sur d’autres rives. Il m’offre le catalogue de son exposition, un livre d’art, couverture en noir et blanc qui lui ressemble, avec une dédicace allusive à ma marocanité : « Pour Mustapha, avec ma tête explosante du côté du Rif, son ami Jean-Jacques ».
Saltimbanque tourbillonnaire
Le parcours buissonnier de Jean-Jacques Lebel vaut la peine d’être brièvement narré, non point pour le célébrer, il n’en a cure, mais pour le tendre en lanterne aux jeunes destinées sans repères. Le saltimbanque tourbillonnaire naît artiste, dans un berceau tricoté par les muses. Les rois mages du dadaïsme et du surréalisme, André Breton, Benjamin Péret, Marcel Duchamp, Man Ray, Henri Michaux… se penchent sur sa crèche. Son père, Robert Lebel (1901 – 1986), écrivain, poète, critique d’art, tresse la couronne de Marcel Duchamp et d’autres figures marquantes du siècle des bouleversements rouges et noirs. Jean-Jacques Lebel entre dans le cercle surréaliste par la porte de service, où sa turbulence novatrice, en désespérance de nouveaux fruits salvateurs, secoue désespérément le vieux cocotier fourbu. Il expose, à dix-neuf ans, ses premières œuvres à Florence, où il édite simultanément sa première revue interdisciplinaire « Front unique ». Armé de sa seule boite à crayons, il taille son chemin tortueux dans la broussaille inexplorable, crève le miroir de l’espace-temps, s’exalte d’avance des rencontres inimaginables, des trouvailles insoupçonnables, des nébuleuses inconcevables. Il se lance dans une transe anamnésique qui se poursuit sans fin. Il ne faut pas moins que cette déflagration mentale pour s’affranchir de la folie ordinaire. Dès lors, son existence n’est qu’une cascade d’initiatives, d’audaces inventives, d’imprudences productives. Un art de vivre dans l’oxymorisation festive. Une dialectisation de l’être et de sa raison d’être avec la même science intuitive, la même fibre explorative, la même sagacité prospective. Il improvise son premier happening, L’Enterrement de la chose, à Venise, publie son ouvrage analytique sur cette créativité interactive, enchaîne les performances collectives aux quatre coins de la planète. Il ne cesse de combiner ses activités d’artiste et d’écrivain d’intenable citadin et d’indomptable sylvain.
Beat hotel
Il traduit les grands auteurs de la Beat Generation, ses amis pensionnaires d’un hôtel famélique sans nom, rue Gît-le-cœur dans le Quartier Latin, rebaptisé à force d’usage Beat Hotel. La patronne, Madame Machou, qui avait travaillé dans une pension fréquentée par Claude Monet et Pablo Picasso, se fait payer volontiers en dessins et manuscrits. Jean-Jacques Lebel présente William Burroughs, Allen Ginsberg et Gregory Corso aux mythiques Marcel Duchamp et Man Ray. La rencontre ébouriffante tourne vite à la démonstration dadaïste. S’embrassent les chaussures, se tailladent les cravates. Les beats contestataires, imprégnés par les écrits parisiens d’Ernest Hemingway (Paris est une fête), Henry Miller (Jours tranquilles à Clichy), la poésie baudelairienne, en quête d’expériences transgressives, rêvent de la bohème des années folles, ils ne découvrent qu’une métropole sans âme, infestée par les miasmes des guerres coloniales. Leur production littéraire s’en trouve paradoxalement propulsée. Allen Ginsberg rédige Kadish au Café Le Select, son poème émouvant sur la maladie mentale de sa mère. Gregory Corso expérimente l’écriture spontanée dans Bomb. Selon son expression, il laisse les vers couler sans s’occuper du gras. William Bourroughs accumule goulûment les pages du Festin nu que ses camarades s’obligent de classer. Le miséreux Beat Hotel, fourmillant d’artistes et de poètes en rupture de ban, s’appelle aujourd’hui Le Vieux Paris, un quatre-étoiles réservé aux bourses bien garnies. Une modeste plaque de verre indique : « Beat Hotel. Ici vécurent B. Gysin, H.Norse, G.Corso,A.Ginsberg, P.Orlosvsky, I. Sommerville. W.Burroughs y acheva le Festin nu (1959). » Jean-Jacques Lebel aura été acteur et témoin de la plus avant-gardiste des écoles littéraires, prise au départ pour une loufoquerie passagère, une extravagance scandaleuse sans lendemains. Il n’en tire aucune gloire. Il conte l’aventure historique et ses anecdotes savoureuses comme on raconte des futilités piquantes de vacances.
Philosophie rhyzomique
Jean-Jacques Lebel a toujours donné à ses manifestations protestataires une dimension créative et collective, inoculant l’indignation dans l’art et projetant l’art dans la rue. Il n’a de cesse de mettre en pratique la philosophie rhizomique de ses amis Gilles Deleuze et Félix Guattari en inscrivant ses créations personnelles dans une collectivité contributive, génératrice d’allégories imprévisibles. Il se définit comme un collecteur d’amitiés, d’échanges, de partages, de synchronicités saisies au vol. Il organise avec Alain Jouffroy « L’Anti-Procès », exposition internationale itinérante de soixante artistes contre les derniers soubresauts du colonialisme. Il y expose, entre autres, le Grand Tableau Antifasciste Collectif, peint par Baj, Dova, Crippa, Erró, Recalcati et lui-même, une œuvre séquestrée pendant vingt-quatre ans par la Questura de Milan. Une époque des méprises, où l’universalisme occidental, battu en brèche, sort ses bombes nucléaires, où le modernisme à bout de souffle fait parader ses militaires, où l’agonie des colonies est vécue par les dominateurs comme une apocalypse cométaire. Citoyen du monde, immergé dans la synergie des cultures et la culture des synergies, Jean-Jacques lebel crée, en guise de réponse libertaire, « Le Festival de la Libre Expression » et le Festival international de poésie Polyphonix pour procurer une scène visible et une plate-forme audible aux poètes, artistes, cinéastes et musiciens de plusieurs pays, pour saper l’européocentrisme dans ses bases élitaires. Un art-action en perpétuelle interaction dans l’obscurité labyrinthique de la ruche planétaire. Le sens de l’existence se niche dans la fourmilière comme la lumière dans la grotte. Qu’importe si tant de ses œuvres échouent dans les musées de son vivant, Jean-Jacques Lebel ne sait naviguer qu’à contre-courants, dans cette contre-culture creusée dans l’incorruptible volonté d’être soi-même. Il ignore les finasseries séductrices, les mignardises fascinatrices, les simulations mystificatrices de ses célèbres compères. Son incurable suractivité le protège contre l’égotisme plombifère.
Mustapha Saha,
Sociologue, poète, artiste peintre.
EXPOSITION JEAN-JACQUES LEBEL. L’OUTREPASSEUR.
CENTRE POMPIDOU. PARIS.
DU 30 MAI AU 3 SEPTEMBRE 2018.
LA PALETTE CHAMANIQUE DE MARC VARVARANDE.
PAR MUSTAPHA SAHA

Certains itinéraires artistiques fraient leur chemin hors sentiers battus, creusent leur sillon hors sylve abattue, fertilisent leurs créations hors modèles rabattus. Il est des sentes buissonnières, des vadrouilles pionnières, des tortilles ouvertes par quelque muse braconnière, qui mènent aux vallées inexplorées, foisonnantes de plantes insoupçonnables et de créatures inimaginables. Heureux l’artiste comme Marc Varvarande qui les arpente et projette sur des paysages connus les lumières cueillies au-delà des nuages. Le peintre transpose les fééries visuelles sur les murs nus des écoles déshéritées, avec la patience du jardinier qui ne voit passer le temps qu’à travers les saisons, la délicatesse de l’artisan qui donne à chaque motif sa belle raison, la générosité du samaritain qui sème la beauté dans chaque maison. Qui peut percevoir mieux que les enfants, encore préservés des jugements acquis, le jaillissement poétique des formes et des couleurs, sinon l’artiste, réfractaire à la routine stérilisante, puisant dans sa mémoire mutine les intuitions premières et les sensations diamantines. L’image enjambe la barrière langagière pour formuler l’indicible, esquisser l’inaccessible, diaprer l’immarcescible. Les intuitions, éblouies par le spectre solaire, se font clairvoyances.
Le peintre, dessinant un jardin sur l’austère palissade, est perçu, comme unjongleur de pinceaux, jouant de sa palette-organon, déclamant ses stances et ses strophes, ses rêves et ses douleurs, en mots-couleurs, comme une apparition de Merlin l’Enchanteur, barde prestidigitateur surgi de l’antédiluvienne oralité gauloise. Merlin, doté dès la naissance de lumineuse sagacité et d’astucieuse extralucidité, tout à la fois momignard joueur, facétieux, et vieillard bâtisseur, minutieux, est l’exemple même des facultés innées qui n’attendent pas les validations académiques pour démontrer leurs virtuosités. Le génie sylvestre change d’apparence et de peau à sa guise, tantôt cerf portant pâte blanche et bois à cinq branches, tantôt volatile déployant ses ailes comme d’énormes branches. Le loup, son double initiatique, le sanglier frénétique, l’ours flegmatique et le dragon volcanique sont ses compagnons totémiques. Le prophète rieur remonte le temps et le redescend, foudroie les apologues obsolescents, projette son savoir incandescent sur ouvrages phosphorescents, se régénère dans les arbres dispensateurs de sciences circulatoires et de pouvoirs divinatoires. Avec tous ces prodiges, comment ne peut-il pas réveiller les aptitudes subjacentes et secouer les attitudes réticentes ? Ainsi s’expérimente et se légitime les vertus pédagogiques des légendes merveilleuses.
Les enfants dialoguent spontanément avec les prairies figuratives, se faufilent avec bonheur dans les charmilles florissantes, filochent sur brindilles les coccinelles nonchalantes, repèrent les marmottes craintives dans leurs flaques nutritives, dénichent les lutins dans leurs caches arbustives, susurrent des vœux hermétiques dans les oreilles des fougères frémissantes. La cloison peinturée déclique des rêveries magnifiques dans la symphonie pastorale. Les lettres joliment maquillées s’enlacent dans les yeux écarquillés. Les phrases bariolées s’emballent dans les danses tribales. La chorégraphie végétale s’étire en spirale dans la vastitude sidérale. Les embruns de la mer baignent le diorama d’irisations divines. Les barcaroles d’oiseaux jaillissent des piroles pour se dissoudre dans les lointaines flammeroles. S’exhalent des auréoles mouvantes, des flagrances captivantes, des sinuosités écrivantes. Se révèlent les syntonies sous-jacentes aux palissades putrescentes et les illuminations curatives des vexations dépréciatives. « L’art lave notre âme de la poussière du quotidien »(Pablo Picasso). Laissez les enfants traquer sous plafond de la classe, dans l’hilarité communicative, les voyelles rimbaldiennes transformées en papillons multicolores. Quand ils découvrent la vraie nature dans la nature, les vraies vaches dans les pâturages et non dans les fromage cellophanés, les vrais moutons dans les bocages et non dans les cuirs tannés, les vrais poissons dans les marécages et non dans les bâtons panés, ils parlent aux tourterelles et volent avec les hirondelles. Confiez aux chérubins toiles, peintures et pinceaux, vous verrez sortir de leurs mains de magiciens des paraboles malicieuses et des figures miraculeuses. Il aura donc suffi que le géniteur plasticien transforme la maternelle de son fils en merveilleuse pépinière. Se réalisent l’ouverture des fenêtres scolaires sur leur environnement bucolique, la socialisation ludique du langage artistique, la réconciliation karmique des acquisitions culturelles et des prédispositions naturelles. La transmission s’accomplit dans l’élaboration, jour après jour, tout au long de l’année, de la fresque murale sous les yeux des élèves, qui se précipitent ensuite dans l’atelier d’arts plastiques. Les mères en galère matérielle se valorisent en découvrant les dons insoupçonnés de leur marmaille. Comment exorciser les maléfices de la quotidienneté empoisonnante sinon dans l’intemporalité rotative aux mille détours, l’exploration des horizons ouverts par l’imaginaire, quand la spontanéité se fait refuge des escapades extraordinaires. Le dessin de l’enfant est un acte préfigurateur de son devenir sous condition qu’il n’en soit pas détourné par une orientation aberrante.
Toute la peinture de Marc Varvarande transpire cette générosité communicative, dans ses techniques cumulatives, ses thématiques fédératives, ses juxtapositions désignatives. La palette descriptive se prête, dans ses visibilités différentielles, aux lectures profanes et savantes. Ne voit-on pas, entre ocres orangers pastellisés d’aurores cristallines et bleus dégradés jusqu’aux lactescences opalines, flotter l’hologramme de Georges Brassens au-dessus des barques orphelines, et s’estomper dans les vastitudes ondoyantes, la jetée bordée de toitures rouges en perspective fuyante, et chanter avec le vent les ondines impalpables La Supplique pour être enterré sur la plage de Sète :
« Une plage où même à ses moments furieux
Neptune ne se prend jamais au sérieux
Trempe dans l’encre bleue du Golfe du Lion
Trempe, trempe ta plume, ô mon vieux tabellion
Et de ta plus belle écriture
Note ce qu’il faudra qu’il advienne de mon corps »
(Georges Brassens)
Ainsi se transmet, d’âme insoumise à bonté semblable, les rébellions inconsolables. Le père du chanteur, ouvrier maçon libertaire, ne lui-a-t-il pas transmis les idéaux pacifistes dans une guitare en place et lieu de sa truelle ? Sète, son cordon ombilical, le porte comme inextinguible fanal. Le vieux port couve ses pierres séculaires. Les chalutiers remontent le canal en file indienne, escortés par les nuées de goélands, jusqu’à la criée où s’écoulent dans joyeuse bousculade les baudroies, les encornets, les scyllares… Au Musée International des Arts Modestes, les objets usuels s’embabouinent avec les arts visuels. La Pointe Courte, village étranglé entre l’Etang de Thau et le Canal, où le pinceau pioche ses natures mortes dans le fatras de poteaux de bois et de filets de pêche, de bourriches et de cageots, de chaloupes et de barquerolles, murailles et bassin tranquille en décor. Les vieux habitants, jouteurs, rameurs, mariniers à la retraite, disserteurs intarissables sur les mœurs des daurades, des anguilles, des moules et d’autres espèces d’huitres et d’oursins, se souviennent du tournage d’Agnès Varda, annonciateur de la Nouvelle Vague. Dans le cimetière du Py, où s’irisent dernières demeures de brume luminescente, où s’imprègne poésie d’écume fluorescente, Georges Brassens savoure pour l’éternité son incommensurable liberté. Les pins du cimetière marin murmurent plus loin, sous brise caressante, la complainte cyclique de Paul Valéry :
« Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes ;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée
Ô récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux !
Quel pur travail de fins éclairs consume
Maint diamant d’imperceptible écume,
Et quelle paix semble se concevoir !
Quand sur l’abîme un soleil se repose,
Ouvrages purs d’une éternelle cause,
Le Temps scintille et le Songe est savoir… »
(Paul Valéry, Le Cimetière marin).
S’accumulent peintures parsemées de rivages et de paysages catalans, pièces dispersées d’une mosaïque reconstitutive, pistes incertaines de nouveaux élans, tropologies allusives en arrière-plans, hantées par des mythologies proches et lointaines. Il suffit parfois d’une esquisse à la mine de plomb, une barque échouée sur la plage, une saillie rocheuse dans le sable, deux arbres ailés en accolade, trois flamants perchés sur leurs échasses, pour déployer l’enivrante Camargue. Vincent Van Gogh, découvre la Méditerranée et « la mer bleue sous un ciel bleu » à Saintes-Maries-de-la-Mer. Il exécute en une semaine deux marines, barques éclatantes de contrastes polychromiques, une vue du village et neuf dessins. Il écrit à son frère Théo : « Je voudrais que tu passes quelque temps ici, tu sentirais la chose. Au bout de quelque temps, la vue change, on voit avec un œil plus japonais, on sent autrement la couleur ». Il enchaîne dès son retour en Arles avec trois peintures et une aquarelle, chargées de couleurs explosives, de paradoxalités incisives, d’intensités convulsives. Son bref séjour préfigure le tournant décisif et les époustouflants champs de blé, les hallucinants tournesols, les obnubilants cosmos étoilés. Pablo Picasso, en fulgurante interconnexion avec son prédécesseur, reprend le relais dans ses métamorphoses déroutantes et ses chromatiques déconcertantes.
Comment ne pas évoquer au détour le photographe arlésien de la Camargue, Lucien Clergue (1934 – 2014), ami de Pablo Picasso, de Jean Cocteau, de Max Ernst, de Saint John Perse, lecteur clandestin de Jean Genet, ses clichés uniques, graphiques, archétypiques des marais inondés de puissantes lumières, ses séries « Langage des sables », ses surimpressions taurines, ses shootings intimes des gitans et de Manitas de Plata, ses saltimbanques dans les ruines d’Arles ravagée par la guerre, ses déesses sculpturales sur les plages camarguais, ses oiseaux pétrifiés par les gelées gisants dans le sable, son film Delta de sel (1967), présenté au Festival de Cannes en pleine révolution soixante-huitarde ? En saisissant les cannelures amphigouriques des marées descendantes, les rayures cinétiques des luminosités distordantes, les spirales labyrinthiques des mousses fondantes, les striures fantomatiques des roseraies tremblantes, les modules concentriques des flamants dans la vase luisante, Lucien Clergue se réfère explicitement aux compositions picturales d’Henri Matisse, de Hans Hartung, d’Henri Michaux. La photographie fusionne avec la peinture dans l’abstraction lyrique et géométrique.
Les animaux camarguais sont des thématiques récurrentes dans les compositions de Marc Varvarande. Les bovidés sauvages, avec leur robe noire luisante et leurs cornes-lyres terrorisantes, victimes absolutoires des jeux taurins, semblent narguer la palette hésitante. Pablo Picasso s’en sort astucieusement avec ses tachismes, ses gravures et ses tracés d’observation. Le pinceau campe, en revanche, avec justesse, les indomptables chevaux gris et leurs crinières blanches en bataille, jaillissant des sagnes pour s’ébrouer dans les canardières. Ces chevaux sublimés dans les aquarelles d’Yves Brayer semblent sortir d’une rêverie suspendue. Chevaux indomesticables, en parfaite symbiose avec leur biotope marin, contraints aux travaux forcés par les colons humains. Qui mieux que le poète peut comprendre leur cabocharde tendance, leur indécrottable désobéissance, leur indéfectible indépendance ?
« Cent cavales blanches ! La crinière,
Comme la massette des marais,
Ondoyante, touffue, et franche du ciseau :
Dans leurs ardents élans,
Lorsqu’elles partaient ensuite, effrénées,
Comme l’écharpe d’une fée,
Au-dessus de leurs cous, elle flottait dans le ciel.
Honte à toi, race humaine !
Les cavales de Camargue,
Au poignant éperon qui leur déchire le flanc,
Comme à la main qui les caresse,
Jamais on ne les vit soumises.
Enchevêtrées par trahison,
J’en ai vu exiler loin des prairies salines ;
Et un jour, d’un bond revêche et prompt,
Jeter bas quiconque les monte,
D’un galop dévorer vingt lieues de marécages,
Flairant le vent ! et revenues
Au Vacarès, où elles naquirent,
Après dix ans d’esclavage,
Respirer l’émanation salée et libre de la mer.
Car de cette race sauvage,
La mer est l’élément :
Du char de Neptune échappée sans doute,
Elle est encore teinte d’écume ;
Et quand la mer souffle et s’assombrit,
Quand des vaisseaux rompent les câbles,
Les étalons de Camargue hennissent de bonheur ;
Et font claquer comme la ficelle d’un fouet
Leur longue queue traînante,
Et grattent le sol, et sentent dans leur chair
Entrer le trident du Dieu terrible
Qui, dans un horrible pêle-mêle,
Meut la tempête et le déluge,
Et bouleverse de fond en comble les abîmes de la mer
(Frédéric Mistral, Mireille, Quatrième chant, 1859).
Les flamants roses, emblèmes incomparables, bienfaisants, dit-on, par leur étincelance comme des sémaphores salutaires, arborent en toute désinvolture autant leurs silhouettes gracieuses, frétillantes, invulnérables que leurs postures étranges, extravagantes, guignolesques. Leurs parades nuptiales, leurs cabotinages synchroniques, leurs feintes et leurs esquives rythmiques, leurs gesticulations spasmodiques, leur bectance comique, tête immergée dans la mare, plumage en rotation mécanique, sont un régal pour les photographes et les dessinateurs en quête de pittoresque biologique.
La destinée de Marc Varvarande se reconstruit sous le signe du flamant, qui n’est autre que le mythique phénix. L’oiseau de feu, escorteur du soleil dans sa course perpétuelle, guide imperturbable des voyages interstellaires, connecteur de l’âme immortelle avec sa personnification temporelle, revitaliseur des hérédités essentielles, conducteur des réapparitions providentielles, est omniprésent dans l’ésotérisme égyptien, les mythologies méditerranéennes et les cosmogonies antiques. Le dieu Râ se transforme en phénix pour créer le monde. L’artiste n’est-il pas son avatar démiurgique, renaissant de sa désespérance à chaque entreprise, ressurgissant de chaque pénitence dans une œuvre-surprise, survivant à son crépuscule à chaque aube promise ?
Les terres mouvantes de la Camargue, paradis irremplaçables avec leur faune primitive, zones marécageuses converties en élevages et lieux de dévotions louangeuses des grenouillères divines, sont dès la préhistoire un lieu béni où les Ligures pêchent au harpon les poissons en abondance. Tite Live les voit « surgir de la glèbe sous le soc des charrues ». A l’époque romaine, la localité dédiée au culte du dieu égyptien du soleil, se dénomme Oppidum Râ. Ainsi naissent les mythes. La conquête chrétienne supplante les légendes préhistoriques. Selon l’hagiographie catholique, les Trois Maries, Marie Madeleine, Marie Salomé et Marie Jacobé, contraintes à l’exil par les Romains, débarquent en Camargue sur un bateau de pierre sans voiles et sans rames. Elles sont accueillies par Sara la Noire qui devient leur servante. L’esprit colonial en germe ne peut imaginer d’autre destin à une africaine, fusse-t-elle proclamée sainte. « L’an 1747, René d’Anjou envoya demander des Bulles au Pape pour procéder à l’inquisition de ces Corps Saints ; ce qui lui ayant été accordé, les Os des Maries furent mis dans de riches et superbes Châsses. Pour Sainte Sara, comme elle n’était de la qualité de ses Maîtresses, ses ossements ne furent renfermés que dans une simple caisse, qu’on plaça sous un Autel dans une Chapelle souterraine » (Jean de Labrune, Entretiens historiques et critiques de Theotyme et d’Aristarque sur diverses matières de littératures sacrée, Amsterdam, 1733). Le récit post-évangélique, gratifiant les personnages du Nouveau Testament du don d’ubiquité, déporte Marie Madeleine dans le massif de la Sainte Baume et fait inhumer Marie Salomé, Marie Jacobé et Sara la Noire à Saintes-Maries-de-la- Mer. Leur vénération se prolonge jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Est-ce un hasard si Sara, privée d’auréole, est devenue la sainte patronne des gens de voyage, des gitans et des tziganes, qui lui doivent peut-être leurs musiques tourbillonnaires et leurs festivités extraordinaires. Sainte Sara n’apparaît, en vérité, dans les traces écrites qu’au seizième siècle et son culte ne se manifeste qu’au dix-neuvième siècle (Vincent Philippon, La Légende de Saintes Maries, 1521). Mais que ferait une africaine dans cette contrée inhospitalière ? Selon d’autres légendes, Sara serait une princesse descendante d’une tribu celto-ligure et son teint basané ne serait dû qu’aux vents marins. L’adoration du reliquaire de cette icône atypique relève plutôt de l’animisme, des cérémonies païennes et des sabbats de sorcières. De quoi fleurir les fables mémorables de stèles et de sculptures, de peintures et de miniatures admirables. Que seraient les mythes et les légendes sans les chefs-d’œuvre perdurables ? Accourent au printemps, des quatre coins de la planète, les Yéniches, les Roms, les Manouches, les Gitans, les Tsiganes pour des célébrations dionysiaques où l’exhibition de la statue de Sara, symbole d’une culture sibylline et ténébreuse, nippée de robes chatoyantes et de breloques flamboyantes, et la procession jusqu’au rivage ne sont que des simulacres, puisant leur origine dans les rites voués à la déesse-mère phénicienne Ishtar et justifiant sous dévotes apparences les transgressions libératoires.
Le véritable saint dans l’affaire n’est-il pas un lointain descendant de l’aristocratie florentine, littérateur et manade camarguais, libertaire et pacifiste, protecteur des peuples nomades, défenseur des collectivités opprimées, des Indiens d’Amérique, des Boers d’Afrique du Sud, des Républicains espagnoles, le marquis Falco de Baroncelli-Javon (1869 – 1943). Disciple de Frédéric Mistral, il sauvegarde les traditions et les complète de novations inspirées de son ami Buffalo Bill (William Frederick Coky). Ainsi s’associent les gardians aux amérindiens et aux cow-boys dans le spectacle américain. L’autre incontournable figure aristocratique de la Camargue est le peintre et préhistorien russe Ivan Pranishnikoff (1841 – 1909), qui recense exhaustivement les mégalithes et les sites archéologiques languedociens et provençaux, et illustre de huit aquarelles originales le recueil de poèmes « Babali, Nouvello provençalo » de Falco de Baroncelli-Javon. Belle revanche du Chamanisme : les cippes exhumés dans la crypte de l’église de Saintes-Maries-de-la-Mer, considérés par le dogme canonique comme les oreillers des Saintes, sont, en fait, des pierres votives du rite celtique des Trois Matres, déesses de la fécondité et de la fertilité, romanisées sous le nom de Junons. Se dissimule et se perpétue, sous la récupération chrétienne du char naval, le culte païen de la mer et des forêts, et les processions de purification conservées dans les fêtes de carnaval. Garrigue miraculeuse aux vertus curatives connues depuis la nuit des temps. Les vignes plantées sur ilots de sable sont préservées de l’historique calamité du phylloxéra. Et les mystères de la sansouïre, argileuse et saline, boueuse sous la moindre averse, craqueleuse en saison estivale.
Ici mère nature invente l’insondable
Ici naît le mythe dans la source profonde
Perpétue l’ondine son œuvre inoxydable
Nul génie créateur qu’Océanos ne fonde
(Mustapha Saha, L’Arpenteur d’infini)
Tout être, par sa vision singulière, est un artiste en puissance tant que l’impérative adaptabilité sociale n’obstrue pas sa fontaine. Une illustration fantastique se réinvente instantanément en navette spatiale quand s’estompe la peur des croquemitaines. La créativité s’initie par la réunification de la sensibilité, de la volonté et de la cérébralité dans l’efflorescence intellectuelle. L’accès à l’art en cette occurrence est une maïeutique pour l’intervenant et les bénéficiaires, une découverte de la fonction vitale de l’art. L’approche aristotélicienne l’emporte, dans ce domaine, sur l’idéalisation platonicienne d’une beauté par définition inabordable. L’art n’est pas une illusion trompeuse, l’imitation d’une imitation, la représentation d’une représentation, l’apparence d’une apparence, mais la construction d’une réalité sensible qui restitue l’unité de l’intellect et de l’affect, cette unité génératrice d’une démarche épanouissante vers la connaissance, face au chaos de la vie quotidienne où la nécessité de survie et le fatras parasitaire des contingences brouillent la finalité de la vie. « L’art révèle le sens caché des choses et non pas leurs manifestations extérieures, car dans cette vérité profonde se trouve leur véritable forme » (Aristote). La forme ici est une action néguentropique, une interposition réorganisatrice d’une potentialité autrement vouée à la dégradation. La pratique artistique amorce, de ce fait, la lutte de l’être en éclosion contre les processus programmatiques de sa négation en tant qu’être. La sublimation de la réalité est un dévoilement des ressources intimes, un dépassement des médiocrités chroniques, une conquête de ce supplément d’âme qui façonne la dignité. L’artiste, qui ressuscite sans a priori la quintessence de l’existence et lui reconstitue une signification motivante, travaille les dynamiques vives qui rendent à l’humain sa pleine humanité.
Fossilisez l’impressionnisme dans les cryptes muséales, dans les monstrueuses enchères byzantines, il revient, dans ses carnations boréales, par les fenêtres d’une chaumière clandestine. Figez le cubisme dans les galeries germanopratines, il ressuscite loin des regards cupides dans une cabane brigantine. Plusieurs tableaux de Marc Varvarande évoquent l’éden enchanteur de Claude Monet à Giverny, l’étang protecteur des nymphéas énigmatiques, les samares rosacées des érables conjurateurs, les feuilles argentées des ginkgos biloba, les pétales polychromes des pivoines arbustives, les tiges sensitives des bambous flûteurs, les frondaisons nonchalantes des saules pleureurs et toutes les fleurs secréteuses d’ensorcelantes nuances et d’envoûtantes senteurs. Se reflètent sur miroir liquide les nuées vagabondes. Se restituent les passerelles japonaises dans leurs érubescences pudibondes. Se retrouvent sur d’autres compositions la sagesse zen, les jardins parsemés de lotus sacrés et de pins nacrés, de cèdres et de cyprès, de camélias et d’azalées, sous bénédiction lumineuse des pagodes silencieuses et des lanternes précieuses. La niche écologique du jardin, propice à la prière, avec ses montagnes et ses rivières, ses bois et ses clarières, ses lacs et ses sablonnières, ses refuges et ses renardières, miniaturisés à l’échelle humaine, n’est-elle pas le paradigme ? La gestuelle reproduisant la diversité complémentaire, la complexité sédimentaire, la déambulation serpentaire, épouse la main créatrice de l’univers. Poussent les roses trémières au gré des touches traversières.
Une peinture chamanique, médiatrice entre l’artiste et sa pulsion créative, fondatrice de son image sociale, régulatrice de son rapport au monde. Quand une œuvre, fusse-t-elle exécutée avec une parfaite maîtrise technique, est dénuée d’atma, elle ne suscite point l’émotion esthétique, l’escapade onirique, l’exaltation poétique. Il manque aux œuvres froides, comme les affiches de réclame impeccablement exécutées, l’essentiel, la vivifiante étincelle. L’âme artistique se comprend comme « l’entéléchie première d’un corps naturel qui a la vie en puissance » (Aristote). Pline l’Ancien nomme cette âme la grâce, que les grecs appellent khárisma ou charisme. L’œuvre d’art porte à jamais la fièvre conceptive, la tourmente gestative, l’allégresse procréative qui lui insufflent sa vie. S’imprègne son environnement de ses radiations telluriques et cosmiques. Se comprennent, dès lors, ses aimantations pulsatives, ses radiations interpellatives, ses modulations connectives. Toute négation, toute dépravation, toute destruction de ce patrimoine vivant est un crime contre la vie. Nommons ce phénomène, expérimenté depuis l’aube de l’humanité, chamanisme artistique. Qu’on ne s’étonne donc pas que, dans les périodes paléolithiques et néolithique, et aujourd’hui encore dans les pratiques ancestrales, l’artiste soit le sorcier, l’intercesseur avec les esprits, le messager des présences invisibles.
Le chamanisme s’entend comme une ascèse de libération, une source d’inspiration, une matrice de création, un chamanisme sous-tendu par la culture occitane depuis la nuit des temps. Nulle interférence avec les improvisations contemporaines, les récupérations folklorisantes, les performances rhumatisantes, les installations hystérisantes, en autoréférence circulaire. Nulle conceptualisation mimétique. Nulle rétroprojection narcissique. Nul artifice médiatique, réificateur des goûts artistiques. L’épreuve de vérité passe par les tissures de jute et de lin. Marc Varvarande s’installe résolument dans la peinture impressionniste, l’huile en permanente transmutation pigmentaire, la toile en rémanente transfiguration moléculaire, l’imaginaire en expectance des métempsycoses plastiques, des figures significatives au-delà des perceptions chaotiques. Les variations continuelles des éléments interagissent avec les humeurs et les sentiments, les tristesses et les allégresses, les marcescences et les floraisons, les morbidités et les guérisons. Comment capter les neiges étincelantes et les nappes miroitantes, les lames déferlantes et les brumes flottantes, les clartés chancelantes et les ombres vacillantes, les aubes naissantes et les nuées rougissantes, les ondines tournoyantes et les nymphes fuyantes, en leur préservant leur fluctuosité saisissante ? Comment saisir l’évasive énergie métamorphosante ? L’impressionnisme est un chamanisme.
Cette spécificité existentielle s’illustre dans le mythe de Pygmalion, inspirateur des alchimies golémiques. Pygmalion tombe amoureux de la statue d’ivoire surnommée Galatée, sculptée de ses mains, qu’Aphrodite, exauçant les prières ferventes de l’artiste, anime du souffle de la vie. La sculpture « a l’apparence d’une vraie jeune fille, on pourrait la croire
vivante et, si la réserve ne la retenait, prête à se mouvoir ;
tant l’art se dissimule à force d’art. Pygmalion est émerveillé
et les feux qu’éveille ce semblant de corps emplissent son cœur.
Souvent il s’approche, ses mains palpent son œuvre, ne sachant si elle est de chair ou d’ivoire ». « Vénus en personne qui, toute parée d’or, était présente à ses festivités, comprit le sens de ces vœux et, en présage de la bienveillance divine, la flamme trois fois se ralluma et éleva dans l’air sa langue de feu ».(Ovide, Les Métamorphoses). La vertu magique de l’art dans la transmutation de la matière, des pigments, de la cire, de l’agile en chair est non seulement symbolique et sémiotique, mais également physiologique et somatique dans la mesure où l’artiste s’arrache des lambeaux de peau pour les injecter dans son œuvre. L’art danse sur le fil instable entre l’être et le néant. Les aveugles ont naturellement le don d’extralucidité tactile quand ils ressentent instantanément les palpitations de l’œuvre qu’ils caressent.
Dans sa pièce lyrique « Pygmalion », Jean-Jacques Rousseau entrouvre un coin du voile d’où une parcelle d’âme transperce le cœur de l’auditeur par le sortilège des mots et déclenche des émois intérieurs d’empathie. L’attraction s’opère entre le vibrato de la voix qui s’énonce et s’incorpore à la musique et les frissonnements de la statue qui s’anime. L’écran de la représentation se déchire pour mettre directement les sens en prise avec la source de leur éblouissement. Les interprétations psychanalytiques sur la machine désirante passent à côté de l’immanente sublimité et s’empêtrent dans le fantasme érotique. La vierge d’ivoire et de chair échappe par bonheur aux concupiscences captives et aux lascivités projectives. C’est en s’affranchissant des pièges de la sensualité qu’Eros peut accéder aux mystères de l’engendrement où couve l’inexplicable. L’énergétique substantialisation de l’art ne se réduit pas à l’art de l’amour. Le désir esthétique est d’une autre nature, dans la fusion de tous les désirs justement, dans le fulgurant sentiment de complétude. L’ardeur pygmalionienne, loin d’être libidinale, exprime l’introjection de l’œuvre au point de s’y dissoudre, l’abolition de la dissociation du créateur et de la création, l’immortalisation palpable en quelque sorte. Tout l’enjeu de l’art se trouve dans cette gageure insensée, l’incarnation du double, le renversement de la logique existentielle, la conversion de la blancheur pétrifiante en rougeur tonifiante, de l’étoffe inerte en fibre ardente. Ainsi la vache en bronze de Myron, qui rend fous les taureaux. N’est-ce pas depuis ces temps immémoriaux que les bêtes à cornes ont peur du rouge et que les corridas célèbrent leur mise à mort expiatoire ? Ainsi les sculptures de Dédale sont si criantes de vérité qu’il faut les enchaîner pour les empêcher de s’échapper (Platon, Ménon).
Une peinture méditative, évacuatrice des tensions endogènes et des pressions exogènes, qui puise dans la nature son oxygène salutaire. Le thème de la forêt, dans son homosphère automnale, sa perpétuelle reviviscence germinale, sa symphonie de couleurs chaudes, d’ambres, de cuivres, de rouilles, invoque l’osmose organique, la synergie magnétique, la clairvoyance chamanique. S’honorent en cette saison des renouvellements prometteurs, les arbres sacrés, le pommier prodigueur des connaissances magistrales, le bouleau catalyseur des renaissances centrales, le chêne transmetteur des énergies astrales, le houx préservateur des secrètes martingales, le saule pérenniseur des traditions matriarcales, le noisetier détecteur des sources vitales, le sapin porteur des espérances natales, l’aulne protecteur contre les séductions fatales. Et tous les arbres guérisseurs qui diffusent en douceur leurs senteurs plaisantes et leurs essences bienfaisantes. S’immiscent, à peine détectables, quelques étranges lueurs d’étoiles lointaines. Nul hasard si la quête ontologique se conjugue avec la curiosité mythologique. Les arbres se campent, dans les œuvres de Marc Varvarande, comme des entités fabuleuses, thaumaturgiques, totémiques. La forêt basilicale, bruissante d’intelligences musicales, semble attendre quelque visite amicale pour recueillir ses visions synesthésiques, ses méditations mystiques, ses envolées extatiques. Le premier homme et la première femme, Ask et Embla, n’ont-t-ils pas été façonnés dans des souches d’arbres, selon les légendes nordiques ? N’ont-ils pas reçu leur connaissance du frêne qui n’est d’autre que le premier dieu Yggdrazil, pilier central du monde et de l’univers ? L’humanité née des arbres trouve son salut par les arbres. Sans ces poumons de chlorophylle, la planète ne serait qu’un désert dépeuplé. Dans le shintoïsme japonais, c’est grâce au sakaki, orné par les dieux de bijoux somptueux, d’offrandes blanches et bleues, et d’un miroir révélateur de l’archétypale beauté que la déesse Amaterasu est sortie de sa grotte pour inonder de lumière le ciel et la terre. Ainsi se relie la création artistique, dans son intuitive inspiration, à la sève originelle. Marc Varvarande excelle dans le pointillisme végétal, le pigmentisme minéral, le rendu textural des pierrailles, des murailles, des poussières purpurines et des particules azurines. L’atmosphère provençale est rendue dans ses coruscations hivernales, ses quiétudes matinales, ses immuabilités méridionales. Le temps arrêté couve le regard de tonalités apaisantes. Les marines dans les petits ports désertés au coucher du soleil se focalisent sur les plantes odorantes, les eaux murmurantes, les barques dormantes. L’on imagine l’artiste, en quête de paix intérieure, planter, sous veilleuse zénithale, son chevalet face au grand large dans un retour panthéistique aux contemplations limpides…
© Mustapha Saha
Sociologue, poète, artiste peintre

HOMMAGE A AIME CESAIRE (1913 – 2008)
PAR MUSTAPHA SAHA
LES MOTS NUS
PAR MUSTAPHA SAHA
Que peuvent les mots nus quand sonnent les clairons
Quand s’éclipse la lune au rythme des alarmes
Quand s’endeuillent les clowns et les joyeux lurons
Quand s’abreuve l’amour aux collecteurs de larmes
Que peuvent les mots nus quand s’embrasent les tours
Quand voltigent les corps comme fétus de paille
Quand s’invite la bourse au festin des vautours
Quand s’unit la canaille aux funestes ripailles
Que peuvent les mots nus quand rodent les vampires
Quand traînent dans la boue les âmes sans ressort
Quand s’écroule d’un coup l’invulnérable empire
Quand s’arment les enfants pour conjurer le sort
Que peuvent les mots nus quand s’extirpent les lombes
Quand germe la guerre dans les mares d’or noir
Quand tombe au petit jour la dernière colombe
Quand spéculent sur l’art les affreux tamanoirs
Que peuvent les mots nus quand meurent les sirènes
Quand flambent les cités pour un bout d’oriflamme
Quand s’écrit la gloire dans le sang des arènes
Quand s’enfuient les serpents des ziggourats en flammes
Que peuvent les mots nus quand pleuvent les missiles
Quand s’ébattent les chiens dans les maisons sans porte
Quand crache la terre ses ténébreux fossiles
Que peuvent les mots nus que vent de sable emporte
ELISABETH ET MUSTAPHA SAHA EXPOSENT
A LA RENCONTRE INTERNATIONALE DES ARTISTES DE LA KASBAH DE PARIS.
VERNISSAGE VENDREDI 13 AVRIL 2018 A 18 HEURES
GALERIE JOSEPH FROISSART
7, RUE FROISSART, 750033 PARIS.
PARIS.
Elisabeth Bouillot-Saha : Déesse Mère
Peinture sur toile. Dimensions : 100 x 65 cm.
Mustapha Saha : Portrait de Mohamed Choukri, écrivain.
Peinture sur toile. Dimensions : 100 x 65 cm.
La Rencontre Internationale des Artistes de la Kasbah à Paris, réunissant des artistes des cinq continents, ritualise cet événement comme convergence festive des diversités créatives, confluence interactive d’inventivités plurielles, croisée constructive de sensibilités culturelles. Depuis la nuit des temps, la culture tisse la trame impérissable des civilisations au-delà des frontières différenciatives. La culture en partage est l’inestimable et perdurable patrimoine humain, la source intarissable de sa mémoire, la perspective incommensurable de son devenir. L’art est la prescience intuitive du sens de l’existence, l’étincelle orbitaire de l’invisible, la scintillance salutaire de l’imprévisible. L’humaine humanité, libérée des puissances des ténèbres, s’accomplit et s’épanouit dans les synchronicités novatrices, les simultanéités fécondatrices, les réciprocités stimulatrices. Le monde de demain germine dans le célébration artistique de la fraternité planétaire. Mustapha Saha




Misère expositionnelle du Maroc au Salon du Livre de Paris
Par Mustapha Saha
Rien de plus terrible que la présence dans l’inexistence. La regard panoramique du patriarche, colère rentrée, fulmine avec flagrance. Ses publications s’enterrent dans un angle mort. Des bricoleurs de fausses mélusines, d’indigestes recettes de cuisine, encombrent l’espace vital. Ses collègues avisés ménagent son autorité morale. La précarité de la situation commune commande, au-delà des crispations concurrentielles, une solidarité tacite. Rachid Chraïbi se retranche derrière sa stoïcité légendaire. La qualité des éditions Marsam n’a point besoin d’argumentaire. L’autorité de tutelle brille par son absence. L’indémontable mécanique makhzénienne impose toujours ses entraves pernicieuses. Le ministère de la culture, prétextant sa coutumière insuffisance budgétaire, s’est contenté de louer une superficie ridicule dans la plate-bande réservée par les organisateurs aux anciennes possessions coloniales. La réédition des littératures protectorales par les éditions Dar Al man rappelle la folklorisation infantilisante des civilisations maghrébines. Les exposants s’investissent et se déplacent à perte. L’éditrice Amina Alaoui Hachimi résume : « Nous sommes ici pour perdre notre argent dans l’invisibilité totale ». Après avoir gâché l’opportunité de l‘année précédente où il était invité d’honneur, le Maroc entache son image culturelle sous l’enseigne insignifiante « Editeurs marocains », déclinée hors sémiotique nationale, dans un lettrage endeuillé de noir sur marron lavallière automnal.
Les goncourtisés d’outre-rive évitent de se montrer dans la boutique dépréciative, moussent ailleurs, sous projecteurs, leur gloriole acquise. Les polygraphes médiatisés n’existent que par les médias qui les exhibent. Je contemple en contre-champ la patiente abnégation et la bougonnerie drolatique de Salim Jay expectant les introuvables quêteurs d’autographes. Le personnage, tisseur pointilleux de toiles mémorielles, ressemble aux chroniqueurs méticuleux des temps révolus. Son Dictionnaire des écrivains algériens aux éditions La Croisée des Chemins complète fructueusement son Dictionnaire des écrivains marocains (Editions Paris Méditerranée – Eddif, 2005). Une scène cocasse égaye un instant l’atmosphère. Fouad Laroui, star des éditions Julliard, affiché plus loin sur panneau publicitaire, faute de caméra dans les parages, s’interviewe lui-même sur son smartphone à toute fin utile. Dans le bazar internétique, toutes les traces vidéographiques se valent.
Le jeune directeur des éditions Bouregreg, Hicham Alami Ouali, se réfugie dans un sourire impénétrable. La résignation est sœur consolatrice quand s’éloigne mère conseillère. Il désigne du doigt les pyramides écrasantes de la puissance invitante. Le cynisme libéral n’honore que les forces de frappe financière. Je lui dédie un quatrain : Couve sa migrante prodigue Saint-Laurent / Par-delà l’océan le Bouregreg sommeille / Yasmina transcode les signaux récurrents / De l’étoile verte dans sa voûte vermeille (1). Les éditions Bouregreg peuvent se prévaloir de quelques titres d’intérêt durable : Les voix de Khair-Eddine d’Abdellah Baïda, l’essai de Fatima Senhaji sur l’écriture romanesque d’Ahmed Sefrioui et Driss Chraïbi, l’actualisation du maître soufi du douzième siècle Ahmed Ibn Idriss par Zakia Zouanat, inspirateur avec Ibn Arabi de l’Emir Abdelkader…
Le patron de Virgule Editions, Ahmed Abbou, tourne en rond comme un fauve assagi dans sa cage. Il m’offre plusieurs nouveautés marquantes. Eros maudit ou le sexe des arabes d’Abdelhak Serhane dénonce, avec une irréfutable compétence universitaire, l’insidieuse tyrannie de l’orthodoxie musulmane, et des pratiques quotidiennes qu’elle légitime, sur la sexualité et le corps irrévocablement condamné comme un couvoir de péché. Corps des femmes enfermé dans la geôle vestimentaire. Corps des hommes rejeté dans la frustration solitaire. Corps schizophrénique des nantis, vertueux en apparence, libidineux en cachette. La morale liberticide pressure en toute impunité la dignité humaine. L’obscurantisme religieux aliène l’esprit et pétrifie l’existence pour soumettre la société entière à son contrôle. La libération citoyenne commence par la réappropriation de la vie charnelle et l’épanouissement des sens. Chez le même éditeur, Mostafa Nissabouri, réunit en un seul volume, sous le titre A peine un souffle, l’œuvre poétique complète d’Abdelaziz Mansouri, seize ans après sa mort. Un trésor insoupçonnable surgi des tréfonds de l’oubli que mémoire littéraire portera sans nul doute au pinacle des illuminations incomparables. S’évoque au détour Tayeb Saddiki à propos du portrait polymorphe qu’en dresse Ahmed Massaia. Le bon dieu ne crée ce genre de dramaturge qu’en exemplaire unique pour marquer une contrée du sceau de son géantisme.
L’arrivée d’Abdellah Baïda sort l’ambiance léthargique de son nocuité déprimante. Son nouveau roman Testament d’un livre aux éditions Marsam rapporte le témoignage transhistorique d’un grimoire condamné à l’autodafé. Le livre, conscience de la conscience en voie d’extinction, se personnalise quand l’humain se robotise. Le même auteur a dirigé un ouvrage collectif consacré à Mohamed Leftah, styliste exceptionnel, longtemps censuré par la bienpensance institutionnelle, toujours ignoré par la mercatique culturelle, destiné à une reconnaissance tardive et perdurable (Mohamed Leftah ou le bonheur des mots, éditions Tarik, 2009). S’estompera dans l’ombre éternelle la médiocrité triomphante vouant les figures immortelles aux géhennes pendant sa superbe temporaire.
Mouna Hachim apporte opportunément son rayon de soleil, son intelligente beauté et sa merveilleuse humilité. Dans le désert éditorial, elle plante obstinément sa tente éclairée. Nulle trace dans les rayonnages de sa dernière somme, Chroniques insolites de notre histoire, éditée à compte d’auteur. Une traversée savante des héritages antiques, des synergies ethniques, des périodes amphigouriques, des crises dynastiques, des principautés énigmatiques, des effervescences maraboutiques, des violences dogmatiques, des préfabrications mythiques. Une lecture anticonformiste et vivifiante d’une culture organiquement diversitaire, sans cesse enrichie par ses complexités contradictoires. Puisse son livre trouver une édition et une diffusion à sa hauteur. Rappelle-toi la muse au pays des merveilles / Le trésor vert et rouge dans son tiroir / Et son démon qui dort et son ange qui veille / Et la porte ouverte dans son plafond miroir (1).
En fin de journée, dans le stand boudé par les visiteurs, je plonge, assis par terre, dans la lecture du livre posthume de Paul Pascon, Un été dans le Haouz de Marrakech, architecturé avec beau savoir-faire par Abdelmajid Arrif et Mohamed Tozy (éditions La Croisée des Chemins). Une source vivante une ressource captivante, révélant le laboratoire du chercheur actif, par-delà le dilemme engagement – distanciation, articulant notes de travail et matériau d’enquête, observations vives et pérennisations photographiques, notations scientifiques et courbes synthétiques. Derrière la rigueur méthodologique se profile la part tâtonnante, créative, inventive de solutions inédites. Paul Pascon était à la fois sociologue, anthropologue, historien, agronome, biologiste… et artiste, une polyvalence croisant les réfractions multiples, les éclairages de toutes parts, unifiant les paradoxalités tonifiantes, pénétrant les quintessences énergisantes des moissonneurs et des laboureurs sans états d’âme, armés d’outils rudimentaires, travailleurs au corps à corps de la terre nourricière, embauchés comme intérimaires sur une place de grève de Bab Doukala, des sans-terre inébranlables dans leurs convictions profondes, impénétrables aux influences extérieures. L’oralité rebelle dissimule des expressions artistiques, des univers poétiques, des transmissions initiatiques, des transgressions clandestines de l’uniformisation bureaucratique. « Il s’agit toujours de transmettre (naqala), de réinterpréter un fait appartenant à un univers, dans un autre univers. Et nous, en le recevant, nous le réinterprétons encore. Qui prétendra que ce n’est pas aussi – volontairement ou à notre insu – pour nos propres batailles d’idées » (Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, 1977). Se reconstruit dans cette œuvre une sublimation du rapport à la nature et une dignité paysanne. L’écriture restitutive se double d’une mémoire visuelle ouverte aux explorations imaginatives. Remontée vive de souvenances d’enfance…
Mustapha Saha
Sociologue, poète, artiste peintre









(1) Mustapha Saha : L’Arpenteur d’infini. Livre de poèmes présenté par Edgar Morin.
Reportage photographique © Elisabeth et Mustapha Saha.
Avec Abdelkader Retnani (éditeur), Amina Alaoui Hachimi (éditrice), Fadela M’Rabet (écrivaine), Maido Hamisultane Lahlou (Ecrivaine), Abdellah Baïda (écrivain), Elisabeth et Mustapha Saha (écrivains et artistes peintres).
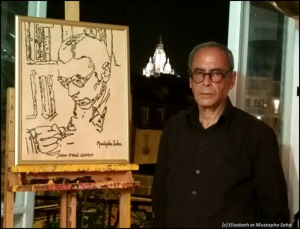

OÙ SONT LES PHILOSOPHES ?
PAR MUSTAPHA SAHA
Où sont libres parleurs au forum des torcols
Où sont merles moqueurs des belles tragédies
Où sont magots railleurs aux barbes des blancs cols
Où sont génies farceurs des saintes parodies
Où sont veilleurs d’esprit dépurés de pétrole
Où sont déconstructeurs d’imprenables bastilles
Où sont maîtres-penseurs délivrés du contrôle
Où sont débroussailleurs d’impossibles tortilles
Où sont fous de sagesse aux marges du délire
Où sont pisteurs de sens au temps des catastrophes
Où sont forgeurs d’idées au creux des tirelires
Dans ce monde improbable où sont les philosophes
© Mustapha Saha
Sociologue, poète, artiste peintre
Portrait de Jean-Paul Sartre. Par Mustapha Saha
Encre de chine sur papier. Dimensions 60 x 50 cm
Photographie © Elisabeth et Mustapha Saha
PORTRAIT DE MOHAMED CHOUKRI.
PAR MUSTAPHA SAHA
Peinture sur toile.
Dimensions : 100 x 81 cm.
Copyright Mustapha Saha.
Tous droits réservés.
Cette oeuvre sera exposée pour la première fois
dans le cadre de la Rencontre Internationale des Artistes de la Kasbah
à Paris du 9 au 14 Avril 2018.
L’ARPENTEUR D’INFINI
PAR MUSTAPHA SAHA
Mille trois cent cinquante au creux du siècle sombre
Je n’eus que l’abaque pour tromper mon angoisse
Et les chiffres romains pour supputer les nombres
Quand la grande peste dépeuplait les paroisses
J’acquis l’art des échecs pour braver la Camarde
Elle misait du temps je jouais mon destin
Vainqueur je repartis sous mon manteau de barde
Vers d’autres royaumes sans macabres festins
Au bout de ma route la verte Andalousie
Les minarets voisins des blanches synagogues
Des cultures brassées sans vaine jalousie
Les maisons ouvertes des savants pédagogues
Le savoir obsolète embrumait ma mémoire
J’aurais capitulé dans ma triste pénombre
Si mon hôte arabe n’avait dans ses grimoires
De l’Inde lointaine la doctrine des nombres
J’explorai les replis des comptes circulaires
La féconde alchimie des caractères libres
Le vide impératif du symbole oculaire
Les valeurs mouvantes sur des traits d’équilibre
Je perçus l’infini dans les choses modestes
La sphère algébrique constellée d’inconnues
L’écho numérique des symphonies célestes
La danse des signes sur le parchemin nu
Je pus me défaire des bouliers inutiles
De la planche à calcul des jetons superflus
Traduire en formules les énigmes subtiles
Et du dogme abaciste annoncer le reflux
L’Eglise condamna l’infâme sacrilège
Les marchands maudirent la découverte immonde
Les scribes grognèrent pour leurs bas privilèges
Mais l’œuvre algoriste sapait déjà leur monde
Je passais mes journées cloîtré dans mon étude
Classant les naturels sur des tracés logiques
Pistant les grands premiers avec incertitude
Croisant les diviseurs dans des carrés magiques
Je voulais comprendre l’expansive limite
Où l’espace et le temps n’étaient qu’un seul miroir
Capturer le reflet de l’invisible ermite
Inlassable artisan d’univers à tiroirs
Faute d’élucider la moindre conjoncture
Je traquai les vices des suites lancinantes
Guettai la malfaçon dans chaque architecture
La folie menaçait ma raison déclinante
L’asile inopiné d’une belle érudite
M’arracha des griffes du funeste démon
Je retrouvai la paix dans sa tour interdite
Et comblai de son nard mes sens et mes poumons
Il fut dit que bonheur couvait douce tourmente
Mon cœur vite lassé des servantes dociles
Des vapeurs de sauna des baisers à la menthe
N’aspirait qu’à s’enfuir loin des plaisirs faciles
Je rêvai de nouveau d’envoûtants territoires
D’étincelles jaillies d’insondables figures
Au-delà du détroit d’autres laboratoires
L’étoile du berger incarnait mon augure
Je quittai Grenade pour l’Empire des sables
Les jardins parfumés pour l’or de Tombouctou
Je cherchais dans les ergs la clef de l’impensable
Les arcanes du rien la matrice du tout
Je vis l’éternité perlée par les secondes
Le désert concentré dans un grain minuscule
Le bruit décomposé sur la grille des ondes
Le soleil condensé dans chaque particule
Un moustique énervé me choisit pour victime
Injecta son poison dans ma chair innocente
Et fit de mon voyage une dérive intime
Et revoilà la Parque et sa serpe indécente
A quoi me servaient donc les atouts de ma mise
Mes secrets d’alchimiste et mon art au cordeau
N’aurais-je pas troqué si magie fut permise
Toutes mes lumières pour une gorgée d’eau
Mon corps déshydraté comme antique momie
Chétif et rétréci comme peau de chagrin
Couvert de poussière comme un texte endormi
N’avait pour suaire qu’un cuir de pérégrin
Des génies chroniqueurs surgis du fond des âges
Creusaient leur alphabet dans ma pauvre ossature
Des tourbillons de sable érodaient mon visage
Je n’étais qu’une empreinte un reste d’écriture
Mon âme décrochée de sa gaine fragile
Voltigeait sans contrainte et sans coupable pensée
Entre dune mouvante et cuvette d’argile
Et puisait son nectar dans des fleurs impalpables
Elle était tout à tour silex et calamite
Essence d’églantine et parfum de santal
Bâton de voyageur et chandelle d’ermite
Grammaire énigmatique et prosodie vitale
Elle était musique portée par les orages
Mémoire tellurique et céleste oxymore
Et nimbe azurine d’un fabuleux mirage
Et rouge griffure dans le livre des morts
Le septième palier fut nuit de guérison
Je me levai matin comme un coureur ailé
Des bulbes d’émeraude émaillaient l’horizon
La Cité des lettres m’ouvrait son propylée
© Mustapha Saha
Sociologue, poète, artiste peintre
Mohammed Khair Eddine, le poète médusé
Par Mustapha Saha


Mohammed Khair Eddine, foudroyé par la camarde en pleine force de l’âge, traverse la littérature comme une étoile filante, emportant, dans son auto-consumation flamboyante, ses révoltes épidermiques, ses transgressions pathologiques, ses arborescences stylistiques. L’éternel adolescent atrabilaire taille très tôt, à coups de néologismes ravageurs, sa statue d’enfant terrible, cuirassé dans la carapace d’arthropode, cerné d’indomptables antipodes, halluciné de tragiques apodes. De métamorphose en métempsychose, l’ombre de Kafka veille sur son écritoire. La nausée s’éclabousse en échappatoire. Entre verve accusatoire et sentence abrogatoire, la stance, infusée d’oralité prosaïque, multiplie semonces et réquisitoires. Les rafales de mots, dissociés de leur structure sémique, médusent la critique. Le sens s’engloutit dans la bétoire anaphorique. La plume injecte sa glaire polychrome dans l’incandescente blessure butinée par des abeilles sauvages. La cruauté se constelle dans l’entrechoc des syntagmes. Les paradoxes s’étouffent dans le diaphragme. L’indéfinissable souffrance se dénaturalise dans la vocalise. Les sinuosités significatives s’entremêlent jusqu’à l’électrocution libératrice. Une écriture parodique, taraudée par l’oubli, allergique aux prérogatives établies, destructrice des paradigmes prosodiques. L’insubordination systématique s’idéalise. Les correspondances chambardées, les concordances démantelées, les métaphores fracassées se succèdent dans une avalanche d’images insaisissables. Les strophes se replient sue elles-mêmes comme des talismans indéchiffrables. L’effet cyclone produit instantanément son vertige. Entre verve accusatoire et sentence abrogatoire, la stance, infusée d’oralité prosaïque, multiplie semonces et réquisitoires. Le potache inaccompli prend un malin plaisir à cultiver l’incompréhensible. L’intelligible est jeté aux hyènes. Une technique éprouvée de la diversion. Un coup de pioche dans la fourmilière et que saillisse pépite inespérée dans la dispersion ! Le dithyrambe explosible traque l’invisible dans ses replis intraduisibles. Le choc poétique s’étincelle dans l’imprévisible. Qu’importe la cible, le verbe irascible, la fureur incoercible, seul compte l’indicible.
Le poète maudit pratique sciemment, méthodiquement, l’art de la guérilla linguistique, la circonlocution pour échapper aux chemins battus, la réitération pour débusquer les fausses vertus, l’amplification pour dévoiler les mobiles secrets, la digression pour démonter les machiavéliques décrets, l’élucubration pour révéler les perfides non-dits, la divagation pour braver les absurdes interdits, la provocation pour secouer les âmes endormies. Mohammed Khair Eddine s’inscrit, en vérité, dans la vieille tradition des poètes libertaires, des fous éclairés, des mystiques illuminés, des troubadours irrécupérables, analystes intraitables des tares sociétales, brocardeurs indomptables des prépotences gouvernementales, hurleurs insupportables d’évidences vitales, sans cesse vivifiés par la mémoire populaire. Abderrahmane Al Majdoub, réactualisé par une célèbre pièce de Tayeb Saddiki, en est l’exemple spectaculaire. Ses quatrains sont gravés dans la mémoire collective en maximes et proverbes.
Le récit fragmenté difflue dans des laves flambantes, des cendrées retombantes, des vapeurs aveuglantes. L’inextricable contexture volatilise les visions obsessionnelles dans la fugacité, les entités conventionnelles dans l’opacité, les détonations passionnelles dans l’herméticité. La discontinuité discursive sape à la racine la logique narrative. L’auteur assume sa névrose mal corrigée, sa rêverie mal dirigée, son architecture mal érigée. L’idée s’abrège au seuil de la formulation. N’en demeurent qu’ondulations coruscantes. L’incendiaire proclamé sème des flammèches.
La stylistique fractale d’Agadir télescope les vociférations segmentales dans une étourdissante descente au purgatoire. Khair Eddine s’incorpore toutes les malédictions sociétales, se scarifie de griffures létales, quête âprement la phrase totale. La ville, désintégrée par la secousse fatale, dégorge ses déliquescences congénitales. La terre, trippes dehors, exhibe sa tragédie sans décors. L’auteur-narrateur, sombre enquêteur, ne retrouve de la condition humaine que mutilations sous les décombres. Le cataclysme matérialise le malheur dans son paroxysme. La fin du monde se concentre sur un point focal. Le chaos abolit la mémoire. L’histoire passe à l’écumoire. Le sens de l’existence s’atomise dans la poussière. Ne subsiste dans les gravas qu’amnésie générale, le déracinement comme mutation spectrale, l’exode comme désespérance latérale. Le râle des survivants désagrège la raison. Le témoignage se fait séisme mental. Le récit s’enduit d’invraisemblance pour occulter l’insoutenable. Les thématiques sépulcrales ne drainent que pétrifications cadavériques, locutions colériques, liquéfactions métaphoriques. La catastrophe meurtrière exaspère l’arrachement à la mère nourricière. L’expérience traumatique se porte comme hallucination douloureuse qu’écriture, antidote initiatique, transfigure en exaltation fiévreuse. L’angoisse chronique laisse libre cours aux mirages compensateurs. La cité cauchemardesque reconstruite à la hâte n’est qu’un agglomérat de cages à lapins, dégarnie de ses sapins, peuplée de perroquets sous férule du grand vautour, gardée par des mille-pattes venimeux. L’allégorie se projette à l’échelle du pays. Le peuple dans sa totalité grouille dans ses chromosomes. L’imago affronte inépuisablement ses rhizomes. L’autistique ubiquité n’a d’autre échappatoire que la feuille blanche, avec l’obsédante perception baudelairienne de l’esthétique, l’art de représenter la charogne et d’exprimer le beau, la recherche macabre du sublime dans le tranchant de la lime, l’extase solaire dans l’horreur caniculaire, la transcendance stellaire dans la putréfaction cellulaire. L’œuvre entière, perception kaléidoscopique d’un monde inabouti, se compose d’éclats cimentés de soudures miraculeuses. Le raconteur se démultiplie dans les personnages anonymes. Les zombies persécuteurs essaiment sous acronymes. Le poète, sous pression volcanique, ne recule devant aucun blasphème, aucun sortilège, pour démystifier les sortilèges, vouer les privilèges aux géhennes. Il s’excommunie d’une société honnie avant d’en être banni. Il s’exile dans la langue française et les mythologies sarrasines, se réfugie dans les bras de mélusine, endosse la cotte d’ouvrier d’usine, noie son désarroi dans la résine. L’hérétique errance se fantasme en atavique transhumance. La conscience meurtrie se ranime dans la fougue contestataire.
Le déterreur, déracineur méthodique des tubercules folkloriques, apostropheur frénétique du patriarche inamovible, personnification de toutes les autorités oppressives, dénonciateur enragé des servilités endémiques, rêvasseur impétueux d’animisme régénérateur, ne reconnaît de sa berbérité que ses traces archéologiques, ses rémanences didactiques, ses survivances artistiques. Roman parabolique de la dérobade où la nécrophagie, hallucination éthylique, dissimule la hantise de la dégénérescence précoce. Le désir de la table rase, qui liquide l’héritage perverti du passé et purifie le présent se dogmatise. L’incurable écorché vif, déçu par le modeste impact de ses livres, se réfugie dans la nimbe diffuse de l’incorruptible lumière, l’expectation prophétique de fulgurances lyriques. Le grognard impénitent, claustré dans sa thaumaturgique montgolfière, défie les montagnes de son ire convulsive, difracte les nuées de ses illuminations subversives, brandit ses carences d’inspiration comme étendards de sa transgression séculière. Chaque ouvrage est un psychodrame orchestré par une crise existentielle. Le délirant céleste transperce les murailles, nargue les mitrailles, enguirlande les entrailles, organise ses propres funérailles dionysiaques. Le saltimbanque, tapir farouche et crépusculaire, scénarise inlassablement son carnaval. Le chamelier écervelé s’invente intarissablement son festival, ses cortèges de démons et de sorcières, ses rondes de fantoches et d’ectoplasmes, ressuscite le bestiaire de Lautréamont enrichi d’une faune exotique. La forteresse solitaire de l’écrivain est protégée par des myriades d’insectes et de reptiles convertis en signes alphabétiques. La déroutante vipère incarne Les vacillations libidinales. La lubricité s’infiltre entre morsure et fissure, griffure et biffure, spasme et sarcasme. L’infernal niche dans le germinal. Dans ligature incomprise, le céraste guette la prise. Le problématique s’éclipse dans l’elliptique. L’excentrique phagocyte l’empirique. Le fantasmagorique révoque le romantique. L’animal s’humanise, l’humain se bestialise dans l’errance égotique. L’extravagance amalgame les non-sens. Les temporalités se confondent. La syntaxe se dévergonde. La sémantique vagabonde. Le fragmentaire absorbe les interprétations impossibles. N’est-ce pas son génie d’alchimiste, cette transmutation des répulsions frustratives en fulminations créatives.
Mohammed Khair Eddine, démarche indolente d’échassier dégrisé des causes perdues, définitivement revenu de ses guérillas discursives, ressemble, en fin de parcours, à l’ibis chauve tapi dans sa paroi rocheuse. Logographe tombé de la lune, révolutionnaire sans tribune, multitude surgie du même corps négatif pelliculé d’aigreur, il n’aura écrit, dans le dédoublement narcissique, que des autobiographie jurassiques. S’estompent pernicieuses vilenies. Se dissipent sentencieuses verbomanies. S’épure son écriture des fruits défendus, des présages mévendus, des vains malentendus.L’ultime regard sur la vallée natale, l’empathique description d’un vieux couple heureux, ressuscitent l’enfance rurale, l’excellence des pratiques ancestrales, la succulence des traditions culinaires, la truculence de la langue millénaire, la poétique des fluidité ordinaires, la mystique des limpidités visionnaires. Le long poème épique à la gloire d’un saint méconnu se sacre et se consacre en berbère dans la calligraphie rituelle. L’épure conceptuelle s’accomplit dans l’extase factuelle. S’achève sur rivages désertiques l’interminable cavale. Agadir renaît de ses cendres maléfiques, se pare d’atours béatifiques, s’offre, comme une prostituée délavée de ses péchés, aux lascivités estivales. Gîtent en sodalité les grues et les flamands, les cigognes et les cormorans, les balbuzards et les goélands. Gambadent en liberté les gazelles magnifiques. Fleurissent en beauté les arganiers bénéfiques. Sur stèle intemporelle se profile le sphinx antique. S’efface sur tablettes les macabres diagrammes. Le mythe se forge dans l’énigmatique épigramme.
Mustapha Saha,
sociologue, poète, artiste peintre.
Mustapha Saha
Depuis son enfance, Mustapha Saha explore les plausibilités miraculeuses de la culture, furète les subtilités nébuleuses de l’écriture, piste les fulgurances imprévisibles de la peinture. Il investit sa rationalité dans la recherche pluridisciplinaire, tout en ouvrant grandes les vannes de l’imaginaire aux fugacités visionnaires. Son travail sociologique, philosophique, poétique, artistique, reflète les paradoxalités complétives de son appétence créative. Il est cofondateur du Mouvement du 22 Mars à la Faculté de Nanterre et figure historique de mai 68 (voir Bruno Barbey, 68, éditions Creaphis, Bruno Barbey, Passages, éditions de La Martinière). Il réalise, sous la direction d’Henri Lefebvre, ses thèses de sociologie urbaine (Psychopathologie sociale en milieu urbain désintégré) et de psychopathologie sociale (Psychopathologie sociale des populations déracinées), fonde la discipline Psychopathologie urbaine, et accomplit des études parallèles en beaux-arts. Il produit, en appliquant la méthodologie recherche-action, les premières études sur les grands ensembles. Il est l’ami, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, de grands intellectuels et artistes, français et italiens. Il accompagne Jean-Paul Sartre dans ses retraites romaines et collabore avec Jean Lacouture aux éditions du Seuil. Il explore l’histoire du « cinéma africain à l’époque coloniale » auprès de Jean-Rouch au Musée de l’Homme et publie, par ailleurs, sur les conseils de Jacques Berque,Structures tribales et formation de l’État à l’époque médiévale, aux éditions Anthropos.
Sociologue, artiste-peintre et poète, Mustapha Saha mène actuellement une recherche sur les mutations civilisationnelles induites par la Révolution numérique (Manifeste culturel des temps numériques), sur la société transversale et sur la démocratie interactive. Il travaille à l’élaboration d’une nouvelle pensée et de nouveaux concepts en phase avec la complexification et la diversification du monde en devenir.






YASMINA CHELLALI,
ETOILE DU SUD DE LA HAUTE COUTURE.
PAR MUSTAPHA SAHA
Il est des astres de l’art comme l’étoile du berger, luminosités imperturbables dans les nuées évanescentes, qui traversent les remous de l’histoire sans jamais quitter leur orbite. Ainsi en-est-il de Yasmina Chellali. Le regard de velours de la doyenne du stylisme cache un caractère de fer, rescapé de tous les enfers. L’élégante silhouette dissimule, sous savantes modicité, les magnificences du passé et les secrètes meurtrissures. Qu’importent les souvenances inaltérables, les célébrations mémorables, les blessures incurables, son âme et son esprit n’ont d’autre confidente que la muse inséparable. L’art est son indissociable berceau, l’œuvre en gestation son thaumaturgique sceau.
Les conversations avec Yasmina, curiosité vive à l’affût de l’actualité brûlante, se focalisent invariablement sur les thématiques artistiques. L’art pour toujours est sa raison totale et sa respiration vitale. Cette sensibilité toujours en éveil éclaire, comme une torche immuable, son vécu d’une étonnante cohérence. Elle vit la créativité comme une énergie intérieure, indéfinissable, imparable, indomptable, une grâce donnée à la naissance comme un impératif d’existence. Sa maîtrise technique s’improvise des inventivités imprévisibles quand phébus indique des chemins insoupçonnables, quand l’imaginaire en branle déborde les territoires. L’artiste, explorateur émotif de l’invisible, guetteur intuitif de l’impondérable, sans d’autre sémaphore que ses illuminations pulsatives, n’est-il pas un véhicule de visions qui le dépassent ?
Yasmina témoigne sans détours de cette pratique injonctive. Quand l’idée d’une œuvre germine, elle accapare l’être dans son entier. Le corps et l’esprit, la conscience et tous les sens sont en alerte permanente pour saisir au vol l’inconcevable, les configurations magiques qui s’imaginent, les plastiques mystérieuses qui s’illuminent, les formes inattendues qui se dessinent. Des virtualités de beauté qui, par enchantement, s’incarnent dans des matières chinées jusqu’au bout du monde. Chaque robe suscite son esthétique, sa symbolique, son univers allégorique, comme une réminiscence enracinée dans une mémoire lointaine. Chaque création ressuscite des codes vestimentaires millénaires. Quand le vent du désert imprègne l’âme de messages indéchiffrables, la disponibilité mentale s’installe dans la plénitude. La réception de l’ineffable exige une perception mystique. La réalisation de l’œuvre, dans ses différentes étapes, relève de la préparation alchimique. L’émotion de la styliste atteint le paroxysme quand le costume s’insuffle de vie dans la nymphe promise.
Dans l’acte de création, le doute accompagne l’exploration tâtonnante, la recherche fructifiante, l’expérimentation vivifiante. L’œuvre entraperçue dans l’exultation onirique est une étoile filante. Elle se dérobe aux esquisses chancelantes. Elle s’envoile d’équivoques stimulantes. Elle s’accroche aux cimes inaccessibles. Elle oriente vers des traverses impossibles. Elle réclame, pour son incarnation, des solutions innovantes. Le costume, au-delà des interrogations pudiquement tues, se sublime de son énigme absolue. Tous les artistes savent que la conception d’une œuvre, sa visualisation, sa projection, sont des sauts dans l’inconnu. L’ouvrage dévoile son architecture au rythme d’une étrange aventure où l’œil et le geste guettent fiévreusement les improbables ouvertures. L’œuvre achevée est toujours une révélation pour son propre initiateur.
La conjugaison des couleurs est une écriture plastique, un langage métaphorique, une lutte incessante avec les convulsions intimes. Chaque texture est porteuse de messages. Chaque plissure dissimule l’indicible. Entre fêtes et tempêtes, la création est une bouée de sauvetage. Yasmina conçoit les voiles, dans leur transparence couvrante, comme des ailes flottantes, des libertés caressantes, des rubans célestes taquinant les nuées irisantes. Elle métamorphose les coiffes traditionnelles en couronnes valorisantes. Elle voit toutes les femmes comme des princesses affranchies des cours oppressantes. Elle incarne en représentations palpables ses rêveries d’enfance. Le stylisme est un art majeur. Un costume n’est pas qu’un costume. Le costume est une œuvre vivante. Une œuvre mouvante. Une œuvre émouvante. Le costume est un miroir des paysages fantastiques traversées dans les folles escapades, des visages mythiques entrevus dans les voyages, des félicités en perpétuelles dérobade.
La saisie photographique des modèles requiert l’attention pointilleuse de cinéaste. Le cadre et la lumière, le nimbe et l’atmosphère, le regard du mannequin et sa posture, narrent une histoire sortie des limbes. Le feu sacré jaillit de fugace cratère. L’indémodable sublimité demeure l’unique critère. Ses fantômes et ses cyclones, ses beaux songes et ses cauchemars, ses prières et ses suppliques, fusionnent dans l’image. De la brumaille perlée des étoiles surgit l’espérance. Un nouveau chemin se profile. L’horizon s’éclaire. Yasmina raconte une séance marquante. Après une longue et minutieuse mise en place, le mannequin, aguerri par une longue expérience, se retrouve subitement tétanisé devant le photographe, lui-même médusé par l’inexplicable inadvertance. Un ange passe. Le modèle s’absente comme une sainte. Sa tête s’auréole d’un halo d’extase. Peut-on imaginer cette fille libre, maîtresse de sa prestance, frémir comme une contemplative sans résistance ? La fille reprend ses esprits au bout d’un long silence, susurre d’une voix tremblante : « Yasmina, cette tenue me bouleverse au point de me donner des larmes aux yeux ». Son émotion communicative irradie l’atmosphère. La magie de l’instant s’éternise en souvenance.
Yasmina puise dans les bijoux l’impérissable anamnèse. L’orfèvrerie traditionnelle plonge ses racines dans la nuit des temps. Les diadèmes, les colliers, les fibules, les anneaux, les bracelets d’or et d’argent, ciselés de signes talismaniques, chargés d’ondes magnétiques, transmettent les fluides telluriques et les phosphorescences cosmiques. Ces bijoux fascinateurs racontent le cours des rivières et la majesté des montagnes, la fertilité des plaines et le rythme des saisons, la pénombre bienfaisante des maisons et l’aura séduisante des femmes. Ces parures enchanteresses couvent les connaissances précieuses et les affinités malicieuses, les délicatesses charnelles et les amours maternelles, les roses épinières et les secrètes manières. L’emblème des emblèmes de la culture ancestrale n’est-il pas la croix du sud, représentant la concorde originelle dans la quiétude matriarcale ?
Le patrimoine vestimentaire, qui n’a jamais cessé de se renouveler dans ses caractéristiques particulières, a été trop longtemps folklorisé, archaïsé, dévalué par l’exotisme orientaliste et le détestable esprit colonial. Avec la révolution numérique, l’information se mondialise, les singularités se planétarisent, les cultures s’égalisent, les curiosités intellectuelles s’aiguisent. La féérie figée des Mille et Une Nuits cède la place à la découverte des civilisations ignorées, qui irriguent désormais la modernité de leurs affluents diversitaires. Les temps du paradigme dominateur de l’occident sont définitivement révolus. Les cultures périphérisées enrichissent le monde autant qu’elles s’en enrichissent.
© Mustapha Saha,
sociologue, poète, artiste peintre
Photographie en noir et blanc :
Mustapha Saha et Yasmina Chellali (styliste)
Robe « Justice ».
Création : Yasmina Chellali.
Mannequin : Safia Saidi
Photographie : © Elisabeth et Mustapha Saha
POUR PUBLICATION
DRISS CHRAÏBI INALTERABLEMENT LIBRE ET LIBERTAIRE
PAR MUSTAPHA SAHA
Triste constat. En ce dixième anniversaire de la disparition de Driss Charaïbi, l’écrivain rebelle n’aura eu aucun hommage à la hauteur de son œuvre planétaire. Le Salon du Livre de Paris, où le Maroc était l’invité d’honneur, a été une belle opportunité historique, piteusement gâchée par l’incompétence des organisateurs. Quelques colloques universitaires, marqués par leur élitiste confidentialité, au lieu d’amender cette pensée vivante, de fertiliser ses possibles inexplorés, de la propulser dans son devenir fécondateur, l’ont fossilisée dans la nébulosité des sempiternelles casuistiques. L’irrécupérable intelligence bute toujours sur l’indigente fanfaronnade culturelle. Je m’attendais, dans son propre pays, à une célébration institutionnelle qui l’aurait définitivement consacré comme inamovible bannière des lettres marocaines, comme inextinguible chandelle pour les générations futures. J’escomptais une initiative audacieuse d’édition de ses œuvres complètes enrichissant pour toujours les bibliothèques référentielles. Ses livres régénérateurs de la langue matricielle et de la littérature diverselle demeurent largement méconnus dans leur argile première. S’estompent encore une fois dans l’ambiante équivocité les inaltérables lumières.
Un auteur atypique
La trajectoire iconoclaste de Driss Chraïbi, convulsée, à chaque détour, par l’ironie socratique, déboussole les paramètres scientifiques, déroute les codifications académiques, déjoue, avec malice, les analyses critiques. Une littérature d’exil, creusant ses empreintes hors sentiers battus. Un capharnaüm de romances aléatoires, d’aventures homériques, de confessions épuratoires, de visions poétiques, de fulgurances prémonitoires, d’envolées mystiques, d’anecdotes sublimatoires, d’exultations fantasmagoriques, d’indignations fulminatoires, de déclamations catégoriques, d’investigations probatoires, de lucidités anthropologiques. Une quête perpétuelle d’inaccessibles rivages, l’imaginaire sans entraves pour unique territoire. Le donquichottiste assumé taquine l’impossible, l’œil rivé sur l’imprévisible. L’œuvre déclinée par éclats en puzzle chaotique, quand elle est saisie avec le recul panoramique, présente cependant une imposante cohérence esthétique, thématique, philosophique. L’auteur atypique, cultivant, toute sa vie, une marginalité savante, est entré dans l’histoire littéraire par la porte de traverse.
Dans sa vingtaine d’ouvrages, les audaces stylistiques, sous syntaxe classique, entraînent indifféremment le lecteur dans un flux et reflux aphoristique, où la saillie caustique guette au creux de chaque vague narrative. Les descriptions nostalgiques, les confessions pudiques, les déflexions mélancoliques, cachent immanquablement, dans leurs plis et leurs replis, d’inattendues réfutations sarcastiques. Dès que plume se montre prodigue d’épanchement romantique, le doute méthodique la rattrape. Le corps à corps de l’auteur avec l’inspecteur Ali, son jumeau golémique, vociférateur de vérités profondes, relève de la bataille épique. Chraïbi ne reconnaît que son double en digne interlocuteur. L’altruiste autistique, sans cesse désaxé par le cataphote sociétal, puise, au plus profond de ses meurtrissures, matière d’écriture. Le burlesque Inspecteur Ali, insoupçonnable perceur d’énigmes, se porte à son secours en pleine panne d’inspiration, endosse l’habit guignolesque des spécialistes du camouflage, couvre de son insolence la reconquête anxieuse de la terre natale, le dialogue rocambolesque des mœurs orientales et des mentalités occidentales, la dénonciation du phallocentrisme chicaneur, avant de liquider, au bout de six enquêtes désopilantes, son propre auteur.
Un esprit libre et libertaire
Tout au long d’une existence de risques et de doux fracas, Driss Chraïbi se constitue ses propres références éthiques, ses contremarques symboliques, ses balises sémantiques, reléguant la recherche désespérante et chimérique d’une identité culturelle aux armoires d’apothicaire. Peut-on se réduire à une étiquette langagière en guise de raison d’être ? La plume réfractaire aux dirigismes, rétive aux autoritarismes, revêche aux chauvinismes, cultive studieusement, autodérision en bandoulière, l’art du contre-pied, de la parade beuglante, de la répartie cinglante, et toutes les armes de tendre goguenardise des sensibilités à fleur de peau. Une sensibilité fiévreuse qui ne supporte que l’intime obscurité. La lumière se trouve au fond du puits.
Le chroniqueur désabusé des temps douloureux n’est jamais en quête de reconnaissance publique, la notoriété stimulatrice lui ayant été acquise dès son premier livre « Le Passé simple », descente identificatoire dans l’enfer de l’éducation castratrice, traversée purificatoire de l’archaïque purgatoire, genèse de la désobéissance épidermique. L’étudiant rebelle, le libertaire spontané, forge, par effraction, sa personnalité sociale dans la dissidence oedipienne, dans l’antagonisme frontal avec le père théocratique, l’affranchissement des cadènes matérialistes, l’émancipation des valeurs obscurantistes, la condamnation définitive des pesanteurs religieuses, des inégalités coutumières, des asservissements sexistes. Il brise instinctivement les loquets rouillés de l’identité séculaire, stérilisatrice de la diversité régénératrice. Il transcende, par l’écriture, l’appartenance à une double culture et surmonte, par la transgression des tabous stéréotypés, la schizophrénie récurrente des écrivains francophones.
Cette terre natale se drape de toilettes attractives, tantôt traditionnalistes, tantôt modernistes, se calfeutre dans son décorum touristique, étouffe, sous rituels immuables, ses luttes intestines. Regard implacable de l’autre rive, détecteur des tartufferies enturbannées. Dans « Succession ouverte », les funérailles du patriarche révèlent le vieux monde en décomposition, la nébuleuse inextricable des nomenclatures oppressives, la postérité venimeuse de l’hydre vampirique. La pensée libre butte sur les barrières physiques et métaphysiques, les sédimentations historiques, les œillères héréditaires. « L’Homme du livre » remonte « La Mère du printemps » jusqu’à la source arabique pour puiser, dans la révélation prophétique, l’espérance d’une nouvelle Andalousie, creuset d’une civilisation plurale et diversitaire.
Un écrivain d’avenir
Des chercheurs, amateurs des contextualisations fossilisatrices, s’évertuent d’autopsier l’œuvre de Driss Charaïbi comme un cadavre exquis, avant de l’enfermer dans un sarcophage de mausolée, oubliant, au passage, que sa littérature sacrilège creuse toujours son sillon démystificateur dans les réalités présentes. Dans la condescendance de la société coloniale, son livre-brûlot « Les Boucs », sur les damnés de l’immigration, dépouillés de leur amour-propre et de leur respectabilité, parqués dans des baraquements sordides, comme aujourd’hui leurs descendants dans les cités d’exclusion, dévoile l’intériorisation mentale de la dépendance aliénatoire et de la servitude volontaire. Critique incisive de l’idéologie d’intégration, des théories d’inclusion, légitimations légalistes de l’ostracisme programmé, et de la victimisation atavique, reproductrice du complexe de colonisé. Ces africains et maghrébins contraints de s’expatrier massivement pour se remettre à la solde de leurs anciens dominateurs sont bel et bien une factualité persistante. « L’Âne » pressent la faillite chronique des indépendances africaines, le développement du sous-développement des riches territoires livrés aux oligarchies corrompues. L’observateur des dérives politiques, le diagnostiqueur des impasses sociétales, l’explorateur des labyrinthes interculturels, demeure d’une actualité mordante.
Mustapha Saha,
Sociologue, poète, artiste peintre.
Portrait de Driss Chraïbi par Mustapha Saha.
Peinture sur toile 100 x 50 cm
Les deux dinosaures et l’indomptable égérie
Par Mustapha Saha
Une photographie peut dire plus qu’une thèse emphatique. Quand deux dinosaures de l’intellection contemporaine, Edgar Morin et Alain Touraine, encadrent Djemila Khelfa, leur muse providentielle, figure inébranlable de la contre-culture, la saugrenuité séductive s’inscrit, avec bonheur, dans l’apagogie détonante de Jean Baudrillard, incurable trouble-fête soixante-huitard, analyste inclassable de la dérive consumériste, de la manipulation mercantile des signes, de l’aliénation symbolique, débusqueur fracassant des insignifiances sous fausses cohérences, traqueur agaçant des réalités illusoires, des virtualités collusoires, des certitudes provisoires. Deux penseurs du chaos dans le chaos de la pensée trouvent leur égérie dans l’esthétique transgression de la platitude ambiante. L’icône des marginalités insolentes, démystificatrice des officines institutionnelles, inspire paradoxalement les audaces théoriques d’universitaires établis.
L’infernale chérubine de la Bande des Halles, prêtresse incorruptible de salutaires extravagances, illumine l’autorité mandarinale d’étincelles fascinatoires. Djemila Khelfa, indémodable prophétesse des années punk, discrète pythonisse des temps numériques, liquidatrice des références reconnaissables, métamorphose son corps et son être en œuvre artistique. Tantôt sirène imprévisible se coulant dans la simulation comme poisson dans l’eau, tantôt tigresse lacéreuse des coursives, coup de pied dans la fourmilière en guise d’attitude. Le magazine Façade fructifie sa silhouette atypique. Andy Wahrol la consacre « parfaitement graphique ». La parodie se grime de tenue provocatrice. Les enfants terribles de la haute couture, Thierry Mugler, Adeline André, Olivier Guillemin, en première ligne, se précipitent. Puisque la tyrannie médiatique lamine le vivant dans ses représentations fallacieuses, la caricature se tourne et se retourne comme un gant de velours. Il ne reste pour être visible que le jeu des apparences. Dada revient par la fenêtre. Esthétique minimale et goguenardise sismale. Les cinéastes underground tournent leurs films sur macadam étoilé de lueurs obscures, dans les entrailles parisiennes et les ruelles serpentines, les cours nébuleuses et les garçonnières clandestines. Le décor ironique orchestre le challenge frénétique. L’image se fragmente dans la pénombre. Pierre et Gilles mythifient les grimaces. L’authenticité se dissout dans la chimère affective. La gloire s’acquiert et se perd sur un coup de dé. La séduction se fonde sur le principe d’incertitude. L’amour n’est qu’un code informatique. Le charme robotique de la technocratie régnante se décale dans le fantasme numérique. Le marketing culturel soigne les vitrines. En ces temps où la nullité se proclame et se revendique comme label de postmodernisme, Djemila Kelfa, posture imperturbablement féline, imperméable aux fluctuations fashioniques, garde intacts son profil incomparable, sans griffe identifiable, et son impact énigmatique.
Drôle de compagnie. Deux monstres canonisés de la sociologie flanqués d’une contestataire génétique. La pensée bloquée prend la tangente. Jean Baudrillard jaillit de son sarcophage. Le philosophe maudit quitte définitivement les sentiers battus de la validation académique, de l’homologation scientifique, renoue avec notre utopisme nanterrois hors militantisme stérilisateur, pour se lancer à corps perdu dans la photographie. « L’écriture de la lumière » capte au vol le monde rhizomique en perpétuelle transfiguration kaléidoscopique. Le poète incompris se convertit en chasseur d’images sans lâcher sa plume, entame ses périples fous aux quatre coins de la planète, découvre dans les étendues américaines, où « les ordures mêmes sont propres, le trafic lubrifié, la circulation pacifiée », des déserts vidés de désir, des conforts écurés d’espérance, des prospérités gavés d’ignorance. Gigantesque parc d’attractions où l’architecture reproduit à grande échelle le décorum hollywoodien, où les faux-semblants se déclinent en couleurs primaires sur panneaux publicitaires, où l’image sociale se réduit au gros cigare des commanditaires. Le simulacre dans toute sa splendeur. L’humain chosifié par sa totémisation des objets de consommation. La société atomisée par l’omnipuissante technostructure.
Les apparitions foudroyantes de Djemila Khelfa retentissent comme des diffractions visuelles en résonance avec les axiomatiques badrillardiennes. Plusieurs plasticiens soulignent, dans leurs épures rouges et noires, la part d’ombre stylée sur fond translucide, l’ambivalence déroutante sous lumières lactescentes, les cambrures suggestives sur lignes fuyantes. La fin des illusions, symptomatique de la désintégration des valeurs dites universelles, des schèmes occidentaux en décrépitude, se formule comme une illusion de la fin, une explication apocalyptique des crises en chaîne, un tri-millénarisme cataclysmique. Le présent s’efface au fur et à mesure qu’il advient dans ses accroches sémiotiques. Les signes explosent en feu d’artifice abolissant instantanément leurs propres traces. Il ne s’agit même plus d’éternel retour nietzschéen. La réversibilité, ultime tentative de s’accrocher à une raison d’exister, bute sur la disparition des origines. La preuve s’annihile dans l’épreuve de l’égarement. Les événements se centrifugent, se vaporisent et se volatilisent. Le passé se démantèle faute de se projeter dans un devenir. L’horizon se dissipe dans la transfinitude. La mémoire artificielle engloutit toutes les mémoires mémorisables. L’histoire tourne en roue libre. Les intellectuels, outillés de postulats obsolètes, constatent, impuissants, les circonvolutions sans fin. Les technocrates, incapables de remettre les compteurs à zéro, comptabilisent les déficits. L’angoisse communicative puise son sens dans le non-sens. Le stress se cultive comme une distinction sociale. Les secousses continuelles n’épargnent aucune assise, aucune fondation, aucune substruction. Il n’est d’autre partage que le sentiment de déracinement. Toute chose s’aseptise jusqu’à l’anéantissement. Tout s’accélère, tout se désagrège dans la précipitation générale. Le vertige du vide, jeu de miroir des fuites en avant, produit et reproduit le vide la pensée. Le « no future » du mouvement punk s’intériorise collectivement au moment où il cesse d’être un cri de révolte générationnel.
Djemilove pratique instinctivement la sentence baudrillardienne : « le réel n’est plus possible ». Edgar Morin constate, dans ce sillage, « la faible réalité de la réalité ». Les concepts libérateurs du totalitarisme rationnel ne nichent-ils pas dans les traverses créatives ? « Le transfert poétique de situation », cher à Jean Baudrillard, opère par synchronicité magique. L’espace et le temps fusionnent dans la saisine alchimique du moment. Le dialogue avec l’inoxydable impertinence baigne la photographie d’une ombre interpellative. La bête de scène, bouche voluptueuse, prunelles langoureuses, anticipe la pose, se transpose dans l’immortalisation de l’instant. Les deux patriarches, surpris par l’objectif, semblent émerger d’une plongée méditative. L’improbable amitié se réalise dans les fugacités convergentes.
© Mustapha Saha
Photographie :
Djemila Khelfa avec Edgar Morin et Alain Touraine à l’occasion d’un hommage à Jean Baudrillard.
LE CAFE DE FLORE
PAR MUSTAPHA SAHA
Mon voisin déroule sa longue trajectoire
L’après-guerre s’évoque en décor Allégret
Le souvenir de Sartre hante son purgatoire
Son œuvre s’achève en éternel regret
La clientèle afflue les paradeurs s’évitent
La pensée disparaît survit le beau spectacle
De Beauvoir et Camus dans le récit s’invitent
L’énigme du Flore s’exprime en pentacle
Le dandy scribouilleur échancre sa chemise
La critique au rabais le sacre philosophe
La chanteuse en détresse attend la bonne mise
De surnoms savoureux le serveur s’apostrophe
L’actrice métisse flatte son partenaire
Son film sur magazine explose en couverture
Sa suite s’enrichit de nouveaux mercenaires
Son clin d’œil me ravit je reprends ma lecture
Terrasse Saint-Benoît sous lumière nocturne
La bourgeoise bohème à mes côtés s’installe
Rien ne la perturbe ni mondain taciturne
Ni bigote en face comme nonne sur stalle
Son livre m’intrigue Roger Martin du Gard
Sans savoir à mi-voix je l’appelle Clémence
La fausse indifférente accroche mon regard
La soirée se termine une histoire commence
© Mustapha Saha
Photographies (c) Elisabeth et Mustapha Saha
Mustapha Saha et Guy Bedos au Café de Flore.





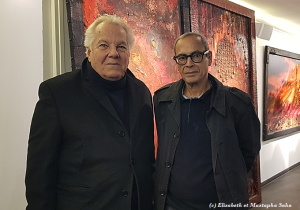
CHAYAN KHOÏ ENTRE CIEL ET TERRE.
PAR MUSTAPHA SAHA
Sillonne Chayan Khoï
Les tortilles buissonnières
Et les traverses singulières
Les cavernes joaillières
Et les crevasses perlières
Prospecte Chayan Khoï
Les pérennités naturelles
Et les sacralités intemporelles
Les origines pulsatives
Et les mémoires nutritives
Transfigure Chayan Khoï
Les mythologies cumulatives
Et les beautés fugitives
En œuvres projectives
Mustapha Saha
Sociologue, poète, artiste peintre
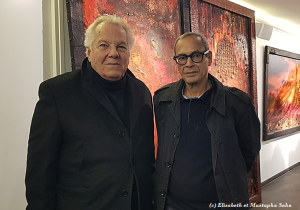











LE FORGEUR DE CONCEPTS
PAR MUSTAPHA SAHA
Pur songe ou vérité cette rencontre étrange
Entre mage envoûteur et poète en détresse
Le charmeur de serpents se transforme en archange
Le forgeur de concepts trouve enfin sa prêtresse
La flûte en liberté comme source ruisselle
Le labyrinthe s’ouvre au-delà du miroir
L’albatros en plein vol du fardeau se desselle
Les plans s’interchangent dans le monde à tiroirs
Le barde sous hypnose engrange les symboles
L’horloge s’arrête les époques défilent
La légende s’offre comme éternelle obole
Aux confins du désert un point d’eau se profile
La plage aux galets bleus décline ses saveurs
Clignote sous ciel gris le lointain sémaphore
Le navire accoste sur le quai des rêveurs
Le temps reprend son cours sur cadran de phosphore
Le penseur de Rodin sur son rocher médite
Le verbe perpétue son image vivante
L’œuvre au vif s’inspire d’aventure inédite
Les contours s’esquissent d’une épître savante
Au bout du voyage la divine chaumière
La muse aux jambes nues l’entraîne dans sa couche
Il plonge en corps à corps dans le bain de lumière
Le baiser céleste d’un long poème accouche
© Mustapha Saha
ANNIVERSAIRE D’ELISABETH BOUILLOT-SAHA A LA CLOSERIE DES LILAS.
Paris. Novembre 2017.
Avec :
– Elisabeth Bouillot-Saha, écrivain, artiste peintre,
– Mustapha Saha, sociologue, poète, artiste peintre,
– Pierre-Julien Dubost, philosophe, pédagogue,
– Yasmina Chellali, styliste haute couture,
– Katia Bobet, ancienne danseuse étoile,
– Lila Boukortt, artiste sculpteur,
– Maï-Do Hamisultane Lahlou, écrivain,
– Sarah Desplebin, pédagogue,
– Arnold Vialfont, économiste,
– Ida Parzanese, communicante événementielle…